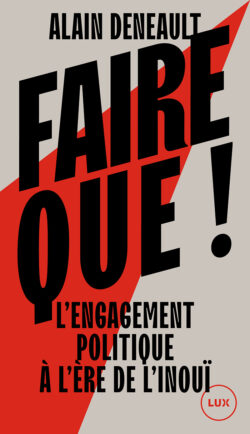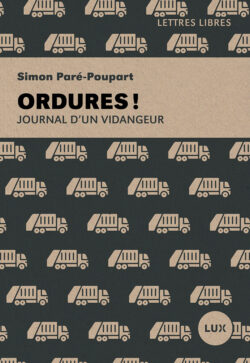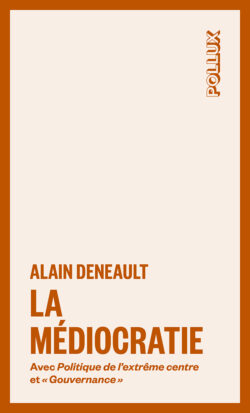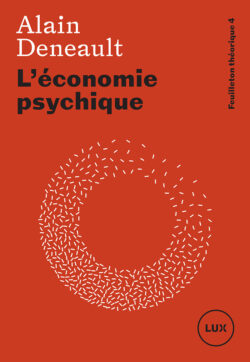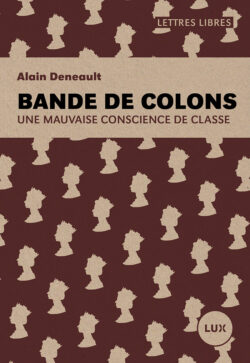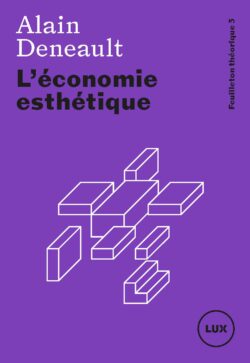Sous-total: $

Pour qui, la philo?
Pour philosopher apprenez
Qu’il faut d’abord la permission
Des signatures et des raisons
Un diplôme d’au moins une maison spécialisée…
– Félix Leclerc, chanson Contumace
Tous philosophes! Nous sommes tous des intellectuels. C’est la thèse scandaleuse soutenue par Antonio Gramsci dans ses Cahiers de prison (Folio). Le commun n’a rien à envier aux « intellectuels organiques », soit tous ces experts, idéologues, consultants et vulgarisateurs partageant et relayant les intérêts de la classe dominante. Le commun est capable par lui-même de se renseigner, de lire et de s’opposer aux thèses admises et colportées par les pouvoirs institués. L’intelligence et la volonté sont ce qui lui reste. Regardez-le s’opposer aux promoteurs du gaz de schiste et leurs méthodes de fracturation. Le voilà se constituer savant en la matière et opposer des contre-expertises. Regardez-le sinon neutraliser le pouvoir dans une grève nationale au nom de l’accès à l’éducation postsecondaire.
Il y va de même pour la philosophie. La sociologie nous apprend certes que des milieux sont favorisés pour produire des philosophes professionnels. Une fille de médecin ayant grandi à Outremont sera plus avantagée du point de vue du capital social et symbolique qu’un fils de mécanicien de Chibougamau pour se destiner à un travail doctoral sur Leibnitz. Mais l’histoire des idées réserve néanmoins une place étonnante aux marginaux et prolétaires qui n’étaient pas censés quitter leur place à l’usine pour s’adonner eux aussi à la lecture ainsi qu’à la production de pensées conceptuelles. Karl Marx n’avait-il pas comme interlocuteur Joseph Dietzgen, auteur d’un Exposé par un travailleur manuel, d’une Nouvelle critique de la raison pure, à partir de la notion de Travail de la tête (Kopfarbeit), pudiquement traduit « travail intellectuel » à Paris?
Au dernier quart du XXe siècle, Bernard Stiegler, un tenancier de bar incarcéré après quelques braquages en France, ne s’est-il pas révélé un excellent philosophe, en menant des études dans la discipline pendant ses années de prison, pour en sortir reconnu par ses nouveaux pairs?
Aujourd’hui, encore, Simon Paré-Poupart fait connaître sa « philosophie de ferrailleur » dans un ouvrage soutenu paru chez Lux Éditeur, Ordures. Le freeganisme désigne chez lui une éthique de la consommation que beaucoup seraient bien avisés de connaître. Ou Jean-Marc Limoges, fils d’ouvriers analphabètes, explique dans Victor et moi (Boréal, 2021) comment il est devenu professeur de littérature et de français en s’opposant à la doxa officielle que prodiguaient ses professeurs. Il en ressort tout une pensée de la pédagogie.
D’autres font le chemin inverse. Dégoûté par le caractère idéologique de l’activité universitaire, Matthew Crawford a poursuivi ses recherches sur « le sens et la valeur du travail », tout en œuvrant comme réparateur de motocyclette.
Ces exemples ne sauraient dissimuler le pouvoir de la reproduction sociale des institutions convenues. Elles ont lamentablement échoué dans leur prétention à favoriser la mobilité sociale. Ou peut-être ont-elles partiellement échoué dans leur volonté inavouée de maintenir loin de toute pensée critique les sujets étrangers au pouvoir bourgeois. Certains échappent aux tendances lourdes.
Pour le philosophe Jacques Rancière, il y va du principe même de démocratie. Il y a démocratie dans ces moments où l’intelligence est donnée en partage. Non pas que nous devenions soudainement tous égaux, mais où aucune compétence spécifique n’est dominante dans l’étude d’un problème. Faut-il envoyer nos enfants à la guerre? Doit-on accepter que subsistent d’importantes inégalités sociales? Qui peut prétendre en savoir davantage que d’autres sur cette question simple qui touche le commun en son cœur et concerne intimement son existence? Dans Le maître ignorant (Fayard, 1987), Rancière suit également les révélations de Joseph Jacotot, un professeur parachuté dans les Flandres au XIXe siècle, faisant apprendre à des étudiants ce qu’il ignorait lui-même. Il a découvert alors le pouvoir de l’émancipation, à savoir que l’élève n’a pas nécessairement besoin du professeur pour apprendre. Que le professeur peut même s’instituer comme un abrutisseur auprès de lui, en le faisant plafonner.
Si nous sommes tous philosophes, et tous capables de pensée critique, force est d’admettre que nous naissons piètres philosophes. Spinoza appelait au XVIIe siècle « premier genre de connaissance » la façon spontanée que nous avons d’inférer des vérités à partir de moments strictement accidentels. On excède cette façon « mutilée » de penser lorsque l’on comprend que nos haines, nos frustrations, nos colères et nos jalousies, soit nos « passions tristes », sont le plus souvent le fait d’une méconnaissance des conjonctures dans lesquelles nous nous trouvons, et des éléments extérieurs à soi avec lesquels nous entrons en rapport. C’était sa façon de rappeler l’hostilité traditionnelle de la philosophie à son contraire, la simple opinion.
Qui qu’on soit, philosopher exige donc une prédisposition importante au travail. En l’occurrence, travailler signifie s’étonner de ce qui se présente comme banal, critiquer ce qui appartient au cours normal des choses, produire des concepts qui permettent d’articuler les éléments du réel de manière autre que convenue et soumettre à la pensée commune un certain nombre de problématiques qui déplacent le foyer des questions et font débat. L’insondable corpus et quelques penseurs contemporains nous assistent dans ce travail ardu.
La pensée critique se pose comme le premier moment de la philosophie. Qu’elle soit strictement intellectuelle comme chez Emmanuel Kant ou politique comme chez Karl Marx, ou psychique comme chez Sigmund Freud, ou décoloniale comme chez Achille Mbembe, ou sociétale comme chez Judith Butler, elle consiste chaque fois à se questionner sur l’origine historique, sociale et idéologique des notions qui sont soumises au public ou colportées par lui. La halte critique que la critique fait subir à ces notions idéologiques et la mise en perspective historique dans laquelle elle l’inscrit suffit à la relativiser, eu égard à d’autres approches et traitements possibles.
Max Horkheimer, philosophe de l’École de Francfort au début du XXe siècle, a insisté : la pensée critique entretient quant à elle-même les attentes qu’elle réserve à toute pensée. Elle doute de ses propres propositions, les soutient toujours sur le mode de l’épochè (la mise en suspens), les altère, les adapte, les fait évoluer. Là réside aussi son travail.
C’est un manquement à un tel travail qui fait mal philosopher le commun. On reconnaît les travers auxquels conduit la négligence intellectuelle dans certaines théories du complot, bien que ce syntagme soit galvaudé et mobilisé bien plus souvent qu’il ne le devrait. Dans des cas excessifs où des penseurs, au nom de l’exercice critique, campent sur une position dénonciatrice, il arrive que la pensée fige au moment d’une hypothèse, pour se satisfaire ensuite d’isoler les éléments semblant la conforter. Cette manifestation de paresse qui intervient au milieu du processus intellectuel est d’autant plus préjudiciable qu’elle se révèle séduisante aux yeux de qui ne souhaite pas longtemps s’éprouver dans le champ de la pensée. Pierre Bayard s’est référé à l’esthétique pour en témoigner, notamment dans Qui a tué Roger Ackroyd et Hitchcock s’est trompé (Minuit). On retrouve le même phénomène chez les xénophobes qui postulent le déclin de leur culture pourtant majoritaire ou chez les intersectionnalistes à tout crin qui réduisent les minorités à des êtres exclusivement soumis à des persécutions. Ces tares touchent autant, politiquement, la gauche et la droite.
On m’a demandé un jour à Radio-Canada : « Qui donc lit vos livres? » J’ai répondu : « Ceux qui les lisent. » Ce n’était pas qu’une lapalissade, mais une déclaration de principe. Il en va de même pour la philosophie. Qui philosophe la maintient en vie. À la condition de s’en donner la peine.
Alain Deneault, Les Libraires, 21 octobre 2024.
Graphisme: © Faustine Lefranc
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte