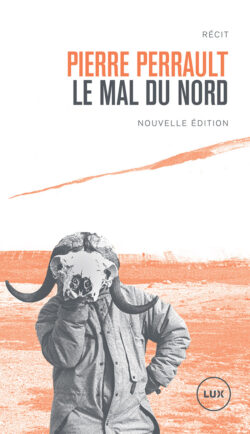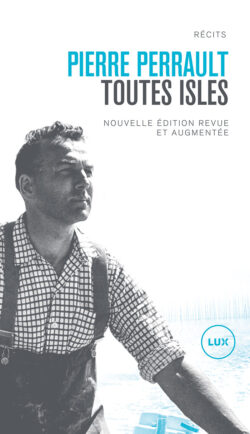Sous-total: $

Pierre Perrault: cueillir le polaire, réciter les îles
«La mer [est] trop grande pour mes yeux habitués à naviguer les écritures » écrivait Pierre Perrault au milieu des années 1950. « J’en ai assez de vivre dans le fiction » complètera-t-il trente ans plus tard. Bien souvent, l’auteur et réalisateur québécois s’est plaint d’une même tare, celle de fréquenter les livres plus que ce monde qui les environne. Il en est allé de même dans les eaux de la baie de Baffin, au début des années 1990 et à l’embouchure du Saint-Laurent trois décennies plus tôt. Ce constat, cependant, il s’est échiné sa vie durant à le conjurer. En témoignent deux rééditions chez Lux qui forment comme les bornes extrêmes de sa vie de poète et de documentariste.
La première, Toutes isles, livre d’abord publié en 1963, un an après la sortie de Pour la suite du monde, le film qui fit connaître Perrault, fait suite à une série de reportages réalisés sur le fleuve Saint-Laurent, avec ses habitantes et ses habitants. Là, c’est sur « le dos blanc d’un blanc dauphin blanc » qu’il a tenté de s’extraire de l’écrit, chevauchant paysages peuplés et poésie vernaculaire, avant de revenir de la rivière immense pour en faire le récit. La seconde, Le Mal du Nord (dont la réédition ne paraîtra en France qu’en janvier 2023), publié de manière posthume en 1999, est né d’un court voyage entre banquise et icebergs, depuis la ville de Québec jusqu’à la baie de Baffin, au-delà du cercle polaire arctique. Ici, le voyage s’est fait sur l’échine rutilante d’un brise-glace, le Pierre Radisson. À trente années de distance donc, deux textes qui se sont attachés à raconter les rives humides du Québec et les eaux gelées de ce « polaire » devenu substantif, qui sans cesse appellent à la découverte.
Précisons, à commencer par ce pays de « toutes isles » qui donne son titre au premier des deux récits. Anticoste, Île aux Coudres, Saguenay, Cap Tourmente, Islets-Caribou, archipel de Mingan… Les toponymes s’égrènent, les lieux se dévoilent à grands coups d’outils et de gestes. Car, on le verra, si les bêtes sont nombreuses et attirent le regard de Perrault, à commencer par ces bœufs musqués qui firent la matière de son documentaire Cornouailles, les hommes et les femmes du Grand Nord le fascinent plus encore. Il en doit la rencontre à Yolande, sa compagne, botaniste avertie, qui lui apprit le nom des plantes et les mots de son pays. Tandis que Pierre vivait encore dans le « nulle part de la littérature » elle, Yolande, « habitait une géographie et une conscience du paysage » qu’elle lui offrit généreusement, en même temps que des connaissances nouvelles. Ces connaissances, ces amis peut-être, ce sont des marins, des pêcheurs, des chasseurs, ces « embulataires » selon les dires de Cartier, des « nomades de tout ce qui remue dans la mer, pousse sur les îles, piste la forêt et la toundra » ajouta Perrault. Dans le sillage ou à bord de leurs canots, l’auteur a appris de leurs mains et a mémorisé leur « parlure » pour les conter au plus proche de ce qu’ils furent, de ce qu’ils sont.
Ainsi Perrault a-t-il navigué en « récitant les îles », qu’elles soient peuplées de chercheurs de morue ou de caribou, de Montagnais bavards ou d’Inuits taiseux, de peintres en peine de ce nord qu’ils ont parcouru longtemps mais que la vieillesse repousse toujours un peu plus loin. De même a-t-il psalmodié ces îles « sans événements que d’oiseaux, de vagues et de brisants » qui deviennent parfois des événements plus tonitruants que toute chose humaine.
Prenons les oiseaux. C’est « chose incréable », écrivait Jacques Cartier, à quel point certains des îlots de l’embouchure en étaient recouverts lors de son passage, bruissant paquets de plumes que le vent ébouriffait à peine, grands sacs de becs bruyants et bavards. Quatre siècles après que le navigateur a témoigné de son effarement, le nombre n’est plus le même et certaines espèces, à commencer par le grand pingouin, ont disparu. Toutefois, l’enthousiasme à les voir persiste. « Les oiseaux ne sont pas futiles », affirme Perrault dans Le Mal du Nord, « car ils représentent le seul événement susceptible d’indiquer une route ». Parce qu’ils « démontrent la mer » qui, esseulée, semble abstraite à beaucoup. On songe à ce sizerin flammé, passereau au front cramoisi, qui émerveilla durant quelques jours tout l’équipage du Pierre-Radisson. « Notre mémoire est encombrée d’oiseaux, les uns pour dire le voyage de présent, les autres pour se remémorer d’anciens voyages. Sans eux et quelques rares dorsales, qu’aurions-nous à dire de la mer ? Sans les images d’oiseaux, comment se faire une image de la mer ? » Encombrement salutaire qui enseigne, à l’observer, « la patience définitive de l’amour des oiseaux ».
Les images maniées par Perrault viennent aussi, et de plus en plus à mesure qu’il vieillit, de textes dans lesquels il retourne sans faiblir. Aux premiers desquels on trouve la relation faite par Cartier de son arrivée sur les côtes canadiennes. Ainsi se sont disputés dans les livres et les films de Perrault l’orgueil des ceux qu’on appelle « découvreurs », « l’imaginaire d’un Colomb et le documentaire d’un Cartier », l’auteur et cinéaste préférant néanmoins le second au premier. On se dit qu’il se situe plus sûrement à mi-chemin. On le reconnaît sans peine, oui, dans ce Cartier qui « prend délibérément le point de vue des oiseaux au lieu d’en croire les écritures », qui questionne les indiens qu’il croise, qui apprend de ces derniers comment passer l’hiver et se défaire du scorbut. Pourtant, cela ne cache pas une inclinaison au conte ou au poème – un risque, semble penser Perrault. Il prévient dans Le Mal du Nord, au moment d’embarquer : « Nous seront quinze jours à bord. Ils seront trois mois en mer. […] Nous sommes en grand danger de fabuler. »
Si l’on se réfère à la « poésie invincible et turbulente » de Toutes isles, fabuler un peu ne fait pas de mal, au contraire. Songeons à cette observation dont les sonorités s’incrustent pour longtemps dans la mémoire : « Sur l’eau bleue un taureau blanc broute les herbes du vent et disperse les cornes sonores de ses origines. » Avec cet animal fabuleux, ce sont toutes les bêtes d’une parole vernaculaire, vulgaire, populaire, qui se précipitent sur les pages et les foulent de leurs pattes, de leurs nageoires, de leurs ongles. Et, parmi eux, de nouveau, les oiseaux, ces oiseaux qui persistent. Il y a le fou de Bassan que Cartier appelait margot, qu’on écrit encore margaulx ou margault au Québec ; l’eider, canard à la calotte noire qui se dit moyack ; la mouette tridactyle qui, pour sa part, répond au doux nom de mauve. Et, bien sûr, les mammifères de l’océan, ces marsouins et loups-marins qui paraissent sans prévenir vêtus d’une livrée clinquante là où bélugas et phoques, leurs homologues en français nouveau, retombent mollement dans l’eau. « Pourquoi ai-je choisi un mot qu’on dit vulgaire ? Parce que ces mots-là font rougir les autres. » Un lexique à la fin de Toutes isles nous renseigne sur beaucoup de ces noms qui clochent. Les aborder comme on aborde une côte nouvelle décille le regard que l’on porte sur les territoires du Québec. Au début du même livre, ce commentaire : « Il reste beaucoup de solitudes à la mer à partager. » Généreux, Perrault a pris sa part dans ce partage. Trente ans plus tard, néanmoins, plus grand-chose ne paraît mériter qu’on s’y attarde avec autant de joie. L’objet est quelque peu différent, certes – on troque un fleuve contre le polaire – mais le sentiment d’une disparition point. Une disparition qui est comme la matière du Mal du Nord.
Dans une note présentant l’ouvrage, les éditeurs disent de ce dernier qu’il serait une manière de testament. On peut lire cela de deux façons. D’une part, en voyant là une œuvre qui ferait la somme de toutes les précédentes et lèguerait à qui veut bien la lire les bribes d’une existence dédiée à la mer, aux oiseaux, aux rivages et aux îles, à celles et ceux qui les habitent, à leurs attitudes, à leurs gestes, à leurs mots. D’autre part, en considérant Pierre Perrault non plus comme l’auteur du texte, mais bien comme un secrétaire qui prend note d’un Grand Nord essoufflé, bousculé par la mondialisation. Alors consigne-t-il, sur son carnet vert, ce « petit calepin docile », les évolutions touchant à la navigation, aux outils et aux techniques, à la manière d’habiter les îles et les rivages, d’y vivre ou d’y survivre. L’entreprise semble démesurée : « Est-ce qu’on peut exprimer le moindrement le nord du monde dans un petit cahier vert » se demande-t-il, a fortiori lorsque ce point cardinal est autant touché que les autres par les secousses planétaires ? Si Pierre Perrault, en vieux voisin du pôle, raille, sceptique, l’activisme écologiste de la fin du siècle dernier, l’accélération de la fonte des glaces arctiques et l’érosion de l’inlandsis groenlandais lui donnent franchement tort. Néanmoins, une fois de plus, une dernière fois, Pierre Perrault a donné dans le documentaire, son genre de prédilection. Il s’est agi d’enregistrer l’existant avant de peindre une figure neuve sur ce socle composite que forment les observations du jour et les souvenirs de ceux l’ayant précédé : « Et maintenant, je navigue dans mon petit carnet, recomposant les gestes de la veille. Je donne la réplique à mes souvenances. »
Que sont deux semaines de navigation, un mois de l’année 1991, pour soixante années d’existence ? Une goutte d’eau, sûrement et peut-être est-ce la raison pour laquelle le récit occupe si peu de place dans Le Mal du Nord. Le « petit à petit du fleuve », « le jour après jour de la navigation », ne conduisent pas aux tonitruances de Toutes isles. Les entretiens faits avec l’équipage et retranscrits font plus penser à un autre genre qu’affectionna l’auteur, celui du reportage. Ainsi, Perrault s’acquitte de sa mission et « journalise le temps qui passe » en enregistrant les hommes et les femmes qu’il accompagne. On le suit de la machinerie du navire, dans l’hélicoptère qui patrouille la banquise, jusqu’à la timonerie, là où l’on inspecte le large autant que l’instrumentation du tableau de bord. Mais c’est encore l’occasion d’une digression – une pratique qui n’est pas sans rappeler un autre de ses adeptes, volontiers grincheux lui aussi, à savoir Olivier Rolin et son récent Vider les lieux. Les radars conduisent en droite ligne à « l’obstination des boussoles » et à quelques autres outils : loch, astrolabe, compas, tous désormais rangés dans une petite commode ou dans la mémoire de l’auteur, comme on enferme l’hostie dans le tabernacle. À double-tours. Revenant au réel, Perrault conclut : « Les navires ont défroqué de la fable. »
Ainsi les voyages s’entrechoquent et les moyens de locomotion se superposent, sans se recouvrir tout à fait. Le Pierre-Radisson, affairé à son « étrange labour » au milieu des glaces, « imite les gestes du canot », mais ne les supplée pas. « Il n’est pas évident de chevaucher un fleuve inédit à la rencontre du polaire » écrit Perrault se souvenant d’Erik Le Rouge, de Cartier encore. Ajoutons qu’il n’est pas aisé de s’y mouvoir quand tant d’autres s’y sont déjà rendus, quand le radar et la carte documentent en temps réel l’ensemble de l’espace. Seule perturbation à même de fragiliser l’assurance du navire, la survenue d’un iceberg – car même « une mouvée de phoque » ne peut plus faire dévier la course du bateau.
Au moment d’accoster et de laisser l’embarcation repartir, vidée de deux de ses occupantes et occupants, lançons avec l’auteur un dernier regard à hauteur d’oiseau, sur l’étendu parcourue et celle qui reste à parcourir : « je ne viendrai pas à bout de tout dire ». Conclusion qui, à bien y réfléchir, n’a rien de grave, car Perrault l’assure : « je ne cherche pas le fin bout de l’infini ». Seulement à en parcourir un morceau. Seulement à aller « plus oultre », pour reprendre les mots de Cartier, ce « plus oultre » qui se trouve dans la géographie comme dans la mémoire.
Élie Marek, Diacritik, 8 septembre 2022
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte