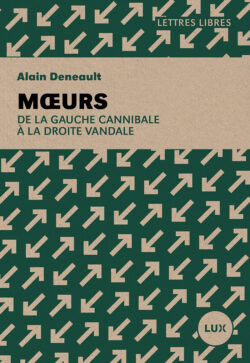Sous-total: $

Woke’n’roll au Québec
Outre-Atlantique, chez nos cousins québécois, la question reste la même que sous nos latitudes : les militances issues du champ de la postmodernité, soit le féminisme intersectionnel et l’antiracisme postcolonial pour ne citer que les plus emblématiques, participent-elles d’un enrichissement de la question sociale ou de sa dilution ? « Islamo-gauchistes » versus « universalistes laïcards », les épithètes fleurissent désormais à bon compte pour disqualifier toute tentative de discussion entre individus de camps irréconciliables. Comme le disait ce vieux camarade croisé lors de la manif du 29 septembre contre la schlague antisociale macronienne : « Aujourd’hui, on ne peut plus débattre ! » Il y a du vrai dans cette simple assertion. Comme si les positionnements avaient atteint de tels points de surchauffe épidermique que les moindres doutes ou objections reçus contre le socle de ses engagements impliquait de sortir illico les couteaux. Et le soussigné ne fait pas exception à la règle, tout prêt qu’il est à tirer sèchement l’esgourde du premier gandin venu lui souffler au nez que sa position universaliste n’est que le cache-nez de sa confortable et surplombante position de mâle blanc occidental, et que si le susdit diagnostic le met dans une telle colère c’est que le péché est si profondément niché dans les limbes de sa psyché qu’un examen de conscience n’y suffirait pas pour l’extirper. C’est en partie pour parer à cet emballement névrotique et au jeu à somme nulle de ces concours d’invectives que la rencontre, par la lecture, avec la pensée d’autrui est toujours un baume pour comprendre et apaiser ses propres irascibilités. Non pas pour reconsidérer son propre enracinement politique (car après tout, on peut être ferme dans ses convictions sans forcément vouloir casser la tête de ses rivaux), mais pour refroidir par un minimum de réflexion distante le cœur en fusion des désaccords. Aussi, sachons gré aux éditions Lux de nous avoir proposé récemment deux textes qui, s’ils ne s’articulent pas intégralement en tant que plaidoiries antagonistes prêchant chacune pour sa paroisse, offrent un champ non pas dépassionné mais solidement argumenté pour penser les contemporaines fragmentations de la gauche dite radicale.
« La panique morale d’aujourd’hui au sujet des wokes, que l’on nous présente comme un tout nouveau fléau, s’inscrit dans cette longue tradition paranoïaque qui a pris pour cible les francs-maçons, les catholiques, les Juifs, les homosexuels et les communistes, réels ou fantasmés. » Ainsi se résume à gros traits la thèse défendue par l’enseignant-chercheur québécois Francis Dupuis-Déri dans Panique à l’Université : toujours en recherche d’un ennemi intérieur pour exister pleinement, le camp réactionnaire grossirait jusque dans des proportions grotesques une mainmise wokiste sur l’Université afin de déployer son fonds de commerce visant, entre autres choses, à sauver les meubles d’une civilisation européenne décadente. Or, Dupuis-Déri, enseignant au département de science politique et à l’Institut de recherches et d’études féministes de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) est ferme : à aucun moment, les campus, qu’ils soient américains, québécois ou français, ne sont tombés sous le joug de la « tyrannie totalitaire » des néoféministes et des racialistes. Et c’est contre « la virulence et la mauvaise foi qui caractérisent ces attaques répétées contre l’Université » que l’homme a décidé de déconstruire (le mot est à la mode), chiffres et études à l’appui, ce mythe surmédiatisé. À savoir : finie l’étude des grands textes classiques et des traditionnels corpus ayant charpenté des siècles de sciences sociales ; aux oubliettes Platon, Machiavel, Rousseau, Marx et Tocqueville ; place désormais aux études de genre et décoloniales, à tous ces nouveaux ferments du gauchisme multiracial et inclusif. Dans cet exercice visant à dresser un portrait au plus juste de l’Université, Dupuis-Déri fait preuve d’un panache et d’un pragmatisme qu’il convient de saluer. Il a épluché les programmes de plusieurs facs, passé au peigne fin des sujets de thèse, compilé les thèmes de la Revue française de sociologie et de la Revue française de science politique, listé les séminaires, notamment ceux de l’UQAM, à la recherche de ces inquiétants indices corroborant l’idée d’une gauche « diversitaire » en position de force pour mener à bien une « véritable entreprise de destruction des savoirs et de la culture ». Résultat : rien ne semble menacer de près ou de loin l’Alma Mater dans ses fondements traditionnels. Non seulement « le canon de la philosophie occidentale est respecté » mais, contrairement à ceux qui arguent du bâillon du politiquement correct (« rectitude politique » au Québec), la liberté de parole des tenants du conservatisme patriotard ou religieux est toujours vigoureuse. Et Dupuis-Déri de citer par exemple le fait que moins de 10% des universités US offrent un programme en black studies (soit 360 établissements sur près de 5 000) contre « 480 business schools et 1 700 programmes de MBA (maîtrise en administration des affaires) ». Sans compter la pérennité des Daughters of the American Revolution, ancienne pépinière maccarthyste, toujours active sur les campus avec sa devise « Dieu, foyer, patrie », et sans oublier non plus la présence des centres de recrutement de l’armée ou d’associations anti-avortement grassement subventionnées.
Les bons et les mauvais progressistes
Si l’on peut convenir de la pertinence de tels arguments, un léger déplacement de la focale fait cependant apparaître d’autres questionnements. En premier lieu, l’analyse de Dupuis-Déri sur une Université indéboulonnable ne fait pas consensus, y compris dans le giron « progressiste » de l’UQAM : les professeurs, respectivement de sciences de l’éducation et de sociologie, Normand Baillargeon et Rachad Antonius (que Dupuis-Déri égratigne d’ailleurs sommairement dans son livre) ont dirigé l’ouvrage collectif Identité, « race », liberté d’expression [1] dans lequel divers intervenants d’établissements du supérieur notent des crispations de plus en plus pesantes, un inquiétant air du temps « plus idéologique qu’analytique, plus moraliste que réflexif ». Alors que l’Université devrait être ce sanctuaire des libres confrontations intellectuelles, c’est « l’idée même de discussion ou de débat [qui est] remise en question et, avec elle, les critères d’objectivité ou de vérité devant les régir : en lieu et place, l’identité des locuteurs, diversement définie et comprise, [devient] ce qui a priori, [autorise] (ou non) la prise de parole et [valide] (ou non) l’argument avancé ».
Ensuite si l’analyse de Dupuis-Déri tient autant la route c’est aussi parce qu’elle colle à sa grille de lecture. À savoir une division du champ politique en trois pôles : progressiste, conservateur et réactionnaire. À la manière de notre Corcuff national, Dupuis-Déri considère, en effet, que l’aile progressiste a tout à gagner à intégrer les préoccupations et analyses des adeptes de la déconstruction. Si les têtes de Turc qu’il se plaît à baffer, toutes issues de la droite radicale (le souverainiste expatrié Mathieu Bock-Côté, le néopétainiste Éric Zemmour, l’essayiste pantouflard Pascal Bruckner, etc.), ne peuvent qu’emporter notre commune détestation, notre irénisme se grippe soudainement lorsqu’il met dans un même sac d’opprobre les « polémistes anti-woke, réactionnaires ou progressistes » coupables selon lui de ne pas manifester « de curiosité intellectuelle ni d’ouverture d’esprit ou d’âme ». Et la question se pose alors crûment : c’est quoi un « progressiste » ? Dupuis-Déri se garde bien de nous définir un tant soit peu la chose, à part pour nous refaire le coup de la différence entre le bon et le mauvais chasseur : il y aurait, d’un côté, les bons progressistes naturellement friands des nouvelles productions théoriques du gauchisme identitaire et il y aurait les autres, les « incapables d’admettre que les études de genre, le racisme et le colonialisme, entre autres approches critiques, jouent un rôle d’une grande importance dans le développement des connaissances (…) et choisissent plutôt de joindre leur voix au chœur des réactionnaires antiféministes et anti-antiracistes, sans réfléchir sérieusement à l’effet d’une pareille convergence ni remettre en question l’image déformée et unidimensionnelle qu’on présente alors de l’Université ». À ceci près que les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. On se fatiguerait presque à répéter ce lieu commun. Ce n’est pas parce qu’Éric Zemmour veut « déconstruire les déconstructeurs » qu’on adhère à Reconquête ! S’il y a bien une critique de droite du postmodernisme avec ses mots d’ordre et son agenda idéologique, il en existe d’autres. Et notamment une venant d’une partie du champ libertaire rétive à l’idée de liquider son héritage sur l’autel très questionnable de nouveaux mots d’ordre identitaires. Rétive aussi à l’idée d’être réduite à l’état de composant passif d’un « progressisme » vu comme dynamique sommée de faire bloc autour de ses différentes avant-gardes, esthétiques ou théoriques, y compris si ces dernières périment en deux temps trois mouvements deux siècles de luttes et de critique sociale au prétexte que le principal héritage des Lumières serait le colonialisme.
Ajoutons enfin que, s’il est un angle mort qui aurait mérité d’être traité, c’eût été de savoir dans quelle mesure le champ de la contestation étudiante est lui-même traversé, travaillé, voir dans une certaine mesure « neutralisé » par ces nouvelles militances. Cela nous éclairerait peut-être sur les raisons de la grande discrétion des étudiants durant le soulèvement des Gilets jaunes et de penser le gouffre qui sépare le haut clergé en conceptualités ajoutées des masses turbulentes, toujours suspectes de virer barbares.
Pensée canonique anglaise
En vis-à-vis du livre de Dupuis-Déri, les éditions Lux nous propose Mœurs, d’Alain Deneault, professeur de philosophie et de sociologie à l’Université de Moncton (province canadienne du Nouveau-Brunswick). Théoricien, entre autres, de l’extrême centre (soit la gestion d’un darwinisme social naturalisé) et de la gouvernance (la politique oblitérée au profit d’un management à la sauce néolibérale), Mœurs déborde largement la question universitaire. Ceci étant, sur plusieurs pages, Deneault explore cet infernal canevas où les campus sont pris entre le chassé-croisé d’une gauche identitaire et d’une droite raciste, espèce de circuit clos où chaque saillie de l’une engendre sa réplique sismique dans l’autre camp. Si Deneault se montre sévèrement critique vis-à-vis de tout apport du postmodernisme à une critique sociale émancipatrice – un « existentialisme de pacotille » promu par une « fine frange de la radicalité » inscrite « dans l’hégémonie de la pensée canonique anglaise » –, il observe depuis le cœur même de sa position d’enseignant une inquiétante dégradation de la liberté d’expression au sein de l’Université. Lui-même en a d’ailleurs fait les frais. En 2008, il fut le coordonnateur et l’un des auteurs de Noir Canada : pillage, corruption et criminalité en Afrique [2], livre qui dénonce les pratiques mafieuses de multinationales canadiennes minières opérant en Afrique. S’estimant diffamés, les groupes miniers attaquèrent les auteurs et l’éditeur en justice. Résultat de la menace : bien qu’accessible sur Internet [3], le livre n’est plus publié depuis 2010. Lors d’un colloque en 2021, un « intellectuel afrodescendant » prit à parti Deneault à propos de Noir Canada et lui fit un procès en « appropriation culturelle » : « On en a assez d’entendre des Blancs parler à la place des autres. » Après la censure imposée par l’industrie minière, l’autocensure distillée par un autoproclamé représentant du camp victimaire ! Tristement cocasse. Effet rebond de ce chantage dont il est impossible de sortir indemne : Deneault le « privilégié » se résoudra « à raturer la Critique de la raison nègre, d’Achille Mbembé, [d’une bibliographie] d’un cours d’introduction en philosophie [qu’il s’apprêtait] à donner ». Et le philosophe de questionner : « Pour m’éviter un tollé et en épargner un à mon institution. Qui y a gagné ? »
Ailleurs, Deneault relate les faits qui se sont déroulés à l’Université « progressiste » d’Evergreen (État de Washington) au printemps 2017 et qui ont donné lieu à d’explosives exploitations médiatiques. Dupuis-Déri y faisant lui-aussi référence, voyons un peu de quoi il en retourne. L’histoire peut se résumer ainsi : le campus d’Evergreen avait pour habitude de pratiquer le Day of Absence, soit une journée du mois d’avril au cours de laquelle élèves et professeurs issus des minorités s’absentent du campus pour signifier symboliquement leur position discriminée. Dans la foulée de l’élection de Trump, le processus se voit inversé : ce sont les Blancs qui sont invités à déserter la fac. Bret Weinstein, professeur de biologie – plutôt « juif de gauche » nous dit la rumeur (wikipédienne) –, refuse de se soumettre à l’injonction. Alors, la machine s’emballe : le prof est harcelé et traité de raciste par ses élèves tandis qu’à l’extérieur la nébuleuse néofasciste multiplie les menaces. Fox News fait son beurre, le campus se cadenasse. De part et d’autre, le délire obsidional grimpe en flèche. Dans son compte rendu, Dupuis-Déri met la fébrilité des étudiants d’Evergreen sur le compte d’un climat xénophobe exacerbé par l’arrivée de Trump à la Maison Blanche. Sous sa plume, ce qui met le feu aux poudres n’est qu’une « journée de sensibilisation au racisme » sans préciser que cette journée était basée sur la réactivation, fût-elle temporaire et symbolique, d’un poncif ségrégationniste : la séparation des gens en fonction de leur « race ». Deneault, lui, s’effraie de ce qui se joue : « Dans la crise qui a tourmenté cette université, les Blancs devenaient ontologiquement privilégiés, mais absolument incapables d’en prendre la moindre conscience. Qu’arrive-t-il lorsque ce postulat de l’inconscience de la domination dérape au point de permettre d’asséner qu’être blanc, c’est être raciste à tous les instants de sa vie ? Là, explicitement, toute accusation, quel que soit le contexte, reste sans appel ».
Enseignement de l’ignorance
« Harvard, Yale, Princeton, Stanford, mais aussi Oxford, Cambridge, l’Université de Toronto, l’Institut d’études politiques de Paris et la plupart des autres hauts lieux du savoir affichent des résultats plus que médiocres en ce qui concerne la transmission de l’aptitude à réfléchir et à poser des questions. En fait, grâce aux filtres que sont les tests normalisés, les activités d’enrichissement, la reconnaissance des équivalences, le tutorat grassement payé, les écoles privées de luxe, les examens d’admission et la déférence aveugle envers l’autorité, ces vénérables institutions s’affairent essentiellement à créer des hordes de gestionnaires compétents. » Deneault cite ici le journaliste « socialiste » et américain Chris Hedges [4]. Partant de ce constat, il s’interroge sur le silence du monde universitaire à l’égard du « sort réservé à Noir Canada ». Alors que deux compagnies minières leur tombaient sur le râble en leur réclamant des millions de dollars de dommage, les auteurs du bouquin se sont sentis lâchés par leurs pairs. Quand ils n’ont pas été purement et simplement enfoncés, notamment par le titulaire de la Chaire de recherche en éthique (sic !) du journalisme de l’Université d’Ottawa, qui signera un rapport d’expertise à charge contre les auteurs du livre. Résultats : un des signataires de Noir Canada perdra sa bourse de travail et Deneault ne pourra enseigner qu’en se réfugiant en Acadie.
Une piste à méditer : si le déchaînement néolibéral des années 80 n’a épargné aucun pan de nos sociétés avancées, il n’y a aucune raison de croire que l’Université, fief historique des subversions, en ait réchappé. Ce phénomène a non seulement contaminé les modes de gestion et de financement des établissements universitaires, mais également « le cœur et les esprits » de ses acteurs. C’est là le propre de toute bonne guerre contre-subversive. Si l’analogie peut sembler excessive, on se rapportera à ce brillant diagnostic posé par l’auteur de Mœurs : « L’illusion libérale de pouvoir tout déterminer en soi et par soi seul – sa nature, son sexe, son mode d’être, ses croyances improvisées – soutiendra un temps la posture de résistance à un régime ultralibéral, auquel, ce faisant, on emprunte tout. »
 Mon compte
Mon compte