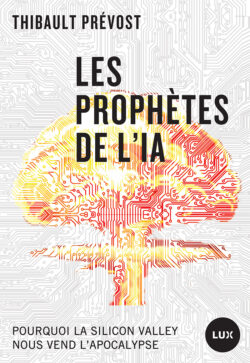Sous-total: $
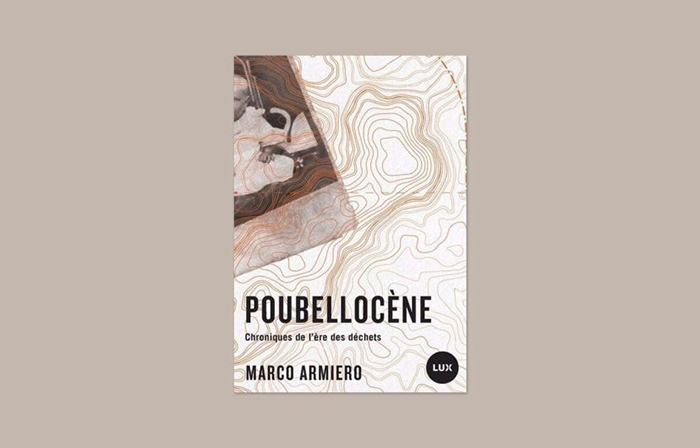
«Poubellocène»: mettre des vies au rebut
Les déchets sont partout. Chaque année, les êtres humains en produisent plus de deux milliards de tonnes ; une quantité astronomique qui contribue à forger, au milieu de l’océan, un cinquième continent, et à envahir les déserts des pays du sud de montagnes de vêtements, d’invendus et de produits gaspillés.
Dans l’essai Poubellocène. Chroniques de l’ère des déchets, l’historien italien Marco Armiero analyse cette tendance mondiale du « jeter à tous vents » dans une perspective sociologique, écartant ainsi la production des détritus eux-mêmes et ses conséquences sur la planète et les écosystèmes, se concentrant plutôt sur le système socio-économique qui la soutient.
L’essayiste, également professeur à l’Université autonome de Barcelone, oppose ainsi le terme « poubellocène » à celui, débattu depuis une quinzaine d’années, tant dans le domaine sociologique que géologique, d’« anthropocène », un terme fourre-tout désignant l’époque caractérisée par l’influence significative de l’être humain sur la géologie et les écosystèmes, offrant ainsi un contrepoids à sa dimension universaliste.
Selon le concept de « Poubellocène » élaboré par l’auteur, ce seraient donc les déchets qui constitueraient le marqueur géologique caractéristique de notre époque, pas tant par leur omniprésence que par leur rôle de vecteurs de « rapports socioécologiques voués à [re] produire l’exclusion et les inégalités ».
Pour expliciter son propos, il donne l’exemple du naufrage du Titanic. « Le 14 avril 1912, au moment où le Titanic entrait en collision avec un iceberg, le fait de voyager en première ou en troisième classe allait déterminer lesquels des passagers survivraient. » Selon l’auteur, le monde d’aujourd’hui serait encore divisé entre ceux qui s’en tirent aisément, et les autres, condamnés à lutter pour leur survie. « De façon quasi littérale, la métaphore du Titanic montre que les classes sociales ont leur importance dans l’Anthropocène. »
« Récits de toxicité »
En disséquant la stratigraphie de pouvoir et de toxicité qui compose notre environnement, Marco Armiero démontre que le maintien des privilèges d’une minorité repose sur une altérisation découlant de la production insensée de déchets — tant physiques que théoriques —, certains lieux et mémoires étant considérés comme jetables.
Dans cet ouvrage bref au propos limpide, l’essayiste sonde autant le rôle des écofictions dystopiques sur notre imaginaire que les histoires de toxicité qui se construisent au coeur des grandes épidémies. De Naples, en Italie, à Agbogbloshie, au Ghana, en passant par les États-Unis et le Brésil, il met au jour les « récits de toxicité » qui oblitèrent une facette de l’histoire, invisibilisent des réalités marginales ou banalisent les injustices.
Bien que très théorique, Poubellocène offre une perspective multidisciplinaire et surtout, très concrète, sur les écosystèmes qui accentuent la crise socioécologique dans laquelle nous sommes plongés, et sur les solutions communautaires qui existent et peuvent être imaginées pour tenter d’en sortir. L’essai mériterait une suite, car on aurait souhaité y lire également l’analyse de l’auteur sur la pandémie de COVID-19 et sur les histoires de toxicité qui en ont émergé et continuent de creuser les inégalités et de dissimuler certains discours. Une proposition qui fera certainement date.
Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, Le Devoir, 7 septembre 2024.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte