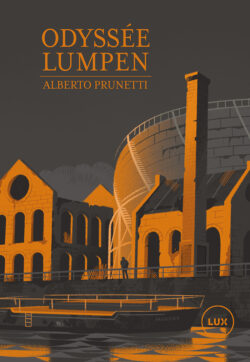Sous-total: $

Picaro néolibéral
Inspiré de sa propre expérience, Alberto Prunetti présente le récit émouvant et rageur d ’une plongée dans le prolétariat anglais des années 1990.
Après Amiante: une histoire ouvrière, publié chez Agone en 2019, Odyssée Lumpen est le deuxième livre à paraître en français de la trilogie que le journaliste italien Alberto Prunetti, traducteur de George Orwell, d’Angela Davis et de David Graeber, consacre à la classe ouvrière. À une époque où l’espace littéraire se plie trop souvent aux exigences d’une médiatisation aliénante et fétichisante, qui relève davantage du spectaculaire debordien que d’une volonté de compréhension et d’émancipation, on saluera le choix de Lux Éditeur de lancer un roman dédié au prolétariat en régime néolibéral. Prunetti, à l’instar du regretté Joseph Ponthus dans À la ligne: feuillets d’usine (2019), rend hommage à celles et ceux qui nettoient, fabriquent et cuisinent dans l’anonymat, et ce, pour une vie toujours plus précaire.
Ailes de cire
Alberto, le narrateur d’Odyssée Lumpen, est le fils de travailleur.ses des aciéries de Piombino, ville située au centre du littoral toscan et haut lieu de la sidérurgie italienne qui a fourni à l’Europe ses rails de chemins de fer. Passionné de lecture, encouragé dans cette voie par sa mère, le narrateur amorce à l’adolescence un parcours de transclasse, en tant qu’«enfant des usines qui avait endossé des ailes d’intellectuel». Mais voilà, les ailes d’un fils d’ouvrier sont faites de cire, dit-il, et ce jeune «sanglier sentimental» se retrouve vite à l’université comme un oisillon déplumé. La société n’exige plus qu’une chose de lui: l’intégration rapide et soumise au monde du travail. Devant le peu de perspectives qui lui sont offertes en Italie, il décide, sur le conseil d’un ami, de s’envoler pour l’Angleterre, où la paye, paraît-il, est meilleure et où on apprend l’anglais, au moins.
Arrivé en Angleterre, Alberto, un homme «aux épaules d’ouvrier et aux mains de pianiste», va d’un emploi à l’autre, entrevoyant, en picaro moderne, les dessous de la société. Exerçant divers métiers invisibles – pizzaïolo, agent d’entretien de food court, plongeur… –, il n’a comme formes de constance que l’indigence des conditions de travail, l’humiliation permanente ainsi que les exigences tyranniques d’un patronat hypocrite et paternaliste. «Partie instruite» de la working class britannique, Alberto comprend rapidement que sa place est celle des «euros intérimaires», ces «euros perdants», parfois éduqués, souvent faillis, «chair à canon au service d’un système» que le marché de l’emploi met en compétition avec les migrant.es désespéré.es. On embauche, dans ce monde, aussi vite que l’on licencie, et la valse des boulots se transforme en spirale infernale, lessivant les travailleur.ses jusqu’à ce qu’il n’en reste rien: «Ma volonté brisée ne revendiquait pas de droits. Je ne luttais pas. J’étais désormais presque une larve. Je partais à la recherche de n’importe quel travail.» Devant le risque d’anéantissement, Prunetti rentre en Italie pour apprendre que les hauts-fourneaux de sa région natale seront éteints, et l’activité industrielle, délocalisée. L’économie globalisée et dérégulée vient d’engloutir son univers. Il ne lui reste que l’écriture. Il écrira pour comprendre son histoire.
Lumière
Le roman de Prunetti repose sur une vision du monde fondamentalement marxiste, au sein de laquelle s’affrontent des rapports de force et des intérêts de classe à rebours du discours dominant, lequel affirme, depuis la décennie 1980, qu’il n’y a pas de société: seulement des intérêts d’individus mis en compétition. Odyssée Lumpen aborde de front l’échec des espoirs des travailleur.ses devant le rouleau compresseur néolibéral: «Les ouvriers comme mon père ont été défaits dix ans auparavant.» Prunetti, rejoignant en ceci les thèses du philosophe anglais Mark Fisher, raconte de l’intérieur le récit d’une victoire du «réalisme capitaliste», cette domination si complète de la logique de marché depuis la fin des années 1970 qu’elle a profondément bouleversé notre rapport à la vie. À l’instar de Fisher, Prunetti n’hésite pas à piger dans le répertoire fantastique et populaire pour imager sa pensée. Tout au long du roman, l’ombre d’une créature lovecraftienne plane sur le monde: «Le monstre à tête de poulpe, Cthul, Das Kapital, Moloch, l’Entité, l’horreur glaciale et silencieuse, le fant.me de la Dame de fer qui a réduit des générations d’humains à l’esclavage.»
Dans cette obscurité demeurent toutefois la lumière de la vie, la chaleur de l’amitié et la littérature. Aussi féroce qu’il soit, le récit de Prunetti n’en est pas moins jubilatoire, drolatique et truffé de références. La working class que le narrateur fréquente s’avère remplie de figures grandioses. Pour conclure, j’évoquerai ainsi Brian, l’agent d’entretien qui débouche des latrines souillées et chante, brosse à chiotte en main, un air du Turandot (1926) de Puccini: «Dissipe-toi, ô nuit!… / Disparaissez, étoiles! / À l’aube je vaincrai».
Paul Kawczak, Lettres québécoises, no 192, printemps 2024.
 Mon compte
Mon compte