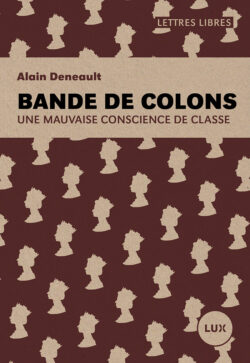Sous-total: $

Ni victimes ni bourreaux…
Gros colon. Maudit colon. Ostie de gros colon. Derrière l’insulte qu’on se lance à tour de bras se trouve une implacable réalité. Le Québécois est effectivement un « colon », au sens colonial du terme, et non pas un « colonisé », comme il se l’est longtemps fait croire. C’est du moins ce qu’affirme Alain Deneault dans Bande de colons, un essai aussi éclairant que divertissant, qui rétablit une part de notre récit national. Entrevue.
Q. Dans votre livre, vous faites une distinction très claire entre colon et colonisé. Contrairement à ce qu’on a souvent entendu, vous affirmez que les Québécois font plutôt partie de la première catégorie…
R. Je pense qu’on a été historiquement enfermés dans une dichotomie malheureuse qui présentait les acteurs des processus coloniaux comme étant des colonisateurs ou des colonisés. On s’est dit : puisque nous ne sommes pas colonisateurs, on est forcément colonisés, puisque les choses fonctionnent ainsi ! Mais il manquait un troisième terme, à savoir qu’on est principalement, pour la majorité d’entre nous, des colons… C’est un titre un peu difficile à porter, mais qui a le mérite de nous traduire plus justement au regard de l’histoire.
Q. Qu’est-ce qu’un colon pour vous ?
R. Le colon, c’est celui qui profite de la colonie, sans en être responsable. Sans en être le décideur, sans être l’instigateur, l’initiateur, le concepteur. Il est dans la colonie pour différentes raisons historiques. Mais il est ici comme un subalterne de l’œuvre coloniale et non comme une victime de la colonisation. Il ne s’agit pas de viser des gens, j’insiste sur ce point. Il s’agit de notre statut. C’est un statut objectif. Notre statut objectif, c’est d’être des sujets de Sa Majesté, ce qui est un euphémisme pour désigner un colon. C’est ce que nous sommes. Des sujets administrés.
Q. Des collaborateurs du grand projet colonial, en quelque sorte ?
R. Le mot collaborateur me semble trop fort parce qu’il est trop connoté en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Le colon peut certes s’identifier au plus fort. Tenter d’en partager les attributs. Mais sur un mode aliéné. Il reste toujours celui qui quémande un emploi et quelques avantages auprès de décideurs qui, eux, détiennent les leviers de l’administration et de la décision politique coloniale. Les colons sont des petites mains qui essaient de tirer leur épingle du jeu en se rendant intéressants pour le capital. En offrant de la force de travail.
Q. Ce qu’on comprend, c’est que nous ne sommes pas les victimes que nous pensions être.
R. Ni victimes ni bourreaux. Il s’agit simplement de penser rigoureusement ce qui fut et ce qui reste. Ce qui fut et ce qui reste, en ce qui concerne les Canadiens français, a pu être et peut être encore, lorsqu’il s’agit de décrire des situations dures, pénibles, souffrantes, violentes, un statut de prolétaire. Mais un colon prolétarisé n’est pas encore un colonisé. Un colonisé, c’est un sujet que, pour des raisons civilisationnelles, voire racistes, on isole dans des réserves comme un être à part. C’est une population totalement marginalisée qu’on ne veut pas voir. Le colonisé, c’est l’autochtone.
Q. Et les Canadiens anglais ? Sont-ils aussi des « colons » ?
R. Tout à fait. Ce que j’essaie de faire avec ce livre, c’est de briser une sorte d’impasse nationale qui nous empêche de voir aussi des réalités communes. Les Canadiens anglais sont largement des colons eux aussi. Ils n’ont pas la même histoire parce qu’ils ont fait partie, sur un plan culturel et communautaire, d’une famille qui avait un accès au pouvoir. Mais quand même, ce sont des colons qui ont beaucoup joué à être colonisateurs parce qu’ils parlaient la même langue que les maîtres.
Q. Vous dites colonisateur, vous pensez au Royaume-Uni ?
R. Est colonisateur quelque instance que ce soit qui a le pouvoir de façonner la colonie. C’est une minorité d’oligarques qui motive le projet colonial et en tire un profit concentré et capitalistique. Qui a un pouvoir d’accaparement, un accès aux richesses, au capital, aux paradis fiscaux, facilité par l’État. L’État est là pour permettre, faciliter, légitimer cette domination industrielle et bancaire.
Q. À quel moment, dans notre récit « national », avons-nous commencé à nous percevoir comme des « colonisés » plutôt que comme des « colons » ?
R. On peut le situer chez des penseurs comme André d’Allemagne, Raymond Barbeau, Pierre Vallière, Gaston Miron, jusqu’à Pierre Falardeau. Toute une génération de penseurs québécois qui, à une époque où l’on parlait beaucoup de décolonisation, se sont dit : « Nous aussi, nous sommes dans une situation de domination. » De ce moment d’indignation légitime sont apparus un certain nombre de termes qui me paraissent inadéquats.
Q. Il faut dire que « colon », ce n’est pas très glorieux. À vous entendre, c’est une position qui paraît quasiment moins noble que colonisé.
R. Non, ce statut n’est pas glorieux. On en a honte. On a honte de ne pas avoir été des dominants qui s’assument, qui ont rayé et conquis des mondes. On n’a pas été ça. Et on n’a pas, non plus, été de strictes victimes qui n’y pouvaient rien et qui étaient au moins du côté de la morale. On a été entre les deux et cet entre-deux est difficile à assumer. Il faut pourtant passer par une certaine honte pour s’affranchir du statut et se souhaiter autrement.
Q. Est-ce que le projet indépendantiste québécois aurait été une façon de s’en affranchir ?
R. Ma réponse est oui, tout en signalant que vous avez raison d’en parler au passé. Dans le sens où ce projet, s’il a à redevenir crédible, devra complètement se renouveler. Au vu notamment de la crise écologique dans laquelle nous sommes déjà et qui suppose une approche quant aux enjeux du monde tout à fait autre.
Q. Concrètement, vous pensez à quoi ?
R. Je ne suis pas un maître à penser. Mais il ne faut très certainement pas rester sur un régime dans lequel on nous réduit à aboyer pour avoir quelques emplois et je ne sais trop quels avantages en étant soumis et en faisant un X une fois tous les quatre ans pour un projet que des commentateurs vont commenter pour nous. Les conditions de possibilité du régime dans lequel nous sommes sont sur le point de devenir caduques.
Il faudra penser des formes politiques de souveraineté tout autres, qui ne seront plus de l’ordre d’un grand ensemble comme l’est le Canada. Le démantèlement du Canada n’est pas quelque chose d’inimaginable. Il s’agit de penser des modes d’organisation sur des échelles sensées, plus régionales, qui supposent une réelle participation démocratique.
Entretien avec Jean-Christophe Laurence, La Presse, 4 octobre 2020
Photo: Hugo-Sébastien Aubert, Archives La Presse
 Mon compte
Mon compte