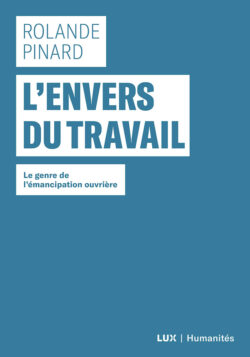Sous-total: $
«L’envers du travail» dans la Nouvelle Revue du travail
L’ouvrage propose de retracer l’histoire des luttes et de l’émancipation ouvrières, depuis la « première révolution capitaliste » aux xviiie et xixe siècles jusqu’aujourd’hui, en adoptant une lecture genrée, attentive aux différences de places et de mobilisations des femmes et des hommes.
Rolande Pinard commence par définir son cadre analytique et conceptuel. Elle distingue ainsi quatre sens de la catégorie travail : le travail-activité, moyen de production ; le travail marchandise, la force de travail qui se vend et s’achète sur le marché ; le travail-moyen de subsistance ; et enfin le travail-force sociale et politique collective.
Ainsi outillée, elle déroule sa lecture de l’histoire du travail ouvrier et de sa mobilisation, en s’appuyant principalement sur les cas de l’Angleterre et des États-Unis, pour les périodes anciennes, et sur la France et les débats français à partir des années 1950.
Une première partie s’intéresse à « La première révolution capitaliste, un prolétariat féminin ».
Si l’idée d’indépendance acquise par le travail repose sur la conception bourgeoise d’un travail « libre » parce que dégagé des liens de servitude et de dépendance de l’Ancien Régime (« liberté de contrat »), avec la mécanisation liée à la révolution industrielle, la production s’organise dans des fabriques et le marché « libre » laisse la place à l’enfermement entre les murs d’un propriétaire privé. Ainsi, sous le régime du travail-marchandise, les travailleuses et travailleurs sont formellement « libres » (la liberté bourgeoise de contrat), tandis que, sous le régime du travail-activité, elles et ils sont assujettis à un employeur. Et c’est désormais le propriétaire capitaliste qui définit le type d’organisation du travail et les nouveaux métiers qu’il requiert.1 Bien qu’elle ne l’explicite pas, Rolande Pinard utilise le terme de communauté issue de la traditio (…)
Dans cette première révolution capitaliste, la mécanisation permet l’embauche massive de femmes et d’enfants. En même temps, se met en place une hiérarchisation du salariat car, sur les nouveaux métiers, sont recrutés des hommes qui ont un statut contradictoire de force de travail et de collaborateur du capitaliste, une double identité d’ouvrier et de petit maître. Dans cette hiérarchisation, les sans-métiers sont exclus du pouvoir de l’atelier : femmes, enfants et hommes ayant perdu leur ancien métier ou n’en ayant jamais eu. Pour l’auteure, cette organisation du travail, créée par les capitalistes, prolonge dans le salariat la division sexuelle du travail qui prévalait dans la production domestique. Avec une différence essentielle : l’absence de la solidarité qui rassemble les communautés domestiques1. Or, à ses yeux, les formes de participation des femmes aux luttes rassemblant des communautés solidaires ont une dimension émancipatrice nettement supérieure à celles centrées sur le travail-activité qui hiérarchise et divise. La mobilisation du mouvement ouvrier nait de la conscience de classe des salarié·e·s, ancrée dans les solidarités élargies, ce que le syndicalisme a perdu de vue en s’enfermant dans la production et les métiers.
À la fin de cette première période, le constat est double : d’une part, les hommes se sont organisés sur la base du métier et du sexe ; et, d’autre part, les femmes n’ayant pas accès aux « métiers », elles ont été exclues de la lutte capital-travail, tout en participant aux collectifs créés lors des luttes qui rassemblent des communautés solidaires.
Une deuxième partie examine « La deuxième révolution capitaliste, l’emploi masculin ».
Le début du xxe siècle voit l’avènement d’un capitalisme monopolistique, fondé sur de grandes entreprises de production de masse, qui s’accompagne d’une révolution managériale : avec la séparation de la propriété et du contrôle, c’est le management salarié qui se substitue à l’entrepreneur dans les décisions d’organisation du capital et du travail. Le travail-activité devient l’affaire des experts et la parcellisation des tâches brise les métiers. Le travail-marchandise, propriété ouvrière se négociant sur le marché, est remplacé par l’emploi défini par le management. Et, dès les années 1920-30 aux États Unis, la création de marchés internes, destinés à s’attacher une main d’œuvre volatile en échange d’une certaine sécurité, signe la dépendance du salarié vis à vis de l’employeur : le régime de l’ancienneté met en avant l’appartenance à un employeur/une entreprise. Le syndicalisme de métier laisse la place à un syndicalisme d’entreprise, voire d’établissement, instauré par la loi Wagner de 1935 et renforcé par le Labor Management Relations Act de 1947.2 Je pense ici au Royaume Uni et à la règle du marriage bar impliquant que les femmes renoncent à leu (…)
L’emploi des employeurs remplace ainsi le travail des travailleurs. Mais les marchés internes ciblent une main d’œuvre masculine : les femmes sont censées quitter l’entreprise une fois mariées2 et n’ont donc pas accès à l’ancienneté. Ainsi, dans ses entreprises, en cas de doute, Ford mandatait des enquêteurs chargés de vérifier le statut matrimonial de ses employées. En fait, l’entreprise est vue comme une communauté, source d’une « citoyenneté industrielle » et des bénéfices qui vont avec – la protection sociale attachée à l’entreprise du welfare capitalism –, communauté à laquelle les femmes n’appartiennent pas vraiment. Aussi les syndicats sont-ils peu ouverts voire fermés aux femmes.
Une troisième partie est consacrée à « La globalisation capitaliste et l’autre féminisation du travail ».
Rolande Pinard traite de la période actuelle et de ses implications sur le travail et l’emploi, en dialoguant, en particulier, avec l’expérience et la sociologie du travail français.
La phase actuelle de globalisation capitaliste est marquée par la financiarisation du capital, la désintégration verticale et le transfert de pans entiers de l’activité à des sous-traitants avec, pour corollaire, la transnationalisation de la concurrence entre salariés et une généralisation de la précarisation. « L’autre féminisation du travail » exprime l’idée que, dans ce nouveau cadre, l’érosion de la force collective des hommes les ramène au statut précaire des femmes salariées.
En reprenant sa distinction entre le travail-activité – effectué dans le cadre privé de l’entreprise – et l’emploi – création des employeurs, dont l’exercice est soumis à leurs décisions à moins de contraintes légales –, l’auteure voit dans la précarisation actuelle de l’emploi un accroissement du pouvoir de décision des employeurs et une érosion des contraintes légales – bien loin d’un retour au « libre » marché du travail.
Cette partie présente en particulier un débat avec une sociologie française des années 1970 qui s’est intéressée à la qualification du travail parce qu’elle voyait dans la maîtrise du procès de travail une récupération du pouvoir ouvrier, occultant l’appropriation du travail par le management. Cette réflexion amène Rolande Pinard à poser la question : les travailleuses et travailleurs peuvent-elles/ils, doivent-elles/ils3 se réapproprier le travail ? Reconquérir ses sens perdus ? Rejetant une définition de la qualification liée aux individus et au contenu concret de leur activité, elle y voit le résultat d’un rapport de force, de revendications et de luttes. C’est un mécanisme intégrateur, car il se moule dans les exigences de l’organisation et, en même temps, diviseur parce qu’assujetti à la hiérarchisation du travailleur collectif créé par la division technique du travail.
Au bout du compte, « la qualification est une représentation sociale des rapports de pouvoir qui a peu à voir avec le contenu de l’activité » (p. 242). Aussi, « il n’est pas suffisant de constater que la qualification est genrée pour la déconstruire car c’est le pouvoir qui est genré » (p. 238).
Pour Rolande Pinard, c’est la maîtrise du temps qui est le véritable enjeu du pouvoir, c’est elle qui apporte un espace d’autonomie – même infime – dans l’accomplissement de son travail, pas la qualification qui est une forme de participation au procès de travail. Or la précarisation des emplois renvoie à une utilisation maximale du temps des salarié·e·s, qui ne sont convoqué·e·s et payé·e·s que pour les périodes effectivement travaillées. Elle a pour corollaire l’intensification du travail et la réduction des emplois. Pour limiter les pertes, les syndicats – en France après les États Unis – ont négocié la préservation de l’emploi contre la flexibilité et, en particulier, abandonné les revendications de limitation du temps de travail sur la journée ou la semaine, au profit de l’année et même de la durée de vie (retraite). Avec l’annualisation du temps de travail, l’intensification, la flexibilité et la précarisation des emplois, on assiste à une « colonisation du temps hors travail […] exigence de l’organisation capitaliste qui doit s’étendre à la sphère domestique et se diffuser dans toute la société pour se maintenir et se développer » (p. 282). « Le capitalisme d’organisation a fini par embrigader totalement l’individu qui lui est assujetti en déterminant tous les aspects de sa vie. C’est cet embrigadement qui est politiquement paralysant, pas la précarité » (p. 291).
Mais les luttes pour la maîtrise du temps de travail n’ont pas eu le même sens pour les ouvriers et les ouvrières : pour les premiers, elles ont été des luttes pour la liberté – s’évader des murs de l’entreprise – et pour la citoyenneté – apparaître dans la société ; pour les secondes, elles visaient l’aménagement de la double journée de travail et débouchaient sur une double oppression. Ainsi, la conciliation travail-famille, présentée comme une amélioration de la condition des femmes, témoigne d’un renforcement des oppressions patriarcales et salariales. Comme toutes les lois « protectrices » du travail des femmes qui, en leur permettant de concilier travail et obligations familiales, visent à sauvegarder leur statut domestique.
Enfin, examinant les luttes actuelles, Rolande Pinard s’intéresse à « la revanche des précaires », titre du dernier chapitre. Après la disparition des syndicats de métiers et la mise à mal du syndicalisme d’entreprise, en France comme aux États-Unis, les précaires renouvellent les formes de luttes en élargissant les solidarités à d’autres groupes sociaux. Citant les mobilisations dans le secteur des services (aides à domicile, caissières d’hypermarchés, femmes de ménages dans l’hôtellerie), elle y voit un retour à cette forme traditionnellement féminine de mobilisation collective ancrée dans la communauté4, tandis que les hommes se sont concentrés sur le milieu de travail et le travail qualifié. Et elle souligne le faible soutien syndical à ces mobilisations en France, au contraire des États Unis où un syndicat s’est constitué dans le secteur des services, dès les années 19805.
Pour conclure, essayons de re-tirer les fils conducteurs de cet ouvrage, très dense voire touffu, au regard du rapport entre travail et émancipation ouvrière. Spécifier la cible ouvrière est important, car c’est la problématique de l’émancipation des classes laborieuses, des travailleurs qui intéresse ici Rolande Pinard. D’autant que, s’agissant du xixe et début du xxe siècle, elle voit une différence radicale entre les femmes des classes moyennes et bourgeoises, dépendantes d’un homme et enfermées dans la sphère privée domestique, et les ouvrières, investies dans un mode de vie collectif, imbriquées dans une communauté.6 Rancière Jacques, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004 [1998].
S’appuyant sur Jacques Rancière6, elle distingue ensuite l’émancipation par le travail et l’émancipation des travailleurs et travailleuses. À ses yeux, il n’y a pas d’émancipation par le travail en tant qu’activité rémunérée, ce qui est cohérent avec ses prémisses selon lesquelles le travail-activité est approprié par l’entreprise et le travail-marchandise s’est dissout dans l’emploi des employeurs. Et c’est dans la « sortie d’une minorité » (J. Rancière) et l’appartenance à une société dans un espace commun que peut émerger l’émancipation des travailleurs·euses. Ainsi, ce qui libère, « c’est la volonté collective d’émancipation du rapport d’exploitation et l’action sociale et politique que cette dernière suscite » (p. 356). Or, « le rôle des femmes dans l’histoire des transformations du travail montre qu’elles ont su agir collectivement sur des bases plus larges que les hommes, puisqu’elles ont été graduellement enfermées dans le milieu de travail, comme eux, là où l’agir politique est neutralisé » (p. 352). Rolande Pinard souligne ainsi que c’est en portant l’attention sur l’histoire du travail des femmes qu’elle a compris que « la conscience de classe ne s’acquiert pas par le travail, mais dans les luttes pour exercer les droits et libertés reconnus par une communauté politique » (p.354). C’est pourquoi elle différencie mouvement ouvrier et syndicalisme.
Au total, la lecture de cet ouvrage est extrêmement stimulante en ce qu’elle oblige à revisiter, repenser les différentes facettes et formes d’articulation entre travail, emploi, organisation et régulation du travail, et où et comment elles s’ouvrent à l’émancipation et à la liberté des travailleurs et des travailleuses. Ici la réponse de l’auteure est claire et nette : ce n’est pas l’activité rémunérée qui est source d’émancipation, de liberté, mais l’action politique qui sort les individu·e·s du milieu de travail – marqué par l’enfermement et la subordination – pour leur permettre de prendre place dans la société en tant que communauté. Ainsi ce sont les mouvements féministes des années 1960 et 1970 qui ont fait avancer la société vers plus de liberté et d’égalité pour les femmes, pas leur accès au travail rémunéré.
Cette thèse peut évidemment être discutée. Car dans nos sociétés modernes, « libérales », la citoyenneté est fondée sur la reconnaissance de la liberté de l’individu. Plus encore, dans l’architecture politique construite par la philosophie des Lumières, c’est sa liberté qui définit l’individu. Cette liberté se définissant comme la propriété de sa propre personne, de son corps (habeas corpus) ; par son autonomie par rapport à un « corps » social qui définirait a priori une « condition » ; et enfin par son autonomie économique. À cet égard, l’autonomie économique a longtemps été fondée sur la propriété et l’individu-citoyen était un propriétaire. Aujourd’hui, c’est l’activité rémunérée qui assure cette autonomie. En ce sens, il est difficile de soutenir qu’avoir une activité rémunérée n’a pas de lien avec la liberté et la pleine citoyenneté. En même temps, la forme dominante de la relation de travail étant le lien salarial de subordination, il est tout aussi difficile d’affirmer qu’elle est gage de liberté : on touche ici à la contradiction structurelle de nos sociétés salariales…Haut de page
Notes
1 Bien qu’elle ne l’explicite pas, Rolande Pinard utilise le terme de communauté issue de la tradition anglosaxonne des Community Studies qui définit un regroupement de personnes autour de valeurs, de traits culturels ou d’intérêts communs. Ici elle se réfère plutôt à la famille comme communauté.
2 Je pense ici au Royaume Uni et à la règle du marriage bar impliquant que les femmes renoncent à leur emploi une fois mariées : défendue dès la deuxième moitié du xixe siècle par les syndicats et les employeurs, elle n’a été supprimée progressivement qu’à partir des années 1940, perdurant dans certains secteurs jusque dans les années 1960.
3 Rolande Pinard utilise très systématiquement l’écriture inclusive.
4 Cf la note 1 sur les Community Studies où « communauté » apparaît comme un terme générique. Ici l’auteure se réfère plutôt au quartier (comme c’est fréquent en sociologie urbaine : cf. la recherche classique de Michael Young et Peter Willmott, 1983 [1957], Le Village dans la ville, Paris, Centre Georges-Pompidou) mais ce pourrait être aussi des communautés d’appartenance culturelle.
5 Le Service Employees International Union.
6 Rancière Jacques, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004 [1998].
Anne-Marie Daune-Richard, Nouvelle Revue du travail, no 15, 1er novembre 2019
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte