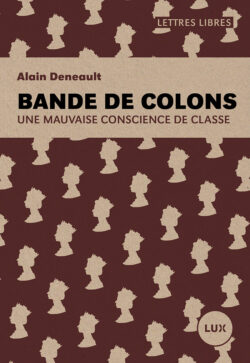Sous-total: $

Il manque à la conscience politique au Canada une pensée sur le statut de colon
Pour qui s’intéresse à l’histoire et au développement de l’entité politique a mari usque ad mare nommée Canada, le nom d’Alain Deneault n’est pas inconnu. Deux ouvrages de lui ont particulièrement retenu l’attention de la presse et des lecteurs/lectrices : Noir Canada (Écosociété, 2008) et La médiocratie (Lux, 2013). Noir Canada (en collaboration avec Delphine Abadie et William Sacher) analyse le comportement des minières canadiennes en Afrique ; le verdict ne peut laisser indifférent : les minières canadiennes en Afrique pratiquent le pillage, la corruption et que sais-je encore de la même veine. L’ouvrage n’allait pas laisser indifférentes les minières passées au crible. Barrick Gold lançait en 2008 une poursuite de six millions de dollars contre l’ouvrage et son éditeur, Banro, une poursuite de cinq millions. Quand on connaît les ressources limitées d’Écosociété, on sait bien qu’il s’agit, restons-en à celle de Barrick Gold, d’une poursuite-bâillon. Ce que la juge Guylaine Beaugé de la Cour supérieure du Québec reconnaît en 2011 : la poursuite représentait des apparences d’abus (voir https://www.pressegauche.org/Le-jugement-dans-l-affaire-Barrick-Gold-vs-Ecosociete-un-pas-en-avant consulté le 16 décembre 2021). Depuis 2009 pourtant, une loi québécoise devait limiter ces abus (lire https://soquij.qc.ca/fr/ressources-pour-tous/articles/le-code-de-procedure-civile-et-la-fin-des-poursuites-baillons Consulté le 16 décembre 2021) ; et si une entente « à l’amiable » intervient entre Barrick Gold et Écosociété en 2011, elle stipule entre autres que « Écosociété doit cesser la publication et l’impression de l’ouvrage» (voir https://www.ledevoir.com/societe/333952/noir-canada-entente-entre-barrick-gold-et-ecosociete consulté le 16 décembre 2021). Barrick Gold est une aurifère — « le silence est d’or » reste en vigueur.
La médiocratie. Les mots à terminaison en –cratie étaient déjà assez nombreux, ploutocratie, aristocratie, démocratie, méritocratie, entre autres, et voilà que Deneault leur ajoute une collègue, la médiocratie, fier mot-valise qui conjoint médiocrité et l’un des systèmes de gouvernement en –cratie, pour nous fournir un terme dont la définition est donc « l’incarnation de ce qui est moyen » (le « médio » de médiocre signifiant étymologiquement « moyen ») ; or « à force de nous maintenir dans la moyenne, on devient insignifiants » (voir cet entretien avec Alain Deneault, https://www.lapresse.ca/arts/livres/entrevues/201511/26/01-4925011-alain-deneault-la-mediocratierend-mediocre.php Consulté le 16 décembre 2021). La médiocratie, c’est comme une sorte de systémisation de la médiocrité, une forme de gouvernement ayant comme visée de mener une politique d’égalisation des têtes, de médiocriser son monde ; dans l’histoire du pays, devenue plutôt l’entreprise ainsi que décrite par Deneault, « l’entreprise Canada », on peut lire, peu de phrases après les deux données ici en épigraphe : « Le Canada surgit de cette histoire plutôt insignifiant. » Quand on sait, ayant lu la quatrième de couverture de Bande de colons, que « [l]e décor où Alain Deneault campe son personnage : le Canada » pratique ce qu’il nomme une politique d’« extrême centre », on se rappelle le proverbe latin in medio stat virtus, la sagesse se situe au milieu, au centre en termes politiques d’opposition entre la gauche et la droite (extrêmes ? au Canada ?).
L’intitulé des cinq premiers chapitres de Bande de colons souligne déjà bien clairement les trois mots dont l’ouvrage va jouer : « Le colon travesti en colonisateur », « Le colonisé travesti en colon », « Le colon travesti en colonisé », « Le colonisateur travesti en colon », « Un colon sans colonisateur ? » ; le vocable « travesti », dont la composition faite de « tra ou trans », changement, et de « vestire », vêtir, changement de vêtement, d’apparence donc, vient de l’italien travestire, « déguiser », sert de clavier pour le jeu, dièse et bémol, plaisir et tromperie, du trio des termes en « colon » simple ou avec ajouts en « -isateur » et « -isé ».
Dès le début du chapitre premier, Deneault écrit : « […] il manque à la conscience politique au Canada une pensée sur le statut de colon, qui fut ici celui de la majorité. Et qui le reste de mille façons inavouées » (Deneault souligne). L’absence de « pensée sur le statut de colon » explique que ce colon « peut vivre sa vie comme un colonisateur et exalter de manière triomphante le racisme à l’origine de la colonie » que le « fait de s’ériger en serviteur de ces puissants, qui plus est sur la base d’une appartenance vaguement ethnique au nous européen, peut justifier un curieux sentiment de supériorité ». Raison pour laquelle ledit colon « vit en décalage avec son climat » […], car le Canada aurait grand intérêt à n’être plutôt qu’une sorte de « Californie avec de la neige », par exemple ; raison pourquoi « les colons du Canada oeuvrent à spolier les terres où ils se trouvent plutôt que de s’y laisser saisir par leur organicité » ; pour tout dire, « [l]e sens de l’État se réduit à un sens des affaires ». Puisque le statut du colon est si mal cerné, il importe de rajuster le tir, de mieux harmoniser le jeu.
Dès lors, c’est le très célèbre et très célébré Portrait du colonisé précédé de Portrait du colonisateur d’Albert Memmi, précédé d’une préface de Jean-Paul Sartre, que Deneault va analyser et discuter. Car s’il y a bien, dans la colonie franco-anglaise, un colonisateur et un colonisé selon Memmi et Sartre, il faut bien qu’il y ait un colon – mais où donc se trouve-t-il pour qu’il n’en soit pas question ? Répétons : « Il manque à la conscience politique au Canada une pensée sur le statut de colon, qui fut ici celui de la majorité. »
Les colonisateurs premiers, en Nouvelle-France puis au Canada, ce furent donc la France puis l’Angleterre ; ces deux pays, l’un après l’autre, s’étaient approprié ou avaient conquis une colonie dont ils voulaient exploiter les richesses (la traite des fourrures d’abord et au premier chef). Pour assurer cette entreprise, il fallait assurer sa domination et sa maîtrise sur le territoire de la colonie : les habitants d’origine du territoire n’avaient qu’à se soumettre, les colonisateurs disposant de moyens matériels supérieurs pour les mater en cas de résistance. Tel est le colonisateur : il s’impose, au mépris de ceux chez qui il vient d’arriver, il fait d’eux des inférieurs à… évangéliser. Les avatars du colonisateur premier, administrateurs divers, chefs de grandes entreprises, actionnaires de celles-ci, etc., vont continuer et prolonger, sous bien des travestissements, l’entreprise colonisatrice. Les colonisés d’Amérique, ceux qui perdent leur territoire et leur mode de vie et tombent sous la coupe d’un maître étranger, puisque tel est le programme prévu de l’entreprise coloniale, ce sont les Autochtones. Eux et eux seuls ont été dépossédés de leur territoire et ont dû se soumettre à un système de valeurs en totale discontinuité avec leur histoire et leurs traditions. Le Québec et ses habitants, alors, pas des colonisés ? Alors que les thèses de Memmi ont eu ici tant d’écho, sinon même tant d’adeptes ?
« La situation québécoise appelle toutefois des distinctions supplémentaires pour s’y retrouver dans la chaîne colonisateur-colon-colonisé. » Ces distinctions, Deneault les explicite dans les lignes qui suivent que nous nous permettons de citer un peu longuement.
Le colonisé se distingue du colonisateur par son appartenance à la civilisation lésée. Le colon par sa faible position hiérarchique au sein même de la civilisation du colonisateur. Le colonisé amérindien a vu son territoire spolié et sa culture violée dans son esprit. Le colon canadien-français a été abusé comme exécutant dans l’exercice de cette spoliation. Bien sûr, ce dernier a souffert de voir son « chez-nous » occupé militairement, économiquement et politiquement par une administration coloniale conquérante. Mais la désignation de cet espace national comme « sien » témoigne déjà du double statut du colon prolétaire, un peu « chez lui » du fait de son appartenance à la civilisation blanche, mais incapable de jouir à part entière de cet espace qu’il voudrait souverainement occuper.
Rien à redire, au contraire ; sauf peut-être pour suggérer une nuance à l’affirmation « du fait de son appartenance à la civilisation blanche », vers la fin de la citation, « distinction raciste » écrit Deneault tout juste après. En quoi il faut dire que s’il a raison au vu de son argumentation, celle-ci a peut-être une faille ; au « du fait de son appartenance à la civilisation blanche », il faudrait peut-être ajouter « du fait de son droit de premier colon/colonisateur occupant », et alors la « distinction raciste » renverrait à une opposition entre premier et second colon/colonisateur de civilisation blanche.
On comprend fort bien, tout cela étant, qu’entre colonisateurs (on pourrait dire : entre le 1 % de la population qui dispose d’un pourcentage disproportionné du PIB du pays) et colonisés, soit un groupe numériquement réduit d’Autochtones, 5 % de la population, environ, sauf que ce groupe, grossières erreurs des Blancs et reconnaissance forcée par ceux-ci de leurs bavures, dispose soudain en 2021-2022 de bien du vent dans les voiles et d’une grande erre d’aller, enfin – entre colonisateur et colonisé, il y a toujours le groupe le plus important de la population, la « bande de colons » du titre. Les colons constituent donc la grande majorité, 75 % de la population : tous ces gens qui, ainsi que dans toute colonie, de peuplement ou autre, travaillent pour le plus grand profit des colonisateurs ; figurants qui rêvent de se rapprocher de la classe dominante, classe moyenne qui croit que son statut va toujours s’améliorer, qui regarde de haut les moins nantis et qui a bien peu d’égards pour les colonisés.
L’intérêt commun des colonisateurs et des colons canadiens ? L’enrichissement financier ; celui de l’entreprise des maîtres grâce au travail des colons, celui de ces derniers, soit les retombées de miettes du profit de l’entreprise. Dans le Dominion du Canada, la majorité des grandes entreprises sont d’origine britannique ou états-uniennes ; il n’est pas exagéré de dire que « l’entreprise Canada » est toujours une colonie anglo-saxonne dont la construction d’un chemin de fer unificateur constitua le début moderne, dont l’achat d’un oléoduc constitue aujourd’hui le déchirant symbole d’une unité toujours fuyante ; les colons et les colonisés auraient vastes intérêts à tirer dans le même sens face aux colonisateurs, sauf que les colons tiennent à ne pas mettre leurs miettes en péril.
Les trois derniers chapitres de l’ouvrage, dès leurs intitulés, ne permettent aucun jeu de concessions : « L’Irvingnie une colonie dans la colonie », « Histoire et mauvaise conscience de classe », « Démanteler le Canada ». L’Irvingnie ? J’ai étudié pendant six ans au collège de Bathurst (N.-B.), et Deneault enseigne à l’Université de Moncton à Shippagan : pour lui encore bien plus que pour moi, l’Irvignie est un pays bien connu dont l’identification est claire et ne supporte pas l’ombre d’une hésitation. L’Irvignie, c’est le pays de (ou selon) K. C. Irving (1899-1992) et de ses descendants ; l’Irvignie, c’est comme un autre nom, fondé sur le principe de réalité, pour la province canadienne officiellement nommée Nouveau-Brunswick.
Ladite province fut découpée dans l’ancienne Acadie pour accueillir les Loyalistes, restés fidèles à la Couronne anglaise, qui fuyaient la guerre d’Indépendance des colonies britanniques sur le point de devenir les États-Unis. Réfugiés en Angleterre au Canada, ils y seraient reçus royalement. Entre Acadiens déportés et Anglo-Saxons déporteurs devenus exilés, l’entente, l’unité ne relèvent surtout pas de l’évidence au N.-B. L’Irvignie, c’est l’entreprise Irving (pétrolière, forestière, industrie maritime, médias, sports) dont les tentacules circonscrivent le N.-B. et font de ce dernier la chasse-gardée Irving. Le premier ministre actuel du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a été cadre chez Irving Oil pendant trente-trois ans ; il a quitté Irving en 2010, est devenu premier ministre en 2018, comme qui dirait, question de se souvenir des leçons apprises. Le Nouveau-Brunswick ou Irvignie, un mini Canada enchâssé dans le grand pays, une colonie loyaliste dans la colonie britannique. (Peut-être est-ce le moment de souligner que le titre du chapitre qui précède « L’Irvignie » se lit ainsi : « Un Congo de Léopold II réussi ».) Un seul homme du Nouveau-Brunswick a tenu tête à K. C. Irving qui s’est même mué en homme politique aux fins de mettre un holà aux mesures sociales du chef libéral : un Acadien, Louis J. Robichaud, que nous appelions affectueusement Ti-Louis, puisqu’il était un ancien du collège de Bathurst. Irving, politicien, n’était pas de taille à lutter contre Robichaud, il l’apprit à ses dépens (voir Michel Cormier, Louis Robichaud. La révolution acadienne, Montréal, Leméac, 2004).
Pourquoi donc se faire croire qu’on est autre de ce qu’on est ? Pourquoi la « mauvaise conscience » soulignée dans le titre du chapitre suivant « L’Irvignie » ?
Pourquoi céder à une conscience factice de soi ? […] Il vaut mieux continuer à nous imaginer les champions d’un festival de hockey ou les égaux d’une chanteuse multimillionnaire à succès et d’un coureur unijambiste que de nous reconnaître comme les ouvriers que nous sommes d’une architecture impérialiste qui a activement participé dans l’histoire au pillage irresponsable des richesses naturelles, à la pollution irréversible de sites écologiques entiers et à l’extermination presque accomplie de peuples jadis intégrés à un monde qu’on a contribué à enlaidir.
Peut-on nier la véracité historique des faits évoqués, en toute conscience bonne ? Voilà pourquoi il faut « Démanteler le Canada » qui « n’est pas un pays, mais un ensemble de terres que se disputent des propriétaires et un droit foncier qui favorise ceux qui peuvent faire partie de la caste ». Seul un symbole transcendant coiffe cette réalité, la « Couronne », qui confère une légitimité royale à ce dépeçage sans grâce du territoire.
L’histoire de « l’entreprise Canada » n’est guère réjouissante, au bout du compte, sinon pour quelques-uns et leurs propres entreprises commerciales ; il faut repenser l’avenir canadien en usant d’une grande « puissance d’imagination » plutôt qu’en suivant « un paradigme sans avenir », celui qui condamne à la « conscience factice de soi ».
Renald Bérubé, University of Toronto Quarterly, vol. 91, no 3, août 2022.
 Mon compte
Mon compte