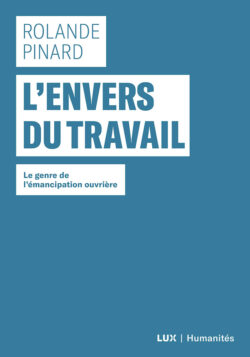Sous-total: $

«Les hommes n’ont pas dominé la construction du mouvement ouvrier»
Entretien avec Rolande Pinard, auteur de L’envers du travail. Le genre de l’émancipation ouvrière (éditions Lux), dans lequel elle revient sur les transformations qu’a connu le travail depuis la révolution industrielle à travers le rôle central et méconnu qu’y ont joué les femmes.
Rolande Pinard est sociologue. Elle a pratiqué la sociologie du travail en milieu syndical puis la sociologie de l’emploi comme chercheure indépendante. Forte d’un premier ouvrage sur l’histoire sociologique des transformations du travail intitulé La révolution du travail. De l’artisan au manager (éditions Liber, 2000), elle renouvelle sa démarche en l’axant cette fois sur le rôle méconnu et primordial qu’y ont joué les femmes. L’envers du travail. Le genre de l’émancipation ouvrière se présente comme une analyse historique centrée dans un premier temps sur les sursauts politiques suscités par la révolution industrielle en Grande-Bretagne, puis sur l’essor du syndicalisme aux Etats-Unis au début du XXe siècle. La sociologue montre que les femmes ont été les initiatrices de la résistance première au capitalisme industriel et à l’expansion du marché lors des food riots, les émeutes de la faim. C’est à partir des premières lois protectrices (réduction du temps de travail journalier, salaire minimum…) soumises à un modèle patriarcal qu’elles ont ensuite été reléguées hors des luttes, notamment celles des syndicalistes. Si les femmes sont depuis rentrées massivement sur le marché du travail, c’est du fait d’une nouvelle précarisation (frontières plus poreuses entre sphères productive et domestique, développement des contrats à temps partiel et d’intérim…). Rolande Pinard montre dès lors que les victoires remportées pour les droits des travailleurs sont relatives, et pointe la nécessité pour eux de s’unir autour de luttes communes contre un système visant à les diviser.
Quel a été l’objectif de votre ouvrage?
Rolande Pinard – J’ai voulu comprendre la transformation des sens du travail, depuis la révolution industrielle anglaise. J’avais fait l’exercice pour les hommes, dans un ouvrage publié en 2000. Vu l’ampleur de la tâche que je m’étais donnée, j’ai alors décidé de ne tenir compte que de l’expérience d’hommes, ceux qui ont dominé le mouvement ouvrier et le syndicalisme dès le départ. Au cours des années 2000, j’ai décidé de compléter l’analyse du point de vue des femmes – les ouvrières, les femmes des classes laborieuses – car je ne pouvais prétendre comprendre vraiment la transformation des sens du travail sans elles, sans tenir compte de leur expérience, de leur rôle et de leur place dans ces transformations.
Dans l’analyse historique que vous présentez, il apparaît que les femmes ont joué un rôle de résistance aux changements induits par la première révolution industrielle et l’expansion du marché. En avez-vous des exemples?
Ce sont des femmes des classes laborieuses qui ont pris l’initiative des émeutes de la faim qui ont accompagné la transformation du marché au cours du XVIIIe siècle, au cours de laquelle les échanges marchands se sont intensifiés tandis que l’économie a pris une existence nationale. Dans ce processus, les marchés locaux où acheteurs et vendeurs se rencontraient pour l’échange, associés à «l’économie du pauvre» par l’historien anglais E.P. Thompson, ont été envahis par les gros négociants. Cela a entraîné l’augmentation des prix des biens essentiels à la subsistance, d’où les émeutes de la faim, lancées par des femmes parce qu’elles étaient traditionnellement responsables de nourrir la famille. Elles étaient donc directement confrontées aux transformations du marché et à leurs effets sur leur subsistance. Mais leur résistance n’était pas qu’une affaire de subsistance ; elle présentait un caractère politique car cette transformation du marché venait abolir des droits reconnus sous l’Ancien Régime.
Il apparaît en vous lisant que les femmes travaillaient déjà alors que la production se faisait au sein de la sphère privée. Avaient-elles plus de pouvoir?
Il existait alors une nécessaire solidarité familiale, une interdépendance des membres de la famille des classes laborieuses pour leur survie. L’idéologie patriarcale et le système juridique qui la concrétise y étaient agissants, mais de manière moins marquée peut-être à cause de cette interdépendance, absente dans les classes supérieures où les femmes étaient totalement dépendantes de leur père ou mari.
En quoi le point de vue adopté a t-il remodelé votre manière d’aborder l’histoire des luttes des mouvements ouvriers?
L’histoire des luttes qui fait apparaître les femmes montre que les hommes n’ont pas dominé la construction du mouvement ouvrier, que des femmes y ont participé au moins à égalité avec les hommes. C’est par la suite que les femmes ont été exclues ou marginalisées dans les formes de syndicalisme qui ont suivi. Le mouvement ouvrier se distingue du syndicalisme. Le fait de tenir compte de la participation des femmes expose clairement cette distinction : le mouvement ouvrier a été construit par la solidarité de toutes les couches du prolétariat – ouvriers de métier, hommes et femmes sans métier, enfants, ménagères – et c’est ce qui en fait un mouvement d’émancipation, alors que le syndicalisme qui a suivi a été une association exclusive par métier, réservée à des hommes, centrés sur leur activité. Dans la seconde période historique analysée, que je situe aux États-Unis au tournant du XXe siècle, le fait de tenir compte des travailleuses, de leurs formes de luttes différentes de celles des hommes de métier, fait ressortir la radicalité du changement lié à la législation de 1935 qui imposait la syndicalisation par entreprise : les travailleurs étatsuniens feront désormais cause commune avec leur employeur plutôt qu’avec leurs semblables dans la communauté.
A t-il été facile d’avoir accès à ces données sur la participation des femmes aux luttes socio-politiques pour l’acquisition de leurs droits?
Oui, car j’ai pu profiter d’un courant de l’histoire du travail qui fait apparaître des femmes. C’est un courant relativement récent – qui s’est développé depuis les années 1980. Sans ces historiennes, je n’aurais pu réaliser ce deuxième ouvrage. J’ai une dette immense envers elles que je reconnais par les longues notes de bas de page et la longue bibliographie. Pour répondre à votre question, la plupart d’entre elles soulignent en effet la difficulté de procéder à l’analyse historique qui les intéresse compte tenu de la rareté des sources contemporaines de la période étudiée.
Il y a selon vous un lien indissociable entre la sphère familiale et la sphère industrielle. Lequel?
Dans mon premier ouvrage, je montre que le capitalisme industriel présente dès le départ une logique d’organisation qui doit être diffusée dans la société pour l’actualiser, à commencer par la famille. Dès l’apparition du capitalisme industriel, nous avons le témoignage d’un propriétaire de fabrique (Robert Owen) qui voit la nécessité d’éloigner les enfants de leur famille, dans les classes laborieuses, pour qu’on leur inculque la discipline et l’importance d’un mode de vie respectueux des exigences du nouveau système industriel.
À chaque période historique, nous retrouvons des représentants de la classe capitaliste qui cherchent à modeler la famille ouvrière afin qu’elle prépare et entretienne une main-d’œuvre régulière, disciplinée, soumise. L’un des plus célèbres est Henry Ford, au début du XXe siècle, qui adopte sa politique des 5$ par jour afin de fidéliser sa main-d’œuvre, de l’américaniser (70% étaient des immigrants récents). Pour obtenir ce salaire élevé pour l’époque, il fallait se conformer au mode de vie décidé par Ford : femme au foyer, épargne, interdiction de tenir pension… Des enquêteurs allaient vérifier sur place la conformité des travailleurs aux diktats de Ford. Aujourd’hui, l’intérêt croissant des employeurs pour la conciliation travail-famille obéit à une semblable logique d’invasion du domicile pour favoriser la production au travail.
Le développement du capitalisme a été selon vous rendu possible par l’existence antérieure du patriarcat. Pouvez-vous l’expliquer?
La révolution industrielle par la mécanisation de la production était célébrée en son temps par la possibilité qu’elle offrait aux propriétaires d’embaucher femmes et enfants plutôt que des hommes adultes qui coûtaient plus cher. L’infériorisation économique des femmes propre au patriarcat a donc été inscrite dès le départ dans la logique d’exploitation propre au capitalisme industriel. Cela a éventuellement provoqué une concurrence entre ouvriers et ouvrières quand les propriétaires remplaçaient des hommes par des femmes, pour réduire leurs coûts salariaux. Les premiers syndicats ouvriers, qui admettaient des femmes à leur début, les excluront après quelques décennies à cause de cette concurrence induite par les propriétaires capitalistes. Dans la production à domicile, les femmes et les hommes n’étaient pas en concurrence mais solidaires les un.e.s des autres. Le patriarcat a ainsi favorisé le développement du capitalisme parce qu’il a provoqué cette concurrence entre ouvriers et ouvrières, qui jouait en faveur des patrons : l’exclusion ou la marginalisation des travailleuses des formes de syndicalisme qui ont suivi expliquent en partie l’affaiblissement graduel du pouvoir ouvrier des hommes, et donc le renforcement de celui du capital.
Vous opposez deux types d’objectifs des luttes féministes qui s’opposent, soit l’égalité ou la différence. Quelles distinctions impliquent-elles ? Quels sont (si elles en ont) leurs avantages et leurs défauts respectifs?
Les exemples utilisés pour illustrer cette opposition concernent l’adoption de lois différentes pour les femmes et les hommes : la réduction du temps de travail pour les femmes seulement ; l’adoption du VIIe Amendement de la Constitution (Equal rights Amendment) aux Etats-Unis qui devait interdire les lois différentes pour les femmes. Les tenantes de l’égalité revendiquaient les mêmes lois pour les femmes que pour les hommes. La situation des hommes était considérée comme la norme, qui aurait dû s’appliquer aussi aux femmes, sans critique de cette norme, ce qui a pour effet d’aggraver les inégalités. Les tenantes de la différence arguaient du fait que les femmes ont une existence de fait différente de celle des hommes et qu’il faut en tenir compte dans les lois, sinon on aggrave les inégalités. Cette position peut aussi avoir pour résultat de creuser les inégalités si la loi en consolide la source.
Un autre point de vue a été fourni par des femmes syndicalistes étatsuniennes, au sujet de l’Equal Rights Amendment: elles revendiquaient que les hommes accèdent aux ‘droits’ reconnus aux femmes, notamment concernant la limite de la semaine de travail, plutôt que leur abolition. Elles ont perdu leur cause et cela s’est éventuellement soldé par une augmentation généralisée du temps de travail aux États-Unis. Un exemple actuel de l’adoption partielle de la logique de ces syndicalistes concerne le congé de maternité, aujourd’hui transformé en congé parental dont les pères peuvent aussi se prévaloir.
En fait, l’égalité suppose la différence, sinon on est face à l’identique. Dans mon ouvrage, je défends l’idée que l’égalité se manifeste à travers les luttes pour apparaître dans la société, que c’est une manifestation politique, et non un gain économique.
Finalement, il apparaît que l’échec de l’émancipation des femmes par le travail rentre dans une impuissance plus globale des travailleurs et des travailleuses à remporter les luttes socio-politiques contre leurs employeurs…
Cette impuissance est le résultat de l’exclusion des femmes des suites de l’émancipation par le travail lorsque le syndicalisme s’est développé. Le sous-titre de mon livre – « Le genre de l’émancipation ouvrière » – peut mener à une fausse piste, à savoir que seuls des hommes sont concernés, alors que tout mon ouvrage montre l’inverse : des femmes ont été davantage porteuses de cette promesse, pendant que les hommes se sont repliés sur leur activité et leurs rapports avec leur employeur, avec l’entreprise qui les emploie. Mon premier ouvrage, centré sur des hommes, concluait à la totale incapacité d’envisager une telle émancipation. Pas celui-ci, centré sur des femmes.
Propos recueillis par Eugénie Bourlet, Le Nouveau Magazine littéraire, 21 janvier 2019
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte