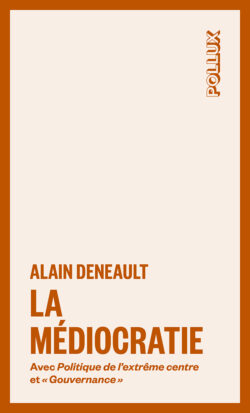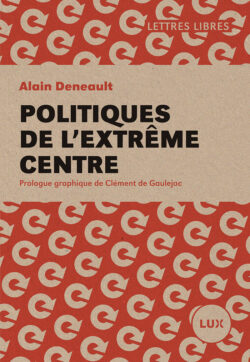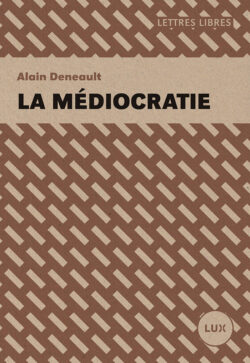Sous-total: $

Du médiocre au commun
Alors que les élections présidentielles en France viennent de consacrer le parangon suprême du centre, Emmanuel Macron, le Canada a une longueur d’avance en la personne de Justin Trudeau, ce qui a permis au philosophe Alain Deneault d’en ausculter les ressorts et rouages dans trois ouvrages1. Si la gouvernance est la théorie, l’idéologie qui sous-tend le système, la médiocratie en est la modalité et l’extrême centre sa traduction politique.
La médiocratie
Le recours au terme de médiocratie ne vise pas à stigmatiser sur un plan moraliste les médiocres. Les pouvoirs institués ont confiné à la médiocrité des acteurs qui ne le sont pas nécessairement. Par ailleurs s’en tenir à la médiocrité suppose une certaine forme d’exigence qui se traduit par un nivellement non par le bas mais par le moyen. En fait, c’est très exigeant d’être médiocre : il s’agit d’abdiquer son pouvoir de penser et de mettre de côté ses principes pour satisfaire les puissances auxquelles on loue ses dispositions intellectuelles et morales en veillant à rester dans le rang.
La médiocratie est la moyenne en actes. Dans cette perspective, une forte pression à être moyen, à rentrer dans les rangs et à jouer le jeu est exercée : « on a généré une sorte de moyenne standardisée, requise pour organiser le travail à grande échelle sur le mode aliénant que l’on sait, et qui a été décrit par Marx. on a fait de ce travail moyen quelque chose de désincarné, qui perd du sens, et qui n’est plus qu’un “moyen” pour le capital de croître, et pour les travailleurs de subsister2 ». Historiquement, ce formatage remonte, pour le travail manuel, à la révolution industrielle avec le passage du métier à la fonction. Le taylorisme va également accentuer cette évolution. Pour les professions intellectuelles, le processus se manifeste par un formatage du discours et une standardisation de la pensée. Ce processus vise à rendre conforme à une moyenne qu’il faut incarner en actes, comme si la défaillance était et devait être organisée. La médiocratie entraîne et induit donc le conformisme. Le système œuvre à rendre médiocre.
Et parmi les médiocres, une typologie rapidement dressée permet de dénombrer cinq idéaux-types :
- L’homme qui dort de Pérec, le pique-assiette, précaire qui refuse de jouer le jeu ;
- Le médiocre qui s’ignore, qui bouffe des psychotropes et boit du café, qui pense que le monde est comme ça et qui souffre ;
- Le médiocre zélé qui a compris le jeu et qui le joue et qui manœuvre sans cesse ;
- Le médiocre malgré lui, qui a lu La banalité du mal de Hannah Arendt et qui va tenter de trouver une voie, il est une sorte de héros de l’ombre ;
- Et les têtes brûlées qui s’attaquent bille en tête au système, quitte à en payer le prix.
La gouvernance
Les multinationales et les grandes entreprises ont joué un rôle important dans l’émergence de la gouvernance. La médiocratie rend les gens interchangeables, il faut donc œuvrer et veiller à une uniformisation des pratiques sociales. La théorie de la gouvernance va vite devenir le mortier sémantique de ces nouvelles institutions, leur armature politique, leur théorie constitutionnelle. Cette science de la gestion va également vite déborder sur d’autres champs. L’État devient une entreprise et est géré comme telle. Le discours sur la gouvernance est devenu référentiel en opérant une fusion du régime managérial et du régime politique. Ce culte et cette culture de la gestion vise à la fin de la politique : « L’abandon progressif des grands principes, des orientations et de la cohérence au profit d’une approche circonstancielle, où n’interviennent plus que des “partenaires” sur des projets bien précis sans qu’intervienne la notion de bien commun, a conduit à faire de nous des citoyens qui “jouent le jeu”, qui se plient à toutes sortes de pratiques étrangères aux champs des convictions, des compétences et des initiatives. Cet art de la gestion est appelé “gouvernance”3 ».
Avec la gouvernance, la politique est remise au rang de la gestion qui devient une fin en soi et est naturalisée comme étant la seule et unique chose possible, elle est l’alpha et l’oméga de la vie en société. Et un glissement sémantique s’opère : le peuple disparaît au profit de la société civile, l’écosocialisme cède la place au développement durable, les citoyens sont remplacés par les parties prenantes, le débat s’incline devant le consensus. L’enjeu étant de « faire oublier aux membres de la classe moyenne qu’ils ne seront jamais que des prolétaires avec de l’argent4 ».
Cette idéologie de la gouvernance fait passer ses critères dans les canons de l’entendement. Rappelons que, pour Isabelle Garo, l’idéologie sert à cadrer le discours, le mettre en perspective pour forcer les enchaînements logiques, naturaliser le discours, gommer les contradictions et servir des modalités de domination.
Les politiques de l’extrême centre
Dans l’extrême centre, la politique managériale prend toute la place. Cette politique est extrême au sens moral parce qu’elle est intolérante à tout ce qui n’est pas elle. Le centre est excluant et exclusif. il se définit comme étant ce qui est normal, pragmatique, réaliste, nécessaire et son discours pragmatique et normal naturalise et rend inéluctable : « Passe pour normal ce que les pouvoirs institués présentent comme tels : racisme d’État, brutalité policière, précarisation du travail, souveraineté plénipotentiaire des banques, mépris de la culture, trivialisation de la politique5 ». Son programme est simple et se résume en cinq points : plus d’argent pour les actionnaires ; pour les entreprises, un accès aisé aux paradis fiscaux ; une réduction de l’État au rôle d’agent de sécurité des investisseurs ; moins de services publics et moins de droits pour les travailleurs. Et quiconque n’est pas d’accord se met et est mis hors-jeu. Et, ainsi, le centre supprime l’axe gauche-droite et il est ici question d’un sabordage de la politique par le monde politique.
Ce changement de régime induit une double alternance entre la conception de l’État d’extrême centre ou le retour aux sources violentes de l’État où, dans ce dernier cas, l’État doit empêcher violemment l’émergence d’une résurgence de la violence dont il est lui-même issu: « Entre Justin Trudeau et Stephen Harper, entre Hillary Clinton et Donald Trump, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on n’a pas tant eu le choix entre des options politiques fondamentales sur la façon dont le lien social et économique doit être institué à travers des structures publiques, qu’à un plébiscite forcé portant strictement sur le degré de violence que peut s’autoriser l’État pour faire valoir des règles socio-économiques ne relevant plus de lui, mais de puissances privées qui l’ont vassalisé.6 »
Ces trois ouvrages ont révélé un malaise social induit par cette standardisation. En guise de solutions et de pistes, l’idée serait de rompre collectivement, de corrompre et corroder le système car la politique revient à penser la subjectivité collective et cette rupture collective passe notamment
- par la politisation du malaise (il doit quitter les rangs de la psychologie pour rejoindre ceux de la sociologie),
- par la guerre menée aux mots de l’idéologie afin de générer un vocabulaire et une lecture du monde autre : il s’agit de revenir à des « mots investis de sens, tous ceux que la gouvernance a voulu abolir, caricaturer ou récupérer : la citoyenneté, le peuple, le conflit, les classes, le débat, les droits collectifs, le service public, le bien commun… Ces notions ont été transformées en “partenariat”, en “société civile”, en “responsabilité sociale des entreprises”, en “acceptabilité sociale”, en “sécurité humaine”, etc…7 »
Et en attendant que le statu quo ne soit plus tenable, il convient de s’entraîner à mettre en œuvre cette autre approche du monde en œuvrant le plus possible à la « démarchandisation » du monde. C’est dans ce cadre-là que la logique du commun peut être une piste à suivre. Une logique qui est en gestation, qui « se cherche et s’expérimente aujourd’hui dans les mouvements sociaux, les luttes, les pratiques8 »
Pierre Dardot et Christian Laval voient dans les récents surgissements démocratiques (l’occupation du Parc Gezi à Istanbul, les mouvements sociaux en Amérique Latine, les luttes en Italie contre la privatisation de l’eau…) des raisons d’espoir, de convergence et d’actions en ce sens que ces mouvements développent autre chose que des parois défensives. Pour eux, tous ces mouvements ont remis en route l’imaginaire politique et promeuvent une posture visant à mettre en avant une rationalité alternative à la rationalité néolibérale et ils partagent le même principe, celui du commun.
Mais qu’entendent-ils au juste par le principe du commun : le principe du commun est « le principe politique d’une co-obligation pour tous ceux qui sont engagés dans une même activité9 » où « seule la co-participation à la décision produit une co-obligation dans l’exécution de la décision10 ». Le commun est une construction politique qui consiste à réintroduire partout de l’autogouvernement, fondé sur la participation de tous aux règles qui les gouvernent. Et tout ceci n’est pas sans conséquences sur la conception de l’État et de la démocratie. L’insistance sur le commun évoque indubitablement une méfiance à l’égard de l’État, pourtant longtemps perçu comme un allié des forces progressistes et comme un outil favorable à l’expansion de la démocratie. Pour les auteurs, « les États néolibéraux sont devenus des machines au service d’une entreprise active de dé-démocratisation11 ».
Un des objectifs de la réflexion sur le principe du commun émane de la volonté et de la nécessité de se projeter dans un futur désirable, de réfléchir à une organisation alternative qui fait fonctionner l’imaginaire politique. Comment rendre la société régie par le commun désirable ? Le commun est le fruit de la conscience de la catastrophe, d’expérimentations locales qui pourraient faire tache d’huile et de la confrontation avec un néolibéralisme qui capte les subjectivités. Si le commun ne contribue pas à un autre mode de vie, les sujets néolibéraux vont proliférer comme des métastases.
L’engagement dans la lutte est le moteur de notre propre changement : les sujets du commun doivent se constituer et nous devons nous former nous-mêmes comme sujets du changement. Et il faut faire fonctionner l’imaginaire politique afin de faire bouillir les marmites de l’avenir. Pierre Dardot et Christian Laval nous rappellent par ailleurs que les institutions ne viennent pas d’en haut : c’est le peuple et la lutte qui produisent du droit. En somme, ils nous invitent à quitter la posture de résistance et à redevenir instituant.
1 Alain DENEAULT, « Gouvernance » Le management totalitaire, Montréal, Lux, 2013. Médiocratie, Montréal, Lux, 2015 et Politiques de l’extrême centre, Montréal, Lux, 2017.
2 Alain DENEAULT, entretien par Mathieu Dejean, « Comment “les médiocres ont pris le pouvoir” », Les Inrocks, 01/06/2015, http://www.lesinrocks.com/2015/12/01/actualite/comment-les-m%C3%A9diocres-ont-pris-le-pouvoir-11791161/
3 Ibidem.
4 Alain DENEAULT, Politiques de l’extrême centre, op.cit., p.48.
5 Idem, p.43.
6 Alain DENEAULT, « Une victoire de l’extrême centre », Le Devoir. Libre de Penser, 27/04/2017, http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/497305/victoire-de-l-extreme-centre-a-l-election-presidentielle-en-france
7 Alain DENEAULT, entretien par Mathieu Dejean, op. cit.
8 Pierre DARDOT et Christian LAVAL, « Nuit des idées. Inventons de nouvelles formes de vie », Le Monde, 24/01/2017, http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/24/nuit-des-idees-inventons-de-nouvelles-formes-de-vie_5068449_3232.html
9 Pierre DARDOT et Christian LAVAL, Commun, essai pour une révolution du XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014, p. 23.
10 Idem, p. 87.
11 Pierre DARDOT et Christian LAVAL, op. cit., p. 542.
Olivier Starquit, L’Aide-mémoire, no 81, été 2017.
 Mon compte
Mon compte