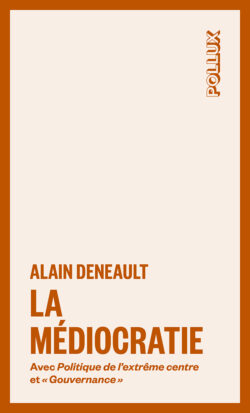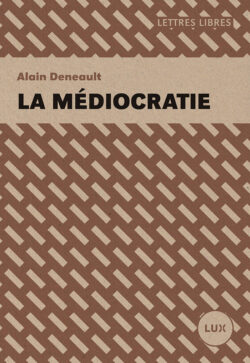Sous-total: $

La pandémie, déclencheur de l’esprit
Nous devions discuter du troisième livre de son « feuilleton théorique » sur l’économie, celui sur l’esthétique, qui suit ceux parus sur l’économie de la nature et l’économie de la foi l’an dernier. Mais la COVID-19 est arrivée, et avec elle mille questions à poser à l’auteur de La médiocratie et au pourfendeur des paradis fiscaux et des multinationales. De chez lui, au Nouveau-Brunswick, où il berce sa fille née il y a quelques mois, le philosophe Alain Deneault nous explique ce que cette pandémie peut ouvrir comme avenir, pendant que nous sommes tous confinés.
Vous avez écrit un texte dans le journal Libération dans lequel vous dites que cette pandémie est le #metoo de Gaïa.
En fait, il se passe deux choses aujourd’hui. D’une part, une pandémie qui appelle bien sûr à un discours épidémiologique, médical, sanitaire, social, rationnel. Et d’autre part, cette pandémie-là agit comme un déclencheur de l’esprit. Tout d’un coup, on se met à penser sur des échelles, et par rapport à des enjeux qui ne sont pas habituels au quotidien. Parce qu’une pandémie, qui est foudroyante et potentiellement mortelle pour beaucoup de gens, renvoie l’imaginaire à un passé qu’on n’a pas l’habitude d’évoquer. On pense à la lèpre, à la grippe espagnole, à la malaria, et là, on se rend compte que les peuples, malgré la réputation qu’ils ont d’être amnésiques, de ne pas se soucier de l’histoire, d’être enfermés dans leur quotidien, ont tout à coup une mémoire quand l’heure est grave. Donc, on est amenés à penser sur cette échelle-là non seulement le passé, mais notre avenir à long terme. On dirait en esthétique que cette pandémie se présente comme un élément déclencheur dans le récit, qui apporte une pensée, une action, une attitude et des dispositions nouvelles. Et on se rend bien compte que cette crise n’est pas la première liée à notre mode de vie. Il y a de plus en plus d’incendies de forêt, d’ouragans, de tsunamis qui nous touchent, la montée des crues est anormale, les forêts se réduisent, le sol s’érode, les glaciers fondent… On voit bien qu’il y a des problèmes majeurs qui sont liés à notre mode de vie et que le XXIe siècle sera l’occasion d’un changement de paradigme. Qu’on choisira ou qu’on subira. Mais il y aura un changement de paradigme. Il faudra vivre autrement. Le capitalisme tel qu’on le connaît ne pourra pas perdurer. Et je ne parle même pas de la crise énergique et minière qui s’ajoute. Le mot économie ne pourra pas toujours signifier s’organiser pour aider des actionnaires à accroître leurs capitaux.
Vous prouvez en effet que le mot économie est riche de sens dans votre feuilleton théorique, et qu’il n’appartient pas qu’aux économistes.
Je me suis laissé conduire par ses usages au point de découvrir, au fil des années, que cela consistait à penser les relations bonnes, les relations saines entre les éléments, entre les gens, entre les gens et leurs idées, entre les symboles… C’est une pensée de relations bonnes dans des champs qui sont incommensurables. Il y a toujours quelque chose qui nous dépasse quand on s’intéresse à une économie. Les relations sont trop nombreuses pour qu’on les enferme dans un modèle. Aujourd’hui, avec la pandémie qui nous touche, on constate que nous sommes face à un problème économique. Je ne parle pas des marchés financiers, des rendements d’entreprises ou des mises à pied – c’est un problème relatif à l’intendance qu’il ne s’agit pas de négliger –, mais l’économie excède ce champ-là. On est dans un monde qui n’a pas du tout soigné son rapport au vivant, qui s’est pensé sur le mode du réseau au profit des plus forts et au détriment des plus faibles, et nous vivons le contrecoup de ce manque de sens économique au sens large.
On avait l’impression depuis quelques années que c’était la crise écologique qui allait nous frapper dans un avenir plus ou moins rapproché. On dirait que cette pandémie vient tout de suite mobiliser des pensées qui étaient latentes.
Les mots sont importants. On a beaucoup parlé de la crise écologique comme étant quelque chose qui s’annonce, qui nous pend au bout du nez. On a parlé d’effondrement, de rupture. Ce choix des mots, qui a quelque chose de voisin de l’Apocalypse, nous amène à adopter une attitude attentiste par rapport à cette espèce de mur qu’on devra un moment frapper. Or, nous sommes déjà dans le processus depuis des décennies ! C’est la raison pour laquelle je préfère parler pour ma part d’une érosion exponentielle. Les choses s’érodent, se corrodent, se désagrègent lentement. Maintenant. Pas dans 10 ans ou 15 ans. On est dans une logique du participe présent. Les choses vont en s’effondrant. Nous sommes d’ores et déjà dans un processus d’effondrement qui est plus ou moins perceptible au quotidien. Et qui le sera de plus en plus et de manières de plus en plus inquiétantes.
Quel genre de récit est en train de se construire en ce moment, d’après ce que vous observez ?
J’ai une réponse assez simple. Il y a un espoir sourd chez bien des gens que l’idéologie du pouvoir dominant – qui n’est pas seulement celui d’un parti politique, mais celui d’un establishment financier, de la grande industrie, de la haute finance –, que ce pouvoir dominant dise vrai. Ce serait donc plus simple si ce discours idéologique au pouvoir disait le vrai ! Que des experts s’occupent de tout, que tout est entre bonnes mains, qu’on sait où on va, que la croissance est garantie. Qu’il y aura toujours de l’énergie, qu’il y aura des solutions techniques à la crise écologique, qu’il y aura toujours des supermarchés avec une abondance de produits qu’on pourra consommer éternellement.
C’est un fantasme. Et on s’accroche à ce fantasme tant et aussi longtemps qu’il ne nous paraît pas radicalement vain. Le jour où on l’abandonnera, c’est le jour où nettement le discours idéologique dominant ne coïncidera pas du tout avec l’état du réel. Quand on s’inquiétera tellement de l’état du réel qu’on verra l’inadéquation flagrante entre cet état du réel dans notre histoire et le discours qui vise à le masquer. Là, on rira lorsque des experts viendront nous parler de la croissance infinie. Et je pense qu’on y arrive.
Nous y arrivons ?
On voit bien que ce vaste capitalisme mondialisé avec des grandes entités multinationales puissantes, des cartels dans le domaine de la finance, sont des géants aux pieds d’argile, qu’ils sont extrêmement fragiles, qu’ils sont tellement réseautés que le moindre soubresaut quelque part suscite par réactions en chaîne des bouleversements à l’autre bout de la planète. On éternue en Chine, et la planète est malade. Il y a un constat comme quoi ce régime-là a beaucoup de faiblesses. D’autre part, j’ai l’intime conviction que bien des gens qui actuellement souffrent de la situation, sur le plan psychologique, et aussi financier et matériel – je pense aux salariés, aux artisans, aux dirigeants de petites entreprises, à tous ceux qui ne savent comment ils vont payer leurs loyers, leurs échéances, etc. –, je suis convaincu que quelque part, en nous tous, y compris ceux qui souffrent, qu’il y a une sorte de… satisfaction à voir tout enfin un peu s’arrêter.
Nous sommes dans une société de performance, de burnout, de détresse psychologique, les gens n’ont pas le temps de voir leur famille. En fait, les gens sont à bout depuis longtemps. Et puis là, on est forcés à une pause et quasiment à évaluer sa vie.
Absolument. Et vous avez tout à fait raison de pointer des symptômes d’une maladie qui nous tue à petit feu. La détresse au travail qui se manifeste par l’alcoolisme, par la prise inquiétante d’antidépresseurs, de psychotropes, l’insomnie chronique, les problèmes de suicides. On voit même en France des employés, comme à France Télécom, se suicider politiquement pour dénoncer leur entreprise. Ça va jusque-là, la détresse. Et on pourrait parler de l’aberration que représente l’obsolescence programmée, le fait de travailler pour fabriquer des objets qui vont briser et qui vont être rapidement démodés pour favoriser leur renouvellement. On est dans des situations tellement aberrantes qu’une pause comme celle-là peut amener beaucoup de gens tout d’un coup à renouer avec l’essentiel. L’école à la maison, penser à un potager cet été, s’assurer que les voisins et les proches vont bien. Penser l’organisation des choses. On pourrait se découvrir des talents qu’on ignorait avoir !
Ce que vous évoquiez dans votre essai La médiocratie.
À ma surprise, ce livre a suscité un très grand intérêt en France, en Italie, en Espagne, dans le monde arabe et au Québec, notamment. Il était le signe d’un malaise, au-delà du livre et son contenu. C’était une sorte d’adhésion à une analyse comme quoi on nous rend médiocres, on nous rend tristes, et il y a quelque chose d’inacceptable à cela. Cette pandémie est l’occasion de se redresser la tête et de penser son rapport au monde de manière beaucoup plus libre, souveraine, structurée et constructive.
En même temps, nous voyons aux États-Unis un président qui veut plus sauver l’économie que les vies, et sa cote de popularité ne baisse pas.
Trump est un sujet en lui-même. Une sorte d’exception extraordinaire. Ce qui m’étonne davantage, c’est le phénomène exactement inverse, à savoir que tout d’un coup, des États se rappellent qu’ils ont des prérogatives en matière de santé publique et de bien commun et peuvent soudain avoir un rapport souverain sur la finance et la grande industrie. C’est ça qui est singulier ! Parce que voir des États qui prennent fait et cause pour le grand capital, ça fait deux siècles que ça dure. Voir l’inverse a quelque chose d’absolument sidérant. Et d’ailleurs, en France, on arrive très mal à assurer ce discours social. On sait qu’on a un gouvernement et une présidence très libérale, alors on a un discours militaire. On fait la « guerre » au virus. C’est un peu moins le cas chez nous. Aux États-Unis, il y a un grand malaise aussi, car il y a quelque chose de contre-indiqué et de contre nature à voir des États bourgeois capitalistes demander à la finance, à l’industrie pétrolière et minière, à celle du tourisme, de faire une halte pour des raisons de santé publique. On nous aurait dit ça il y a six mois, on n’y aurait pas cru. Eh bien, c’est parce que ce virus-là attaque toutes les classes sociales. Les riches, les pauvres, les Blancs, les Noirs, les urbains, les ruraux, tout le monde. Il frappe à l’aveugle, d’une manière sévère et brutale, et c’est parce qu’il ne connaît pas les frontières et les classes sociales qu’il est tout à coup le sujet d’une urgence nationale, parce que l’oligarchie est touchée. C’est très intéressant. Si vraiment l’État avait à cœur la santé publique, ça ferait longtemps qu’on aurait interdit la malbouffe et qu’on se serait attaqué au problème du climat. Mais c’est quand la classe dirigeante est frappée de plein fouet qu’il y a une réaction.
Ce qu’on est en train de voir n’est pas la fin du monde, mais d’un monde ?
Les historiens sont mieux placés que nous pour en juger, mais on est de toute évidence dans une transition en ce qui concerne le vivant, l’économie de la nature – et, en ce qui me concerne, une refonte nécessaire du discours économique. L’économie ne pourra pas longtemps signifier seulement ce que lui font dire les sciences de l’intendance. L’économie devra rapidement revenir à la source de discours qui portent sur le vivant, les affects, les croyances, les modes d’organisation, sur les signes, les symboles qui font qu’on se comprend dans un moment de l’histoire. Qu’on s’organise, qu’on est concertés. L’économie ne pourra pas longtemps signifier qu’on « investisse » dans la « matière grise » pour détenir le diplôme qui, sur un marché du travail, va faire de nous une « ressource humaine » enviable du moment qu’on apprend à « se vendre », en « gérant ses émotions ». Ça ne pourra pas signifier encore cette caricature qu’on en a faite.
Dans votre article, vous dites que lucidité et gaieté sont nos dispositions psychiques maîtresses pour l’avenir. Pourquoi ?
C’est évident que l’humanité s’apprête au XXIe siècle à vivre un mauvais quart d’heure. Et il va durer longtemps. Mais ce sera l’occasion, comme nous le vivons maintenant je dirais à dose homéopathique avec cette pandémie, de se découvrir des dispositions, des talents, des forces, de s’investir dans des activités qui ont tout à coup du sens. Ce sera l’occasion aussi de s’engager dans l’organisation et l’élaboration d’un monde qui nous ressemble si on résiste à la tentation du fascisme – parce que c’est un gros problème, ça, quand on est dans des transitions historiques. C’est une chance qui nous est donnée dans l’histoire de quitter un régime qui est inique et qui est triste. Voir cet avenir d’une manière lucide en sachant que le capitalisme ne remplira pas ses conditions de possibilité dans un avenir proche, qu’il n’y aura pas à tout jamais du pétrole abondant et abordable, des mines en quantité, un écosystème prêt à encaisser tout ce qu’on lui fait subir, comme on le fait maintenant. Lorsque ça ne tiendra plus, forcément, nous vivrons des moments très durs. On peut d’ores et déjà travailler à ce qu’ils le soient le moins possible. Mais voir lucidement cet avenir-là d’une manière strictement angoissée et inquiète n’apporte rien. C’est stérile. Rester dans la joie sans faire preuve de cette lucidité minimale est aussi stérile. Ce qui est beaucoup plus engageant et fécond, c’est un rapport lucide à cet avenir en tant qu’il sera aussi l’occasion puissante de manifestations de joie, de fierté et de sens beaucoup plus grandes que ce qu’on connaît maintenant dans notre ronron quotidien fonctionnaliste et soumis.
J’ai déjà dit à une amie inquiète pour l’avenir de ses enfants que, si ça se trouve, même si cet avenir est très difficile, ils seront plus en vie que nous l’aurons été dans notre confort angoissé.
Absolument. J’ai une vie de famille aussi, et j’ai vraiment foi en nos enfants, d’un point de vue collectif. Ils trouveront la force de se donner un monde qui leur ressemble.
Entrevue avec Chantal Guy, La Presse, 31 mars 2020
Photo: Hugo-Sébastien Aubert, Archives La Presse
Lisez l’orignal ici.
 Mon compte
Mon compte