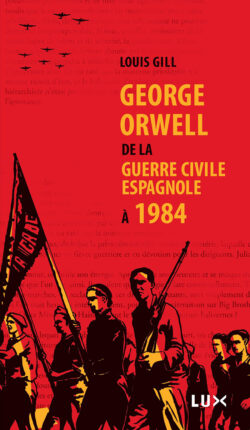Sous-total: $
Le Devoir, 10 et 11 septembre 2005
Orwell et le totalitarisme
Quand il débarque en Espagne, en décembre 1936, l’écrivain britannique George Orwell n’a qu’un objectif en tête : se joindre aux républicains qui combattent les troupes fascistes de Franco, appuyées par l’Allemagne d’Hitler, l’Italie de Mussolini et le Portugal de Salazar. Débordée sur sa gauche par les ouvriers et paysans espagnols engagés dans une « transformation de fond en comble de la société », la coalition du Front populaire, au pouvoir depuis février 1936, est abandonnée par la France et l’Angleterre. C’est l’Union soviétique qui, à partir d’octobre 1936, lui fournit la seule aide digne de ce nom, mais, Orwell le découvrira rapidement, cette aide se paie au prix fort.
Telle est la thèse que défend l’économiste Louis Gill dans cet éclairant ouvrage intitulé George Orwell, de la guerre civile espagnole à 1984 : la lutte antifasciste espagnole a été récupérée et étouffée par le totalitarisme stalinien, et l’inspiration d’Orwell pour ses célèbres romans La Ferme des animaux et 1984 est issue de cette triste expérience.
Selon Gill, en effet, l’aide soviétique aux socialistes espagnols s’inscrit dans la logique totalitaire stalinienne : « Pour ce régime, la révolution en marche en Espagne ne peut que constituer une menace en risquant de s’étendre à d’autres pays et de raviver en URSS une flamme qui a été étouffée. » Aussi, pour l’URSS, va pour armer la république espagnole, mais à condition que ce soit « en désarmant la révolution ».
Orwell, qui débarque en Espagne en combattant antifasciste, découvre alors qu’il se trouve au coeur d’une guerre triangulaire : il faut, bien sûr, se battre contre Franco, mais aussi contre un gouvernement désormais à la solde de Staline, qui déploie tous les moyens, au nom de la lutte antifasciste, pour casser la révolution en marche. L’écrivain britannique, enrôlé dans les milices du Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM), une organisation qui refuse d’abandonner la lutte révolutionnaire, se voit forcé de conclure au mensonge soviétique : « Fascisme et stalinisme se révèlent à lui comme les deux visages d’un même monstre, le totalitarisme, qu’il décrira de manière percutante dans 1984 et La Ferme des animaux. »
Alors qu’il croyait combattre le fascisme et contribuer à l’avènement d’un socialisme libérateur, Orwell et les révolutionnaires espagnols se voient qualifiés de « trotskistes » par la presse communiste espagnole, relayée par les cocos du monde entier, et accusés d’un complot fasciste ! Ils seront poursuivis, traqués, jetés en prison, voire tués, suivant la logique des purges staliniennes à laquelle l’Espagne sert de camp d’entraînement.
Toute la critique orwellienne du totalitarisme prend donc sa source dans le mensonge stalinien à la sauce espagnole. Contrairement à d’autres, toutefois, l’écrivain n’en tirera pas la conclusion qu’il faut en finir avec le socialisme. En 1947, par exemple, il écrira qu’il est « indispensable de détruire le mythe soviétique si nous voulons assister à la renaissance du mouvement socialiste ». Partisan d’un « socialisme où la liberté de pensée pourra survivre à la disparition de l’individualisme économique », il prétend, selon Gill, que cette solution « constitue le seul rempart à l’étouffement de cette liberté, à la mainmise sur la vie sociale en général, sur la culture, la littérature et l’art en particulier, qui est le fait du totalitarisme ».
Passant en revue certaines fictions anticipatrices (London, Wells, Huxley et Zamiatine) et certains essais catastrophistes (Burnham et Rizzi) qui ont précédé la rédaction de La Ferme des animaux et 1984, Gill insiste sur le fait que les romans d’Orwell, et 1984 en particulier, se veulent moins une prophétie d’avenir qu’une « mise en garde contre une dangereuse évolution qui menace l’humanité, mais qui n’est en rien inévitable et qu’il faut contrer par tous les moyens possibles […] ».
Pour Orwell, le totalitarisme à combattre, alors, prend la figure, à la fois fasciste et stalinienne, du « collectivisme oligarchique ». On pourrait croire, aujourd’hui, que cette menace est derrière nous. Gill, qui s’inspire d’Arendt pour définir le totalitarisme « comme la prise de possession de l’individu atomisé dans sa totalité, c’est-à-dire sa transformation complète par la destruction de l’existence autonome de toute activité et la domination de toutes les sphères de la vie », nous met en garde contre cette tentation jovialiste. Bien sûr, écrit l’ex-militant trotskiste, il faut user de prudence lorsqu’on utilise le lourd concept de totalitarisme, mais la lucidité, ajoute-t-il, exige que nous l’appliquions à certaines tendances contemporaines qui nous menacent : « Le totalitarisme actuel, qui s’est infiltré dans nos vies de manière tacite sous la forme d’une guerre non déclarée en s’imposant au nom des libertés individuelles et économiques, est celui de la soumission de toutes les composantes de la vie sociale au marché et de la domination totale de l’individu par ses lois, de sa transformation en homo oeconomicus, c’est-à-dire en individu pensant tout en termes économiques. »
Vivons-nous dans un 1984 néolibéral ? Pour être contestable, cette conclusion dramatique tire néanmois une sonnette d’alarme qu’on ne saurait négliger. En rendant bellement hommage à Orwell, Gill rappelle surtout que le combat pour une véritable démocratie, sans cesse menacé par la récupération idéologique, exige une lucidité critique dirigée vers tous les azimuts.
Louis Cornellier
Le Devoir, 10 et 11 septembre 2005
 Mon compte
Mon compte