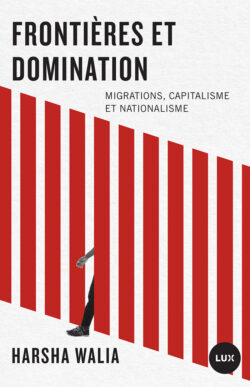Sous-total: $

Une enquête mondiale qui bouscule les récits dominants
La militante Harsha Walia, cofondatrice du groupe de défense des droits des migrants No One Is Illegal, présente la frontière comme « méthode essentielle de formation de l’État impérial, de hiérarchisation sociale, de contrôle de la main-d’œuvre et de promotion du nationalisme xénophobe ». Une enquête mondiale qui, mettant au jour des tendances transnationales et les resituant dans leur contexte d’asymétrie, bouscule les récits dominants sur la « crise migratoire », brandie comme une menace, bien que le résultat inévitable de la colonisation, de la mondialisation capitaliste et des dérèglements climatiques.
En ce qui concerne les États-Unis, elle revient sur la formation de la frontière avec le Mexique, justifiée dès l’origine par l’idéologie de la destinée manifeste, avec l’annexion de la République du Texas en 1845, suivie par l’invasion du Mexique et l’annexion forcée de la moitié du pays lors de la signature du traité de la Guadalupe Hidalgo en 1848 : « Un ordre racial anglo-américain fut instauré. Les Mexicains des territoires conquis se virent offrir une citoyenneté étatsunienne de pure forme et subirent la discrimination raciale systémique et la ségrégation imposées aux citoyens étrangers. » Précédemment, une série de bulles pontificales émises à la fin du XVe siècle, avait élaboré la doctrine de la découverte, affirmant que toutes les terres non-peuplées de chrétiens pouvaient être revendiquées. Le mythe libéral d’une « nation d’immigrants » dissimule en vérité la violence des conquêtes infligée aux communautés mexicaine, autochtones, noires et colonisées. La citoyenneté était subordonnée au régime de la propriété privée, excluant les peuples autochtones. En 1924, des quotas ethniques, définis par une loi sur l’immigration, favorisèrent l’établissement des Européens du Nord et de l’Ouest, de préférence aux ressortissants d’autres pays, jugés indésirables pour des raisons de race. Les guerres indiennes ont servi de modèle aux guerres génocidaires menées à Hawaï, Porto Rico, Guam et aux Philippines. Nombre de migrants centraméricains aux États-Unis sont des personnes autochtones colonisées par les Espagnols, enfermées dans une identité dans latinxs et mestizx, criminalisées par l’imposition des frontières.
De la même façon, la criminalisation actuelle de la migration a été structurée par la traite légale de millions d’Africains, la surveillance et le contrôle de la population noire au service des intérêts du suprémacisme blanc et du capitalisme racial. Les fondements racistes de la citoyenneté étasunienne remontent au Naturalization Act (Loi sur la naturalisation) de 1790, qui l’accordait à « tout étranger, du moment qu’il s’agisse d’une personne blanche libre ».
Le mythe de la générosité des États-Unis est également mis à mal par l’analyse des conséquences de leurs « sales guerres » : il y a continuité entre le développement du complexe carcéro-industriel et les opérations de contre-insurrection. La guerre contre la drogue, déclenchée dans les années 1980 au Guatemala, au Salvador, au Nicaragua, a servi d’ « outil supplémentaire à la production de la race et à la surveillance des personnes racisées », et à la poursuite du programme impérialiste. Harsha Walia démontre comment « l’application de la loi aux frontières a […] servi de pivot entre la politique intérieure et le militarisme à l’étranger ». Les coups d’État fomentés par les États-Unis en Haïti ont permis l’extraction de minéraux au profit de sociétés canadiennes et étasuniennes, appauvri des millions d’agriculteurs locaux, entraîné une migration massive et l’ouverture du camp de Gantánamo en 1994 pour les « accueillir ».
Les accords de libre-échange (ALE) ne sont nullement un phénomène récent. Inspirés du modèle inventé par la compagnie britannique des Indes orientales, ils consistent « à établir et à subordonner des marchés, au bénéfice de la classe dirigeante impériale », en affaiblissant les systèmes de protection sociale et entrainant la destruction des moyens de subsistance des communautés paysannes, rurales et autochtones. Dans la décennie qui suivit la signature de l’ALENA, entre le Mexique et les États-Unis, 1,3 million d’agriculteurs ont déclaré faillite tandis que les exportations de maïs étasunien augmentaient de 323% et que l’article 27 de la Constitution qui protégeait la redistribution des terres communales depuis la révolution de 1917, a été abrogé. Dans les six première années d’application de cet accord, le nombre de morts dans la zone frontalière a augmenté de 509%. L’auteure analyse les lois punitives, adoptées sous Clinton, qui ont criminalisé la pauvreté. Dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », les États-Unis interviennent désormais de façon préventive… et permanente dans plus de 80 pays, contribuant à une gigantesque crise de déplacement en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, etc.
À la manière des maquiladoras, des Zones franches industrielles (ZFI) ont été instaurées, par exemple au Bangladesh, des espaces de libre-échange dédiés à la fabrication de biens destinés à l’exportation, caractérisés par des régimes d’incitation fiscale, la suspension des lois nationales sur le travail et sur l’environnement, la suppression des droits de douane. Trois décennies d’ajustement structurel ont provoqué la privatisation de nombreux secteurs et la réduction des dépenses publiques, la prolétarisation des travailleurs, poussés vers les ZFI. Contrairement aux idées reçues et aux commentaires des médias occidentaux, 95% des personnes déplacées le sont à l’intérieur de leur propre pays ou dans des camps de réfugiés de pays voisins. La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés ne reconnaît pas les motifs économique et climatique.
Dans un chapitre plus général, l’auteure examine quatre stratégies de domination renforçant le discours raciste et constituant la frontière :
- L’exclusion consiste à criminaliser les migrants et les réfugiés en les jugulant et les expulsant. « La loi crée l’illégalité, et le racisme la figure de l’immigrant illégal. »
- La dispersion territoriale : l’internalisation de la frontière instaure un régime omniprésent basé sur la surveillance raciste et un climat de peur permanent qui pousse les sans-papiers à s’expulser.
- L’inclusion-marchandisation consiste à faire des migrants et des réfugiés des travailleurs temporaires ou sans papiers au pouvoir de négociation réduit, afin de garantir l’accumulation du capital. « Si les travailleurs sont déclarés illégaux, il n’en va jamais de même pour la plus-value qu’ils produisent. »
- Le contrôle du discours, notamment par la distinction arbitraire entre « migrants » et « réfugiés ».
Elle décrit également le système d’accords bilatéraux qui empêchent les réfugiés de demander asile dans le pays de leur choix en les renvoyant dans un pays de transit, et d’autres formes d’externalisation de la frontière.
Harsha Walia revient ensuite sur l’histoire de la colonisation de l’Australie. Le territoire du petit État insulaire de Naurau a été exploité par les compagnies minières et agro-industrielles australiennes : 80% des terres ont été trouées pour approvisionner l’industrie mondiale des engrais, au point d’être déclaré inhabitable dans les années 1960 et d’être transformé en colonie pénitentiaire. « Le souci de maintenir une Australie blanche continue d’animer la formation de l’État colonial racial, produisant l’un des systèmes de détention les plus punitifs au monde. » « La détention extraterritoriale sert à isoler les réfugiés dans le cadre d’une stratégie de dissuasion raciste et à créer des « catégories juridiques interstitielles ». Toutefois cette lutte contre la migration irrégulière est justifiée par la criminalisation du trafic des clandestins pour… « protéger » les migrants. Bien que dénoncées par les Nations-Unies et d’autres organisations internationales de défense des droits de la personne, ces politiques d’externalisation sont devenues un modèle mondial.
Les politiques de « l’Europe forteresse » et le dense réseau de « sécurité frontalière » sont également exposées : sur quatre personnes qui tentent d’entrer par la mer, une, en moyenne, périt en chemin ! « La doctrine de la dissuasion exige une hécatombe aux frontières pour susciter la peur et prévenir la migration. » Ainsi, la responsabilité des morts est imputée à ceux qui « décident » d’entreprendre le voyage alors qu’une « immense machine à criminaliser » est mise délibérément en place, financée en partie par le « détournement » de l’aide au pays africains. L’auteur présente les différentes routes empruntées, les mesures apparues et les opérations mises en oeuvre par l’UE, souvent travesties en interventions humanitaires, les accords signés avec des pays frontaliers (Maroc, Turquie, Libye, etc) pour « sous-traiter » le contrôle de la migration. Elle explique qu’ « exiger la réforme, voir l’abrogation des politiques frontalières ne suffit pas ; nous devons aussi abolir l’organisation sociale raciale qui criminalise la migration ».
La loi italienne fixe un quota annuel de migrants contractuels et saisonniers autorisés à séjourner et travailler dans le pays, jusqu’à neuf mois par an. Depuis 2018, le Pacte mondial des migrations sûres, conclu sous l’égide des Nations-Unies, facilite la mobilité de la main-d’oeuvre – qui plus est, à bas coût – au moyen de « programmes de migration temporaire, saisonnière, circulaire et accélérée qui permettent de recruter des travailleurs dans des secteurs manquants de main-d’œuvre ». Ainsi, contrairement à la migration permanente, l’ordre social racial n’est pas altéré. Aux États-Unis, en 1942 et 1964, le programme Bracero a organisé l’entrée temporaire de millions d’ouvriers mexicains, dans des conditions précaires, pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. Le programme H-2 lui a succédé. D’autres pays encore ont adopté une réglementation de ce genre, tous observant les mêmes principes : les dispositifs sont cautionnés par l’État et constituent une forme de « ségrégation légale » et d’ « internalisation libérale », un « mode de racisation à part entière » et un régime carcéral qui soumet les migrants à une discipline, une surveillance et un contrôle stricts de tous les aspects de leur vie.
Le système de la kafala régit le travail des travailleurs migrants dans les pays du Golfe persique et concerne 80% des employés privés au Quatar, et jusqu’à 100% aux Émirats et en Arabie saoudite. L’auteure soutient qu’il s’inscrit dans le continuum des programmes de migration de main-d’oeuvre à travers le monde, plutôt que dans une tradition culturelle. D’ailleurs, ses fondements administratifs remontent au règne colonial britannique. Pour endiguer le nationalisme panarabe, au moment de la nationalisation du pétrole par le premier ministre iranien Mohamed Mossadegh et de celle du canal de Suez par Nasser, les monarchies régnantes ont acheté la loyauté des citoyens en leur permettant de bénéficier des revenus du pétrole, tout en remplaçant la classe ouvrière par une main d’oeuvre migrante privée de pouvoir de négociation et du droit de citoyenneté. Au départ, les travailleurs provenaient d’Égypte, du Yémen, de Palestine, mais arrivent désormais du Bangladesh, d’Éthiopie, d’Inde, d’Indonésie, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de Thaïlande et du Sri Lanka, voient leur passeports confisqués et de nombreuses heures travaillées non payées, subissent des violences, voire des séquestrations. Elle décrit l’instauration de ce régime de citoyenneté exclusif et de ségrégation légale comme un détournement de la conscience de classe au profit de la conscience nationaliste.
Au Canada aussi, les travailleurs migrants occupent les emplois les plus dangereux et les plus vitaux pour l’économie canadienne. Depuis 2002, leur nombre a quadruplé. Privés des droits fondamentaux et des avantages sociaux accordés aux citoyens, perçus comme des intrus, ils sont exclus de l’État-nation. Harsha Walia revient sur les origines du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) à la fin du XIXe siècle et devenu référence mondiale en matière de migration de travail. Elle dénonce la célébration du multiculturalisme canadien pour masquer le maintien de « cette inclusion sous forme marchandisée par la gouvernance capitaliste raciale ». Les ouvriers agricoles, par exemple, sont souvent expulsés pour raisons médicales alors même qu’ils ont été soumis à des examens médicaux approfondis avant leur arrivée.
Le dogme de la citoyenneté raciale est défendu par tous les gouvernements d’extrême droite sur la planète : avec Donald Trump aux États-Unis, Benjamin Netanyahou en Israël et Narendra Modi en Inde, dont le point commun est l’islamophobie. Bien qu’antisémites, les organisations suprémacistes blanches soutiennent Israël, comme modèle d’État ethnonationalistes fondé sur la spoliation et la ségrégation. L’hindutva est également une idéologie politique ethnonationaliste qui milite pour la création d’une nation hindou, le maintien du système des castes et l’expansion de celle des brahmanes. En 2019, Modi a annexé le Cachemire, mettant fin à une longue occupation coloniale. Alors qu’il était ministre en chef du Gujarat, en 2002, 2000 musulmans ont été massacrés et 200 000 déplacés.
Le populisme pénal est utilisé pour renforcer « l’organisation sociale de la différence » et perpétuer « la guerre de classe raciale ». Le président Rodrigo Duterte, aux Philippines, et Bolsonaro au Brésil s’en servent pour accroître la militarisation du contrôle social.
Harsha Walia analyse aussi comment la xénophobie contribue à l’arrivée au pouvoir de dirigeants d’extrême droite, notamment dans les pays qui abritent les populations de migrants les moins nombreuses (Pologne, Hongrie, Suède, etc). Elle explore les connexions idéologiques entre le libéralisme et l’extrême droite : « le multiculturalisme libéral produit et essentialise l’ethnicité et la race pour en faire des marqueurs de la “différence culturelle“ sur laquelle se fonde le racisme démographique de l’extrême droite. »
L’apatridie est un autre instrument de discrimination et d’oppression. La citoyenneté est utilisée comme « un moyen de gouvernance sur la vie ».
Étude quasi-exhaustive qui donne à comprendre l’immigration dans sa dimension systémique et historique. On peut s’étonner qu’un grand pays manque dans ce panorama détaillé, la Russie, mais cela n’enlève rien à l’ampleur et à la qualité du travail accompli.
Ernest London, Bibliothèque Fahrenheit 451, 17 mars 2024.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte