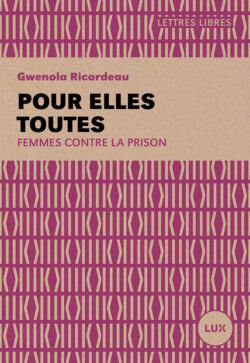Sous-total: $
Un système pénal à abolir: perspectives féministes
Dans son essai Pour elles toutes. Femmes contre la prison, Gwenola Ricordeau propose une réflexion sur l’abolition du système pénal (police, justice, prison) d’un point de vue féministe, à contre-courant des courants dominants du féminisme qui prônent un recours toujours plus accru au pénal.
Peut-on se passer du système pénal pour défendre les droits des victimes de violences sexuelles ? L’autrice propose une réflexion sur l’abolition du système pénal (police, justice, prison) d’un point de vue féministe, fruit de son expérience personnelle, militante entre la France et les États-Unis et de ses travaux universitaires en criminologie menés en Californie. Elle décrit dans son ouvrage les impacts du système pénal sur les femmes victimes de violences sexuelles, mais aussi les causes et les conséquences sociales de l’incarcération, quand des femmes sont condamnées, ou quand ce sont des proches qui se trouvent en prison.
Le système pénal protège-elles femmes victimes de violences sexuelles ? Répond-il à leurs besoins? D’après Gwenola Ricordeau, cela semble difficile. Tout d’abord, une partie de la criminalité échappe au système pénal, du fait même de son fonctionnement. Pour qu’une infraction soit reconnue, il faut porter plainte. Combien de femmes victimes de violences osent entreprendre cette démarche au commissariat ? Combien sont-elles à être mal reçues, à repartir sans que leur plainte soit enregistrée ? Et même s’il y a un enregistrement de la plainte, rien n’assure qu’une suite lui sera donnée. Il y a donc une énorme différence entre la criminalité réelle subie par les victimes et celle que traite le système pénal. Ainsi en France, sur 93 000 femmes violées en 2018, seules 10% d’entre elles portent plainte, et seules 10% des plaintes aboutissent aux assises. L’impunité est totale.
À cela s’ajoute des condamnations influencées par les caractéristiques des victimes : les crimes commis à l’encontre des femmes les plus pauvres, issues de minorités ethniques, ou prostituées sont moins punis que les autres.
Et on ne peut que le constater : le système pénal ne répond pas aux besoins des victimes, et ce pour une raison simple : la qualification des faits et de leur gravité ne correspond pas forcément à l’expérience même de la victime. Un des exemples les plus courants, c’est la correctionnalisation du viol, ce processus judiciaire qui « transforme » un viol, crime jugé aux assises, en agression ou atteinte sexuelle, délit jugé en correctionnelle. Si on rajoute le risque que le système pénal ne reconnaisse pas le préjudice, et que la parole de la victime soit mise en doute, on assiste alors à une victimisation secondaire de la personne ayant subie des violences sexuelles.
La réponse pénale n’est donc pas à la hauteur des enjeux : elle alimente le patriarcat, le racisme et le mépris de classe, ne répond aucunement aux besoins des victimes, et ne prémunise pas d’un risque de récidive des agresseurs. De plus, pour G. Ricordeau « la gestion, par le pénal, d’une situation problématique entraîne une perte, pour la collectivité, de la possibilité de changer ce qui l’a rendu possible (situation et normes sociales) ».
Comment dès lors s’émanciper de ce système étatique, et de construire une réponse collective ? L’abolitionnisme pénal féministe donne des pistes dans ce sens, en permettant « d’échapper à la reproduction des rapports de domination auquel concourt forcément le système pénal » explique l’autrice, et de rompre avec le « carcéralisme féministe » en construisant une « résistance à la pénalité ». Gwenola Ricordeau, présente trois outils permettant de construire une autonomie collective pour gérer des situations problématique : la justice réparatrice, la justice restaurative et la justice transformative, qui s’inspirent de pratiques provenant des cultures autochtones nord-américaine et océanienne.
La justice réparatrice repose sur le concept « d’humiliation réintégratrice », c’est-à-dire que la condamnation d’un préjudice ne s’accompagne pas de l’exclusion sociale de son auteur. Le problème , c’est que cette pratique ne peut pas garantir la sécurité des victimes de violences commises par un proche (au domicile, sur le lieu de travail, etc.).
Développée dans les années 70 en Amérique du Nord, la justice restaurative mise sur la restauration des liens sociaux et la résolution d’un conflit. Une pratique notamment récupérée par le système pénal canadien, en organisant des « cercles de réconciliation », rencontres entre victimes et agresseurs.
C’est en réaction à cette récupération, que la justice transformative (JT) naît dans les années 2000 autour du concept de « responsabilité communautaire », développé par Incite !, une organisation abolitionniste féministe américaine. La JT comporte quatre aspects : le soutien à la personne survivante, sa sécurité, et son autodétermination ; la responsabilité de l’agresseur et son changement de comportement ; les changements communautaires en faveur de valeurs et de pratiques non oppressives et non violentes ; enfin, les changements politiques et structurels des conditions qui permettent au préjudice de se produire.
Les expériences de JT ont montré qu’il est très difficile de sortir cette pratique des réseaux militants, car pour pouvoir en bénéficier il faut donc déjà posséder un certain « capital militant ». Et comme les pratiques ne sont pas déléguées à des professionnel·les, il faut du temps et de l’investissement personnel, les femmes et les personnes LGBTQ ayant tendance à s’y consacrer davantage que les autres. Surtout, le concept de « responsabilité communautaire » repose sur la bonne volonté de l’agresseur à participer au processus, et à s’engager à travailler avec la communauté. Enfin, la justice transformative est parfois démunie face à des situations complexes, par exemple lorsqu’il y a des violences physiques graves.
Perfectible, la JT « ne garantit pas une future abolition du système pénal. Elle est néanmoins nécessaire aux communautés les plus impactées par son existence » précise Gwenola Ricordeau. Elle reconnaît par ailleurs que le recours au pénal est parfois la seule solution à une situation d’urgence, et que le non recours à ce système peut aller de pair avec la possession de certains privilèges (environnements social, familial, communautaire protecteurs).
Victor Vassili, Mediapart, 1er octobre 2020
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte