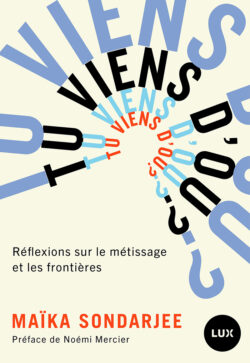Sous-total: $

Un livre petit, mais immense par son contenu et ses réflexion
Avec son livre intitulé Tu viens d’où? – Réflexions sur le métissage et les frontières, Maïka Sondarjee, professeure agrégée à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa, «raconte son histoire, mais aussi celle de toutes les personnes dont la peau est une mosaïque et qui, comme elle, habitent plusieurs mondes. En s’attardant notamment à l’histoire des mariages mixtes, au phénomène du white passing (passer pour blanc) et au colorisme, [elle] s’interroge sur la manière dont les généalogies transnationales et postcoloniales façonnent l’identité des individus et leur rapport au monde».
Préface – Veuillez cocher toutes les cases applicables : Noémi Mercier, journaliste et chroniqueuse, raconte que c’est surtout l’été que sa peau ressemble à celle de sa mère, née aux Antilles. Cette métamorphose est telle qu’elle se sent changer d’ethnicité. Ce genre de fluidité identitaire est loin d’être rare et est le propre des personnes «qui ont grandi au croisement de plusieurs cultures, langues ou religions». Elle présente aussi des données montrant que les gens avec une mixité ethnique ont tendance à modifier plus souvent que les autres citoyen·nes leur réponse sur le sujet entre deux recensements, dépendant souvent de leur lieu de résidence et de l’ethnie de leurs voisins. Elle est ravie que Maïka ait mis des mots sur la réalité des personnes mixtes. Elle réalise maintenant pleinement «que ce sont les cases qui sont déficientes, pas les êtres qui ne savent pas s’y retrouver» et se sent plus à l’aise d’habiter la frontière.
– Du pouding chômeur et des samosas : L’autrice raconte quelques anecdotes sur les familles de ses parents, une issue de Madagascar et avant de l’Inde (du Gujarat musulman), l’autre du Québec.
Introduction – Tout, partout, tout à la fois : «Ce livre porte sur les frontières. Pas celles qui divisent, mais celles qui unissent. […] Il raconte le métissage, l’immigration et les tiraillements chez ceux et celles qui,comme moi, ne rentrent pas dans une case, qu’elle soit noire ou blanche». L’autrice ajoute que son histoire est aussi celle de nombreuses personnes qu’elle a rencontrées et qui sont biraciales, multiraciales et métissées qui, comme elle, ne savent pas trop comment s’identifier ou répondre à la question du titre de ce livre. Comme Noémi Mercier, elle varie ses réponses d’un recensement à l’autre. Elle conclut cette introduction en expliquant qu’elle a écrit ce livre parce qu’elle aurait aimé qu’il existe quand elle avait 14 ans.
– Mon oncle Nazir : Il s’agit de son oncle qui a pris le rôle d’un grand-père pour l’autrice, parce que le père de son père est décédé avant même sa naissance et que Nazir était l’aîné des 16 enfants de sa famille et son père était le plus jeune. Au moins six d’entre eux ont immigré au Québec, à Sherbrooke.
1. Se sentir chez soi : Elle raconte ensuite d’autres anecdotes sur la famille de son père, dont ses voyages au Madagascar à 19 ans et en Inde au Gujarat à 24 ans. Elle explique que le sentiment d’appartenance fait partie de notre identité et influence notre interprétation de l’histoire. La communauté d’appartenance peut être plurielle et est souvent mouvante.
– Pure laine? : Alors qu’on lui pose souvent des questions sur la pauvreté de la famille de son père, c’est plutôt la famille de sa mère qui l’était vraiment. La sienne aussi a eu ses passes de pauvreté, mais pas de façon prolongée.
2. De l’illégalité même dans l’amour : L’autrice cite des données qui montrent la forte hausse des unions mixtes et du nombre d’enfants mixtes au Canada et aux États-Unis, puis sa hausse en France jusqu’en 2013, suivie d’une baisse due au changement de la réglementation sur l’attribution de la citoyenneté française (rendue plus difficile aux personnes étrangères). Elle présente ensuite :
- les conséquences de la mixité issue de viols d’esclaves aux États-Unis;
- la ségrégation raciale même après l’abolition de l’esclavagisme;
- l’abolition des lois interdisant les mariages mixtes par la Cour suprême en 1967 (!);
- l’existence de telles lois dans d’autres pays et les années de leur abolition;
- des manifestations et des actes violents contre ces mariages au Canada;
- des violences plus incisives contre les femmes dans ces cas, blanches ou pas;
- les articles sexistes à ce sujet dans la Loi sur les Indiens jusqu’en 1985, mais aussi la persistance de ces réglementations dans certaines réserves;
- l’évidence de la fragilité des droits des femmes dans ce domaine comme dans d’autres;
- la rareté de la présence de couples mixtes dans la publicité, au cinéma et à la télévision aux États-Unis, et les réactions violentes de spectateur·trices lors de ces rares représentations.
– Se voir pour exister : L’autrice raconte des anecdotes de son enfance qui sont liées à sa mixité, notamment dans ses amitiés quand elle était à l’école primaire. Ses expériences, à cet âge et par la suite, semblent indiquer que les personnes mixtes se reconnaissent, même quand leurs mixités sont bien différentes. Elle poursuit en montrant à quel point il est important pour un·e enfant de se reconnaître au moins un peu et de temps en temps dans des personnages de films ou de bandes dessinées, ou dans des vedettes de la télé ou de la chanson.
3. Métissage: tare ou panacée? : L’autrice raconte les mythes qui ont circulé jusqu’au XIXe siècle (et par après chez les eugénistes, dont les nazis) sur les personnes mixtes qui seraient moins brillantes, en moins bonne santé et j’en passe. Au XXe siècle, ce fut l’inverse, les personnes mixtes permettant de varier les gènes de l’humanité et de la rendre plus forte, plus égalitaire et plus résistante, mais ayant aussi «l’avantage» de faire disparaître les cultures minoritaires. Elle rappelle qu’une forte proportion de la mixité est due au colonialisme et aux guerres coloniales, ce qui n’a rien à voir avec l’entente entre des peuples différents! De même, ces théories semblent ne pas savoir que les deux familles des couples mixtes ne s’entendent souvent pas entre elles (euphémisme). Elle explique aussi en quoi consiste le colorisme, une forme de discrimination à l’intérieur d’une communauté, avantageant en général la personne mixte plus pâle (mais parfois l’inverse).
– Le bruit des origines : À une fête scolaire sur la diversité, l’autrice s’est retrouvée avec les personnes venant de l’Inde et son frère avec celles venant du Madagascar! Elle raconte ensuite un voyage fait avec son père à Madagascar, où son comportement était assez différent, se retrouvant dans un autre chez lui.
4. Pas tout à fait blanche : Selon les ethnies des parents, certaines personnes mixtes passent plus souvent pour blanches que d’autres. Elle raconte des anecdotes sur des stratégies adoptées par des personnes mixtes pour passer pour blanches. Elle-même est passée pour toutes sortes d’origines selon l’endroit où elle se trouvait et l’origine des personnes qu’elle croisait, sans pourtant chercher cette confusion. L’inverse aussi existe, comme les histoires de fausses origines autochtones dans des milieux universitaires et politiques. Elle ajoute s’être étonnée de son émerveillement de constater que sa fille avait plus son teint que celui de son conjoint. Elle aborde aussi :
- les points communs et les différences entre la situation identitaire des personnes mixtes et celle des enfants issus de l’adoption internationale;
- l’utilisation de la mixité comme outil de domination dans l’entreprise coloniale;
- la modification des noms des personnes colonisées par les instances coloniales;
- sa difficulté à répondre quand on lui demande si elle se considère comme racisée ou pas.
– La Bible et le Coran : Après avoir lu tous les livres d’Agatha Christie avant de se coucher, l’autrice a décidé de lire la Bible et le Coran pour tenter de comprendre les croyances de ses parents (qui croient «avec plus ou moins de conviction» dans les deux cas) et ce qui les distingue. Elle raconte ensuite quelques anecdotes sur la religion vécues dans sa famille, et ajoute qu’elle et son frère sont baptisés.
Conclusion. Au seuil d’une pensée frontalière : «Je suis d’origine indo-malgache et franco-canadienne. Du mélange entre ces mondes, de cet espace frontalier, émerge quelque chose de nouveau». Et ce nouveau est une autre identité, et non seulement un mélange des identités de base. Elle voit aussi la traduction de textes comme un partage et un contact entre des gens, et non pas seulement comme un pont entre deux langues. L’autrice ajoute qu’être différent de quelqu’un d’autre ne veut pas dire lui être supérieur. Elle commente ensuite l’existence et le rôle des frontières entre les États, parfois totalement arbitraires, qui causent de nombreux décès et drames familiaux, et qui n’empêchent jamais la présence à l’intérieur de ces frontières de groupes ayant des identités différentes et qui ne reconnaissent pas avec raison ces frontières, comme les Autochtones chez nous. En outre, ces frontières permettent à des États de ne pas reconnaître les mêmes droits aux différents groupes qui y habitent, comme on l’a vu de façon extrême dans quelques pays, dont en Allemagne et en Afrique du Sud, et plus récemment en Israël et même aux États-Unis et en Europe, dont en France.
Les personnes mixtes vivent la présence de diverses nationalités dans un même corps et tentent de les faire vivre en harmonie, montrant que cela est tout à fait possible. Vivre sur la frontière permet justement d’accepter les différences et même de les chérir. La mixité est ainsi plus qu’une identité, elle permet d’accepter et même de valoriser les différences sans les hiérarchiser. Elle passe ensuite à la pensée colonisatrice, qui, elle, hiérarchise non seulement les cultures, mais aussi les langues et les personnes. Par exemple, en imposant leur langue dans les établissements scolaires des pays colonisés, les pays colonisateurs ne se sont pas contentés de s’approprier leurs terres et leurs richesses, «mais aussi leurs univers mentaux». Puis, elle conclut avec une longue citation que je ne peux pas reproduire ici, mais je peux mentionner qu’elle illustre éloquemment le fait qu’habiter le monde n’est pas seulement habiter son petit domaine, ou même le territoire de son pays, mais bien «habiter les histoires et les cultures de l’humanité : endosser ses multiples visages, se sentir héritier des gisements de sens provenant de ses cultures plurielles».
Épilogue – Lettre à mes grands-mères : Cette lettre ne se résume pas. C’est une lettre de remerciement, de reconnaissance et d’amour pour l’héritage culturel qu’elles lui ont transmis. Entre autres!
Et alors…
Lire ou ne pas lire? Lire, sans faute! J’ai simplement adoré ce petit livre. Il est en effet petit par son format et son épaisseur (136 pages, selon l’éditeur), mais immense par son contenu et ses réflexions, comme mes résumés de chapitre l’ont montré, je l’espère. L’autrice nous permet d’entrer dans son monde, dans ses bons et moins bons côtés. Puisqu’il faut bien que je lui trouve un petit «défaut» ou bémol (et encore!), je vais le faire, mais juste pour m’amuser, en espérant que cela vous amuse aussi. Quand elle dit à quelques reprises que les personnes mixtes se reconnaissent, c’est parce que celles qu’elle a reconnues l’étaient. Par contre, elle ne peut pas parler de celles qu’elle n’a pas reconnues ni de celles qui ne l’ont pas reconnue, justement parce qu’elles ne se sont pas reconnues!
Pour avoir un autre son de cloche de ce livre (quoiqu’il ne sera pas très différent…), je suggère aussi la lecture de ces deux articles, un du Devoir et l’autre de La Presse (le pouding chômeur a frappé ces journalistes). Tant qu’à y être, on peut aussi écouter cette entrevue avec Gérald Fillion. Autre qualité, les 79 notes de ce livre, surtout des références, mais aussi quelques compléments d’information, sont en bas de page.
Mario Jodoin, Jeanne Émard, 20 janvier 2025.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte