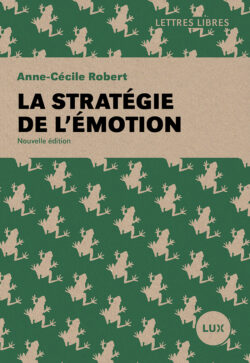Sous-total: $

«La stratégie de l’émotion»: la vérité tronquée des mouchoirs multipliés
Son site Web la décrivait comme une immigrante colombienne, bien qu’elle soit née à Miami. Ses parents avaient dû se dépatouiller dans le prosaïsme de la working class américaine, répétait-elle, alors qu’ils appartenaient plutôt, selon les témoignages de plusieurs de ses proches, à la classe moyenne. Julia Salazar remportait la semaine dernière la primaire démocrate dans le district 18 du sénat de l’État de New York, malgré une campagne durant laquelle elle aura assombri les souvenirs de son enfance — ou omis de corriger certaines inexactitudes biographiques auprès des journalistes — afin de générer de la compassion.
« C’est typique du genre de personnage qu’on est obligés de se fabriquer pour essayer d’attirer la sympathie et qui oblige à se situer sur le terrain de l’émotion, et non pas de la raison. On est désormais obligés, oui, de se créer un personnage de victime de quelque chose ; c’est typique de la dégradation du débat public », observe depuis Paris Anne-Cécile Robert. La journaliste au Monde diplomatique signe La stratégie de l’émotion, examen inquiet d’une époque qui ne saurait plus réagir que sur le mode de l’indignation surperformée, ou du pleurnichage stérile alimentant davantage l’industrie du mouchoir qu’une réelle transformation de la société.
Omniprésence des faits divers, psychologisation outrancière du débat public, « extension du domaine de la larme » : l’émotion empêcherait de penser dans toute leur complexité les enjeux de notre époque. « Ce n’est pas parce qu’on est émus qu’on a compris. On peut même avec émotion se tromper complètement », souligne l’auteure en rappelant les récits alarmés du président américain George W. Bush sur les exactions du régime irakien, ayant jeté les bases d’un appui à la guerre qui transformera à terme la région en poudrière.
Tout en reconnaissant que l’émotion puisse devenir le déclencheur utile d’une saine colère (dans le dossier des réfugiés syriens par exemple), Anne-Cécile Robert rappelle que la larme brouille le regard, et qu’on ne peut jamais présumer de son authenticité. Les sanglots répétés de Justin Trudeau, s’ils signalent sans doute le réjouissant avènement d’une nouvelle façon d’incarner la masculinité, ne valent rien de plus qu’une mauvaise pièce de théâtre s’ils ne sont pas le prélude à des interventions concrètes.
Pourquoi le tronçon de l’autoroute 16, en Colombie-Britannique, surnommé le Highway of Tears parce que 19 femmes (dont 10 seraient Autochtones) y ont été retrouvées mortes n’a-t-il pas été surnommé l’« autoroute de la négligence criminelle du gouvernement canadien » ? demande Anne-Cécile Robert en condamnant un langage médiatique camouflant le politique derrière l’émotif, au nom d’une réaction vive et immédiate, et du clic qu’elle génère sur les réseaux sociaux.
Le culte du fait divers
« Les journalistes se vautrent dans les faits divers parce qu’ils sont faciles à raconter, mais les faits divers ne permettent pas de décrypter la société. Ce sont des petites histoires qui tournent en rond. Elles sont aussi le symbole d’une dérive globale de la société où on se croit toujours obligé d’aller vite, sans réfléchir. Il n’y a pas si longtemps, on était habitués à prendre notre temps, ça s’appelait l’esprit critique, la mise à distance. Mais c’est un conditionnement duquel on peut sortir, c’est une bataille culturelle à mener. On peut refuser d’appuyer tout de suite sur le bouton J’aime, refuser de choisir tout de suite son camp. »
Il n’y a pas si longtemps, on était habitués à prendre notre temps, ça s’appelait l’esprit critique, la mise à distance. Mais c’est un conditionnement duquel on peut sortir, c’est une bataille culturelle à mener.
« C’est surtout la gauche qui, ayant abandonné des grilles de lecture de type marxiste, se reporte sur le terrain des sentiments, pour compenser le vide de son analyse intellectuelle », lance Anne-Cécile Robert. Un changement de paradigme qui aurait débouché sur une « impossibilité de parler de certaines choses parce que vous avez devant vous un interlocuteur qui va revendiquer son émotion, revendiquer de façon péremptoire le fait d’être blessé pour clore toute discussion ».
Ne devrions-nous pas collectivement tâcher, malgré tout, d’écouter ceux qui se sentent lésés par certaines injustices indéniables ? « C’est la responsabilité de la société démocratique d’être attentif à la violence et aux discriminations, mais il y a un danger dans l’exacerbation du discours sur les minorités. L’émotion étant par définition subjective, elle ne peut pas servir de terrain de construction politique. Il faut que les personnes qui vivent une émotion soient capables de la formuler en termes d’intérêt général. Si on reste sur le terrain de l’émotion, on va fractionner la société. Il y a effectivement des discriminations absolument abominables qui durent depuis des siècles, mais la porte de sortie ne peut pas être une situation où chacun se réfugie dans sa minorité, et où il n’y a plus d’intérêt général. »
La nécessaire multiplication des dénonciations, forcément révoltantes, dans la foulée d’un mouvement comme #MoiAussi ne pourrait ainsi faire l’économie, pense l’essayiste, d’une profonde réflexion sur les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, entre les patrons et les salariés, entre les gouvernements et leurs citoyens. « C’est une des questions qu’on pose le moins : existe-t-il une façon non violente, participative, collective d’exercer le pouvoir, ou est-ce qu’il est forcément autoritaire, unilatéral et pyramidal ? »
« On se fait dire qu’on ne peut pas changer les choses, conclut Mme Robert, qu’il n’y a qu’une seule politique économique possible, qu’on ne peut pas faire autrement, mais je ne pense pas que les responsables politiques soient aussi impuissants qu’ils le prétendent. Ils ont construit une impuissance pour faire accepter l’ordre économique et social dans lequel on vit. Ça les arrange de nous offrir comme compensation quelques mouchoirs et le droit de pleurer. On nous a inculqué l’idée qu’il n’y a plus d’ailleurs, qu’il n’y a plus d’autre société possible. Alors, on pleure beaucoup, mais on ne veut plus changer le monde. »
Dominic Tardif, Le Devoir, 22 septembre 2018
Illustration: Tiffet.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte