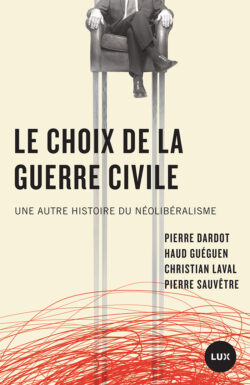Sous-total: $
Recension du livre Le choix de la guerre civile de Pierre Dardot, Haud Guéguen, Christian Laval et Pierre Sauvêtre
« Le néolibéralisme procède dès ses origines d’un choix proprement fondateur, le choix de la guerre civile. Et ce choix continue aujourd’hui de commander ses orientations et ses politiques. »
Ainsi commence ce livre Le choix de la guerre civile, Une autre histoire du néolibéralisme (Lux, 2021), écrit par quatre auteurs (Pierre Dardot, Haud Guéguen, Christian Laval, Pierre Sauvêtre) dans le cadre du groupe d’étude sur le néolibéralisme et les alternatives (GENA), créé en 2018 par Pierre Dardot et Christian Laval à la suite de l’élection de Bolsonaro au Brésil et des victoires électorales de l’extrême droite dans le monde.
Dardot et Laval analysent depuis dix ans avec beaucoup de rigueur scientifique le néolibéralisme, et les ouvrages publiés depuis 2009 [1] nous aident ainsi à mieux cerner ce qu’est le néolibéralisme depuis un siècle. Ce livre s’inscrit explicitement dans la lignée des analyses de Michel Foucault sur le néolibéralime [2].
Rappelons qu’en août 1938 a eu lieu un colloque appelé colloque de Lippmann qui s’est tenu à Paris. Vingt-six économistes et intellectuels y participaient, notamment Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Jacques Rueff et Raymond Aron. Selon François Bilger, ce colloque peut être considéré comme l’acte de naissance du néolibéralisme. Il s’agit de repenser ou reconstruire le libéralisme sur des bases nouvelles. Pour Louis Rougier qui deviendra le penseur de la nouvelle droite, il s’agit de construire les bases idéologiques économiques et politiques d’un système qui s’opposera frontalement au socialisme. Les suites de ce colloque aboutiront en avril 1947 à la création de la Société du Mont Pèlerin, un think tank néolibéral qui travaillera pour que le néolibéralisme gagne sur le terrain des idées et de la mise en œuvre des politiques économiques.
Commençons par quelques précisions sémantiques : libéralisme, néolibéralisme. Le libéralisme, sur le plan économique, est développé par Adam Smith [3], et sur le plan politique on peut citer Alexis de Tocqueville [4]. Les libéraux considèrent que l’État ne doit pas ou très peu intervenir dans le domaine économique et s’en tenir à ses fonctions régaliennes : la fameuse « main invisible » du marché doit assurer tout le reste. Le marché peut s’ajuster en permanence et trouver un équilibre général à condition qu’il ne soit pas perturbé. C’est le fameux « laisser faire » qui sera contesté par John Maynard Keynes après la grave crise économique de 1929, et qui va conduire au New Deal aux USA et à un État social, notamment en France, centré sur une politique de la demande et le partage des gains de productivité.
En revanche les néolibéraux considèrent que l’État doit intervenir pour favoriser le marché capitaliste, la libre concurrence et créer les structures institutionnelles pour aller dans ce sens. De plus, l’État doit être géré comme une entreprise. C’est ce que disent Yann Algan et Thomas Cazenave dans leur livre L’État en mode start-up [5], préfacé par Emmanuel Macron. Le président de la République a aussi déclaré « Une start-up nation est une nation où chacun pourra se dire qu’il pourra créer une start-up. Je veux que la France en soit une. » Des propos tenus le 13 avril 2017 au deuxième Sommet des start-up organisé par le magazine Challenges. L’ordolibéralisme, une variante du néolibéralisme, est mis en œuvre à la fin des années 1940 en Allemagne. Lire à ce propos cet article du Monde Diplomatique d’août 2015.
L’ouvrage découpé en 12 chapitres est fouillé et s’appuie sur une démarche très pédagogique qui permet au lecteur de comprendre à la fois les origines du néolibéralisme et ses conséquences économiques, politiques et institutionnelles. Il détaille les constantes ou ce que nous pourrions appeler les invariants du néolibéralisme, quelle que soit la forme qu’il prend selon les pays et les périodes. Il invite le lecteur à la réflexion, mais aussi à l’action. C’est le sens des alternatives posées dans le dernier chapitre et dans la conclusion.
Une première question m’est venue : pourquoi affirmer que le néolibéralisme fait le choix de la guerre civile ? Selon Pierre Sauvêtre, un des auteurs, « la guerre civile intérieure s’oppose à la guerre interétatique extérieure parce qu’elle est l’affrontement armé entre des citoyens d’un même État, et la guerre civile s’oppose à la politique parce qu’elle est un déchaînement de violence sans règle, tandis que la politique est la suspension de la violence par le règne de la loi. Hobbes voyait ainsi dans la guerre civile une « guerre de chacun contre chacun » propre à l’état de nature à laquelle l’ordre contractuel de l’État mettait un coup d’arrêt, mais dans lequel les individus retourneraient si jamais l’État venait à se dissoudre. La guerre civile et la politique étaient donc pour lui mutuellement exclusives. »
Depuis plusieurs décennies nous avons eu à connaître la guerre économique avec les institutions internationales et européennes, les accords de libre-échange étant un bon exemple ou la mise à genoux de la Grèce en 2015, malgré une volonté populaire affirmée de sortir des injonctions de la BCE et de la Commission européenne. Guerre idéologique aussi : en quelques années, quelques milliardaires se sont appropriés les principaux médias et ce, à l’échelle planétaire (journaux, TV, radios, réseaux sociaux), et enfin guerre culturelle. L’objectif est de discréditer définitivement toute forme de résistance et d’empêcher l’avancée du socialisme dans le monde, socialisme entendu comme remise en cause du capitalisme et du marché tout puissant. Selon Ernest London, dans la revue Lundi matin, commentant le livre « le néolibéralisme est un projet de neutralisation du socialisme sous toutes ses formes. ». Les auteurs affirment (p. 11) que « la guerre civile contre l’égalité au nom de la liberté est sans conteste l’une des principales faces du néolibéralisme actuel considéré sous l’angle de la stratégie ». Nous verrons plus loin que nous assistons à une véritable guerre civile, même s’il n’y a pas encore eu d’insurrection, bien que le mouvement des Gilets jaunes en soit les prémices, ou encore les récents mouvements sociaux au Chili ou au Liban.
Le premier chapitre porte un éclairage sur le coup d’État au Chili le 11 septembre 1973, qui met fin aux politiques menées par Salvador Allende. Le Chili est devenu le premier laboratoire du néolibéralisme ou pour reprendre (p. 27) « la première contre-révolution néolibérale. ». Friedrich Hayek joua un grand rôle d’expert auprès de Pinochet. Ce prix Nobel d’économie sera quelques années plus tard le principal conseiller de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher.
La stratégie qui va dominer est de « s’assurer que les gouvernements à venir ne pourront pas défier directement la base institutionnelle de la transformation sociale néolibérale ».
En clair, il faut inventer des institutions et des dispositifs, qui, quel que soit le gouvernement en place, contraindront les choix économiques et politiques pour empêcher toute alternative. L’objectif est donc d’isoler la démocratie de la politique.
Les auteurs montrent comment, pour les néolibéraux, la démocratie est un danger, ce qu’ils nomment « la démophobie néolibérale ».
Dès les années 1950 ont été entreprises des transformations institutionnelles dans les grands pays industrialisés pour empêcher toute souveraineté populaire de s’exprimer et de mettre en cause les dogmes néolibéraux : on peut citer les fondements de la construction européenne et les différents traités qui ont créé l’Union économique et monétaire et la création de l’Euro. La BCE est devenue indépendante, rendant la politique monétaire hors de tout contrôle démocratique et plus récemment se sont multipliés les accords de libre-échange qui font la part belle aux firmes multinationales pouvant contraindre les États à payer de fortes sommes (plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts) en cas de changement d’orientation économique ou de remise en cause de certains traités. Ainsi, au fil des décennies on constitutionnalise le marché et sur le plan de l’éducation et de la culture (on peut citer la stratégie de Lisbonne en 2000) puis le traité de Lisbonne en 2007 qui a été ratifié par les États membres malgré une forte opposition des peuples de plusieurs pays dont la France (Le référendum en 2005 a donné une victoire du NON à 54,68 %)
Selon les auteurs, Hayek affirme que « la majorité du peuple ou ses représentants élus n’a pas le droit de toucher aux lois fondamentales du marché qui protègent les droits des individus ». Il s’agit donc de limiter la marge de manœuvre des gouvernements et a fortiori toute souveraineté populaire sur les choix en matière de politique économique. La constitution européenne et la fameuse règle d’or que certains voulaient inscrire dans la constitution en sont un bel exemple.
À l’heure où le néolibéralisme est dominant, cette logique de dépossession du peuple de son avenir devient chaque jour une réalité. Les auteurs nous interrogent : « n’est-ce pas notre propre défaite ? » Depuis trois décennies, nous sommes dans un contexte d’affrontement et le néolibéralisme a réussi à neutraliser ses ennemis et tente de contrer toute forme de résistance, toute lutte émancipatrice collective, appuyé par une répression policière sans commune mesure ; et, récemment, un appel à la sédition de la part de généraux est aussi un symptôme. Le néolibéralisme est aidé dans sa démarche par la social-démocratie et sur le plan syndical par le CFDT. Dès 1983, Jacques Delors met en œuvre la politique de rigueur soutenue par une partie du PS qui va conduire au fil du temps à un amoindrissement des politiques keynésiennes de redistribution, notamment avec la désindexation des salaires sur les prix et la productivité du travail et avec des mesures qui vont transformer la protection sociale. On s’oriente alors vers un « néolibéralisme de gauche » qui sera incarné par Bill Clinton aux USA, Tony Blair au Royaume-Uni et Gehrard Schröder en Allemagne.
Un des objectifs des néolibéraux est de ne pas satisfaire les revendications, de tendre des pièges au mouvement populaire en le poussant à la violence. Récemment, le mouvement « Nuit Debout » faisant suite aux manifestations contre la loi travail et plus récemment le mouvement des Gilets jaunes ont exprimé de la révolte, ou du désespoir, et le mouvement syndical a tardé à s’inscrire dans ce mouvement car il sortait de ses schémas de pensée. Une partie du mouvement syndical n’a pas saisi que le temps « du grain à moudre » selon l’expression d’André Bergeron, ancien secrétaire général de FO, est définitivement terminé.
Les salariés sont mis en concurrence entre eux en multipliant les catégories d’emplois et de statuts. Les auteurs (p. 216) argumentent sur le fait que le syndicalisme fait partie des cibles privilégiées du combat néolibéral. Rappelons à ce propos la bataille acharnée qu’a menée la direction d’Amazon aux USA en 2021 pour empêcher la création d’un syndicat, ou le gouvernement chilien qui a envoyé l’armée pour « mater » la révolte sociale en 2020, ou encore le ministre Blanquer qui traîne devant des conseils de discipline des enseignants qui refusent certains choix politiques. Les services publics sont rongés de l’intérieur et mis en concurrence avec d’autres entreprises. Il s’agit, toujours selon les auteurs, de gouverner contre les populations (p. 231) « la guerre civile dont il est question tout au long de cet ouvrage ne relève pas d’une exagération rhétorique : elle est bien réelle. L’une de ses dimensions les plus manifestes est l’intensité de la répression policière et judiciaire contre tous ceux qui dérangent l’ordre social et osent contester le pouvoir ».
Ainsi, les lois d’exception votées après les attentats de 2015 sont entrées dans le droit commun. Nous sommes donc dans une configuration nouvelle de répression qui, comme le disent les auteurs, nous ramène aux pires moments de la violence anti-ouvrière du XIXe siècle (p. 232), amplifiée par la lutte contre le terrorisme. La lutte contre les populations prend la forme du droit. Il faut, selon les néolibéraux, instaurer un ordre légal pour assurer la toute-puissance du marché. Les auteurs s’appuient sur le cas du Brésil pour étayer leur propos ainsi que sur la période Trump aux USA. « L’État néolibéral est présenté comme le garant de la seule justice qui vaille, celle du marché. » (p 301). Mais les auteurs montrent aussi que le néolibéralisme a évolué afin de devenir attractif pour de larges fractions de la société, notamment dans les classes dominées. Déjà en 1981, le sociologue Michel Clouscard mettait en évidence la tentative du capitalisme de capter de larges couches de la société dans son livre Le capitalisme de la séduction [6].
Après ce constat assez sombre, les auteurs soulèvent quelques pistes dans leur conclusion : faire le deuil de certaines formes archaïques du combat politique, sortir de la forme verticalisée des partis et des syndicats, repenser la conflictualité sociale, repenser la lutte des classes dans le contexte du monde du XXIe siècle. En effet, la conflictualité « n’est pas un résidu indésirable, mais une dimension essentielle de la vraie démocratie » (p 318).
Un livre à lire absolument !
 Mon compte
Mon compte