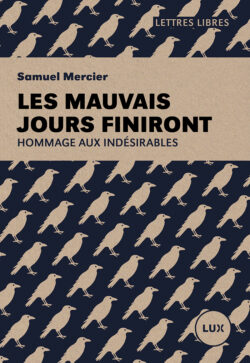Sous-total: $
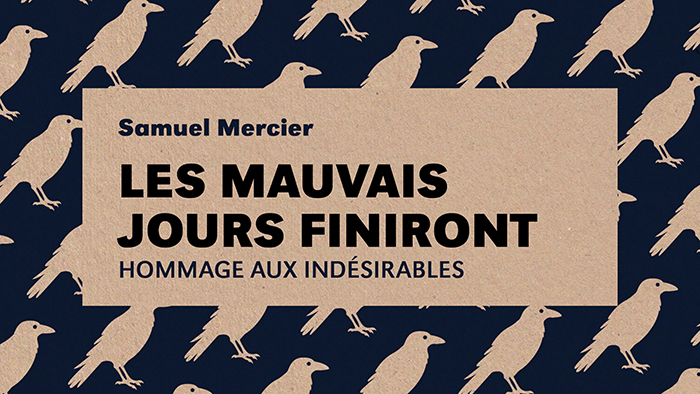
Qui sont les indésirables?
Les mauvais jours, c’était au temps de la COVID-19, en 2020. Le livre commence en coup de poing, on est dans le concret. L’auteur Samuel Mercier a répondu à l’appel du gouvernement et il s’est porté volontaire. Après une formation de quelques heures, il est parachuté chez les mourants, dans un CHSLD, où ça sent la merde et où bien souvent les vies humaines sont réduites «à l’état d’artefacts jetables».
On ne prend plus le temps de s’occuper de nos proches, déplore l’auteur. «Nos cimetières sont des déserts, nos salons funéraires des supermarchés, nos vieux sont rangés dans des tours.» Comme des résidus encombrants qu’on préfère ne plus voir.
(Parenthèse: Quelle différence avec Cuba, petit pays pauvre et exsangue du tiers monde où les vieux se promènent, avec ou sans canne, parmi le vrai monde, en premier lieu les membres de leur famille. Peut-être est-ce un effet de la pauvreté d’échapper aux tours et aux mouroirs institutionnalisés. Alors, vive la pauvreté!)
Samuel Mercier nous décrit avec beaucoup de sang-froid l’enfer quotidien vécu, du temps de la COVID, dans un CHSLD de Montréal. Un enfer qui a dû se répéter en des dizaines d’endroits de la planète. Que des mauvais jours où la solidarité humaine est mise à rude épreuve. On assiste au pire et au meilleur.
Heureusement, il y a la vie, dont le flambeau se transmet de génération en génération, tels des marathoniens qui se savent malgré tout vulnérables et périssables. Mais un monde sans danger est un monde sans vie, affirme-t-il.
Violence libératrice
Aussi, avec autant de dangers, il est impossible de fuir les mauvais jours, qui sont comme la mauvaise herbe, en rappels constants. La pauvreté appelle la pauvreté, la pauvreté est violence et aliénation et humiliation constante. Mais elle forge ses propres héros, ses boxeurs, ses révolutionnaires, ses perdants magnifiques. «C’est Ben-Hur, c’est le Christ, c’est Louise Michel.»
Il faut, dit-il, retrouver l’usage de la violence pour repenser l’égalité des forces. Une violence libératrice qui s’oppose à la violence des milliardaires. «La logique des empires a toujours été de pacifier les peuples conquis», ajoute-t-il.
Dans Les mauvais jours finiront, on passe joyeusement de l’ornithologie à la chasse au chevreuil, en se permettant, mine de rien, quelques réflexions un peu trop faciles à mon goût sur le wokisme, la CAQ à Legault, des commentateurs politiques, habituelles têtes de Turcs d’une certaine gauche pure et dure, et même Madeleine de Verchères, «une sorte de Jeanne d’Arc du pauvre que les nationalistes du tournant du XXe siècle ont voulu édifier en icône de la résistance du Canada français face à l’envahisseur», preuve qu’il reste encore un bon bout de chemin à faire pour que tout n’aille pas si mal, faut-il croire.
Inventer des héros
Au risque de passer moi aussi, aux yeux de l’auteur, pour un «ethnonationaliste», je dirais que le professeur a la choquante tendance à donner des leçons à tout bout de champ, comme si nous, pauvres lecteurs vierges et incultes, étions ses élèves à qui il faut tout apprendre. «Cette tendance forte, dit-il à propos de la pensée conservatrice qui ignore tout de ce qu’elle veut conserver, consiste à poser plusieurs instances comme le peuple, la culture, la langue, la tradition, la race ou le sol sans jamais pour autant détailler la vie vécue.» Mais encore … Et de dénoncer ces soi-disant conservateurs qui n’hésiteraient même pas à inventer des héros de la nation «pour qu’ils puissent servir d’écran sur lequel projeter un imaginaire inexistant dans le réel: une rétrotopie». Si la tendance se maintient, je doute fort que les mauvais jours finiront bientôt.
Jacques Lanctôt, Le Journal de Montréal, 1er mars 2025.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte