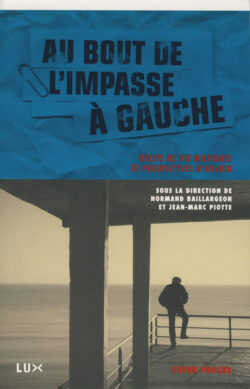Sous-total: $
Quand la gauche se raconte
J’ai toujours trouvé plus respectables les gens qui souhaitent changer le monde pour le mieux que les satisfaits qui justifient leur inaction au nom du fatalisme. Bien sûr, en s’engageant, les premiers se trompent parfois, échouent souvent, mais sans eux le désordre du monde serait encore plus cruel en ce qu’il priverait même d’espérance ceux qui en sont les victimes.
Normand Baillargeon et Jean-Marc Piotte partagent cette conviction. La gauche est leur famille. S’ils reconnaissent qu’elle a eu, depuis une cinquantaine d’années, « une influence considérable », ils savent aussi que cette gauche a toujours été plurielle, animée par diverses tendances, et que, aujourd’hui, elle se cherche. Pour faire le point sur cette aventure qui se poursuit, ils ont cru bon de convier quelques militants à se raconter, à témoigner de leur parcours, de leurs valeurs et de leurs convictions. Au bout de l’impasse, à gauche regroupe donc neuf histoires de vie qui nous offrent, en condensé, le portrait d’une gauche radicale nord-américaine transformée par l’histoire récente, mais toujours habitée par le même sentiment d’injustice devant le monde tel qu’il va.
Tous politisés durant les années 1960, les auteurs invités par Baillargeon et Piotte ont été influencés par le climat idéologique de cette époque. Les Américains Michael Albert et Stephen Shalom, la Canadienne Judy Rebick et le Québécois Louis Gill, qui a étudié à Stanford, ont découvert le militantisme grâce au mouvement des droits civils et à l’opposition à la guerre du Vietnam. À Brébeuf, les jésuites ont enseigné Marx à Pierre Beaudet. Françoise David s’est initiée à l’analyse politique militante en étudiant en service social à l’Université de Montréal. André Dudemaine affirme être « venu au monde, politiquement parlant, aveuglé de lumière, sous la figure christique de Guevara assassiné ». C’est le mouvement européen de désarmement nucléaire qui a entraîné l’adhésion de Dimitri Roussopoulos. Pour sa part, Eliana Cielo, Québécoise d’origine chilienne, doit son engagement à la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) de son pays d’origine.
Aujourd’hui, ils militent tous encore à gauche, mais autrement. C’est que l’expérience, le dur métier de vivre engagé, est passée par là et que le monde a changé. En conclusion, Baillargeon et Piotte notent « la tonalité critique (intellectuelle, morale et stratégique) parfois très vive » qui se dégage de ces témoignages. Les militants, en effet, sont capables de reconnaître certaines de leurs erreurs.
« L’autoritarisme, écrit par exemple Stephen Shalom, est l’une des affections qui affligent la gauche depuis des générations. Une autre a été son attitude non critique à l’endroit des régimes étrangers. […] Lorsque la gauche glorifie des régimes dictatoriaux, elle se nuit à elle-même de bien des manières. » Cette critique est partagée par presque tous les auteurs, dont Pierre Beaudet, qui ajoute : «De missions en missions et de rapports d’enquête en rapports d’enquête, on a compris qu’on avait été instrumentalisés par de lointaines luttes de pouvoir. Instrumentalisés volontairement dans beaucoup de cas, puisque cela faisait notre affaire de croire aux contes de fées.» Françoise David, enfin, insiste : «Aujourd’hui, je peux dire que je tiens, peut-être plus que tout, à la démocratie.»
La deuxième critique principale formulée par les auteurs au sujet de leur propre parcours concerne leur incapacité à proposer des solutions de rechange valables au système qu’ils dénoncent unanimement. « De même, écrit Shalom, si le modèle de société mis de l’avant par la gauche semble aux gens entièrement irréaliste, ils continueront de préférer le statu quo. Bref : seule une vision du socialisme véritablement inspirante et crédible peut donner du sens à la critique socialiste du capitalisme. »
Le cœur du problème
Nous touchons, ici, au coeur du problème de cet ouvrage et de la gauche radicale dans son ensemble. Si cette deuxième critique est juste—et je pense qu’elle l’est—la gauche radicale n’est pas sortie du bois parce qu’elle ne parvient toujours pas à formuler cette solution de rechange inspirante et crédible. Même proposés avec modestie et précaution, le municipalisme libertaire, un modèle du néoanarchiste Murray Bookchin défendu ici par Roussopoulos, et l’économie participaliste, une forme d’autogestion mise au goût du jour par Michael Albert, restent des théories de militants pour militants.
Comme l’explique Jean-François Lessard dans son essai L’État de la nation (Liber, 2007), elles reposent sur un idéal de mobilisation politique totale qui néglige un des acquis de la modernité : «Les partisans d’une démocratie plus directe ont toujours dénoncé la distance entre les citoyens plutôt spectateurs, d’un côté, et la possibilité de débattre et de décider, de l’autre. Au-delà des conceptions doctrinaires, nous pouvons constater que la chose politique n’est qu’un des intérêts de l’homme moderne. L’individu n’est pas exclusivement un animal politique, il est également un être privé. » En faisant l’impasse sur cet aspect, la gauche radicale se condamne à tourner en rond en déplorant l’ignorance politique des masses.
Il est vrai que ces dernières, dans les démocraties occidentales, ont presque toujours rejeté le radicalisme. Elles ont souvent été favorables, cela étant, au réformisme de gauche, à la social-démocratie, qui leur a grandement bénéficié. Lentement, avec des avancées et des reculs, jamais parfaitement, mais néanmoins de manière très concrète. Plusieurs des auteurs de cet ouvrage ne le nient pas, même s’ils considèrent ces bénéfices comme nettement insuffisants. Ils insistent toutefois, en particulier Beaudet et Gill, pour décréter la mort de ce modèle, victime des assauts de la mondialisation.
S’ils n’ont pas tort d’affirmer que le néolibéralisme triomphant a affecté la capacité des États à légiférer dans une optique réformiste de gauche, ils se trompent, me semble-t-il, en décrétant que cette nouvelle conjoncture favorise un retour du radicalisme. Ce qui interdirait la politique des petits pas permettrait les grands ? Drôle de logique pour des militants qui critiquent le fatalisme, et logique, surtout, peu susceptible de convaincre les citoyens de nos démocraties.
« Le Québec, après tout, n’est pas l’Amérique latine et il n’y a pas ici 75 % de pauvres », constate Françoise David. Elle ne dit pas, dans son texte, que cela condamne, ici, le radicalisme et plaide en faveur d’une conversion au réformisme de gauche, mais son action politique récente, qui va en ce sens, parle pour elle. C’est parce que des Québécois croient trouver à Québec solidaire, plutôt qu’au PQ, un parti réellement social-démocrate que cette formation survit politiquement. Le reste est peut-être beau, mais mène à une impasse.
 Mon compte
Mon compte