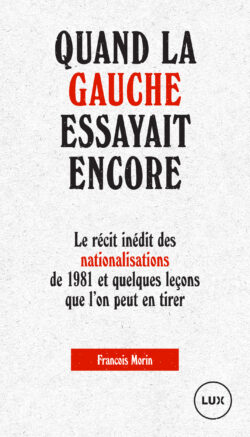Sous-total: $
Pourquoi la gauche n’essaierait-elle pas de nouvelle manière?
L’économiste François Morin vient de publier Quand la gauche essayait encore, Le récit inédit des nationalisations de 1981 et quelques leçons que l’on peut en tirer (Montréal, Lux éditeur, 2020). C’est un livre d’histoire économique et sociale passionnant sur un court instant de la vie politique française, qui eut lieu du début de l’été 1981, après la victoire de François Mitterrand à l’élection présidentielle, jusqu’au mois de février 1982 où fut adoptée la loi sur les nationalisations. Un temps que les moins de 20 ans n’ont pu connaître, mais qu’ils apprendront en lisant ce livre qui a tout d’un thriller à suspense.
Les plus anciens se souviennent sans doute que, en 1972, le parti socialiste, le parti communiste et les radicaux de gauche signèrent un programme commun de gouvernement s’engageant à « réaliser progressivement le transfert à la collectivité des moyens de production les plus importants et des instruments financiers actuellement entre les mains de groupes capitalistes dominants »[1]. Et, dès le lendemain de la victoire de la gauche à la présidentielle et aux législatives qui suivirent, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Pierre Mauroy s’attela à cette transformation profonde de l’économie française, au moment où presque tous les grands pays capitalistes sombraient dans le néolibéralisme qui n’allait pas tarder à triompher.
Une histoire mouvementée
Sauf la France ? C’est là que le livre de François Morin est important. Il nous propose un récit au jour le jour de la « guerre déclarée » (p. 87) entre tenants d’une nationalisation large et ceux d’une nationalisation minimale. François Morin fut, au titre de ses compétences, membre du cabinet du Secrétaire d’État chargé de « l’extension du secteur public » Jean Le Garrec, et il connut de l’intérieur l’âpre bataille politique entre, d’un côté, Mauroy et Le Garrec, et, de l’autre, Jacques Delors et son ministère de l’économie et des finances, pour déterminer trois points cruciaux concernant les nationalisations.
Le premier portait sur le champ des nationalisations à opérer, notamment concernant les banques. En excluant du périmètre les banques sous contrôle de capitaux étrangers, les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, les coopératives ou mutuelles, « le champ potentiel des banques à nationaliser s’élevait encore à 197 banques » (p. 88). Premier débat, premier écueil : quel critère retenir pour déterminer le seuil à partir duquel on nationalisait ? Le montant des dépôts au sein des banques : 400 millions de francs, 500 millions ? L’enjeu était d’« évaluer les conséquences indirectes, vu le jeu des participations financières de l’ensemble des acteurs engagés et contrôlés par l’État », car « d’autres banques visées passeraient indirectement sous le contrôle de l’État, sans être pour autant nationalisées » (p. 93). Si l’on avait suivi l’option défendue par Delors… une seule banque aurait été nationalisée (p. 96). Le débat fut tranché par Mitterrand : le seuil fut fixé à 1 milliard de dépôts, correspondant à 36 banques (p. 97). Pourquoi un seuil aussi élevé ? On se perd en conjectures : s’agissait-il de mettre hors champ « la banque Lazard Frères et Cie, dont le montant de dépôts s’élevait à 800 millions. Une banque aux ramifications internationales très importantes, et symbolique à cette époque de la haute finance » (p. 98) ? C’est l’hypothèse qu’interroge François Morin, sans avoir de preuves.
La deuxième pierre d’achoppement porta sur l’importance actionnariale que devait prendre l’État dans le capital des entreprises : 51 % ou 100 % ? Là encore, réformistes et radicaux s’affrontèrent au sein du gouvernement. Avec un échange d’arguments aussi étonnants qu’intéressants à connaître : nationaliser à 100 % coûtait moins cher qu’à 51 %, parce que, dans le premier cas, on coupe court à la spéculation sur le cours des actions et on est à l’abri de manœuvres d’actionnaires minoritaires. La preuve de manœuvres possibles en fut administrée par la prise de contrôle à seulement 51 % des industriels Matra et Dassault. Ce débat fut alors tranché, à nouveau par le président de la République, en faveur des nationalisations des sociétés à 100 %.
Restait un troisième dilemme : « une question sensible, et pas des moindres : comment indemniser les actionnaires » ? (p. 106). Selon quel critère : le cours boursier ? plusieurs critères alliant la situation de l’entreprise et les profits ? ou, une approche technocratique par des « compétents » ? C’est la position du Conseil d’État qui l’emporta : la méthode dite « multicritère » (p. 108-113).
L’affaire n’en resta pas là, car le gouvernement dut s’y reprendre à deux fois : la loi votée le 18 décembre 1981 vit plusieurs de ses articles invalidés par le Conseil constitutionnel ; celle du 11 février 1982 fut validée par le Conseil constitutionnel. Et il restait un enjeu crucial en suspens : de quelle marge de manœuvre disposeraient les sociétés nationalisées pour rétrocéder au secteur privé des filiales ? Le Conseil constitutionnel pencha pour une position restrictive.
Dernière surprise : le Conseil constitutionnel refusa la méthode « multicritère » au profit d’une indemnisation des actionnaires sur la base du cours boursier des actions pour les sociétés cotées.
Une histoire riche d’enseignements
L’objectif de François Morin est clairement de tirer des leçons politiques pour notre temps, alors que nous devons faire face à une double crise, sociale et environnementale, dont la responsabilité incombe au capitalisme néolibéral qui a tout submergé en quatre décennies. Ce qui apparut d’abord comme une volonté de rompre avec la logique économique dominante fut, en peu de temps, balayé : les privatisations de 1986 et des années suivantes furent encore plus importantes que les nationalisations antérieures et ouvrirent la voie à la liberté pour les capitaux de circuler sans entraves et aux politiques d’austérité salariale. Et on retiendra les anecdotes parlantes de François Morin, racontant les confidences et les regrets exprimés, trente ans plus tard, par Michel Rocard pour avoir accepté, en tant que Premier ministre, la libéralisation des marchés financiers.
Comment concevoir aujourd’hui une transformation de l’appareil productif, au vu de l’ampleur de la tâche et des échecs passés, de façon à éviter un nouveau fiasco ? Dans la seconde partie de son livre, François Morin propose deux pistes.
La première est celle d’une démocratisation radicale des entreprises, tant privées que publiques. Car l’auteur pointe très bien que la principale faille des nationalisations de 1982 était qu’elles furent pensées comme une étatisation beaucoup plus qu’ouvrant la voie à une réelle prise de pouvoir par les travailleurs ou les citoyens. Cette faille était sans doute présente dans le programme commun de la gauche, avant même que celle-ci accède au pouvoir : les bras de fer à l’intérieur du gouvernement de Mauroy n’étant que la suite logique de la béance à l’intérieur du programme commun.[2]
François Morin insiste donc sur l’échec tant de la ligne « étatiste » que de la ligne « réformiste » qui s’étaient affrontées en 1981-1982 (p. 200). Le chantier est alors à rouvrir pour donner corps à une réelle transformation du pouvoir à l’intérieur des entreprises. Il reprend les éléments qu’il avait développés dans des livres et articles antérieurs[3] : « nationaliser des entreprises sans véritablement les démocratiser conduit inévitablement à l’étatisation de leur gestion. Cela peut être nécessaire dans un premier temps, mais n’est pas suffisant pour défendre démocratiquement un intérêt général. C’est ce qu’on pourrait appeler une approche verticaliste de l’appropriation publique. Par ailleurs, on peut subodorer que l’inverse serait tout aussi néfaste. En effet, une démocratisation totale de la gestion d’entreprises publiques, sans gestion cohérente des biens communs, serait également s’enferrer dans une optique horizontaliste du pouvoir. » (p. 201).
Quelle serait alors la solution proposée par François Morin ? « Nous avons avancé deux propositions centrales : l’une a trait au fonctionnement collectif avec la proposition d’une nationalisation-démocratisation du crédit ; l’autre est relative à l’administration et à la gestion des entreprises [privées et publiques], avec l’instauration d’une codétermination à parité entre apporteurs de capital et apporteurs de force de travail » (p. 202).
Arrêtons-nous un instant sur le « contrôle citoyen de la monnaie et du crédit » (p. 165) auquel François Morin fait jouer un rôle décisif dans une stratégie de financement des investissements publics nécessaires à une transition écologique et sociale ?[4] En effet, « les marchés financiers sont dans l’incapacité totale de financer des projets nouveaux » (p. 167). Et cela à l’encontre du mantra néolibéral : « Le financement monétaire du déficit public serait donc assumé politiquement. […] Un contrôle maîtrisé politiquement de la distribution du crédit par un pouvoir citoyen élu est le gage d’une politique d’investissements publics correspondant à des besoins fondamentaux. C’est aussi la possibilité de financer enfin les lourds investissements nécessaires pour la transition énergétique et écologique. » (p. 179).
En terminant son livre, François Morin demande : « pourquoi le système de codétermjnation serait-il plus efficace et pérenne que les nationalisation qui, elles, ont échoué après 1982 ? Tout simplement parce que la codétermination à parité engage une réforme démocratique, radicale et de très grande ampleur, qui serait cette fois-ci totalement irréversible en raison de ses effets économiques et sociaux majeurs. » (p. 206). Un programme… commun à tous ceux qui veulent dépasser la logique capitaliste ? Un beau sujet de discussion en perspective…
[1] F. Morin donne en annexe le deuxième chapitre de la deuxième partie de ce programme commun (p. 211).
[2] Pour l’histoire, rappelons que, en 1972, le PSU (Parti socialiste unifié), avait adopté, dans la foulée de Mai 68, son Manifeste, Contrôler aujourd’hui pour décider demain, Manifeste dit de Toulouse, lors du 8econgrès du PSU les 9, 10 et 11 décembre 1972, Préface de Michel Rocard, Paris, Tema-Éditions, 1972. La gauche était donc déjà fracturée entre une ligne étatiste et une ligne autogestionnaire. Malheureusement, cette dernière s’est également fracassée ensuite entre ladite « deuxième gauche » incarnée par Michel Rocard et la CFDT d’un côté, et les restes éparpillés d’une volonté de rupture avec le capitalisme et le productivisme de l’autre.
[3] F. Morin, L’économie politique du XXIesiècle, De la valeur-capital à la valeur-travail, Montréal, Lux-Humanités, 2017 ; « Engager une économie politique pour le XXIesiècle », Les Possibles, n° 13, Printemps 2017 ; « Réforme de l’entreprise : Un PACTE contre la démocratie économique », Les Possibles, n° 17, Été 2018. J.-M. Harribey, « La valeur-travail à la place de la valeur-capital ?, Note sur le dernier livre de François Morin », Contretemps, 5 juillet 2017.
[4] Je suis d’autant plus sensible à cela que c’est également l’objet du chapitre 6 de mon livre Le trou noir du capitalisme. Pour ne pas y être aspiré, réhabiliter le travail, instituer les communs et sociaiezr la monnaie, Lormont, Le Bord de l’eau, 2020.
Jean-Marie-Harribey, Alternatives économiques, 21 février 2020
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte