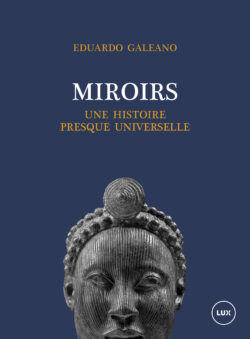Sous-total: $
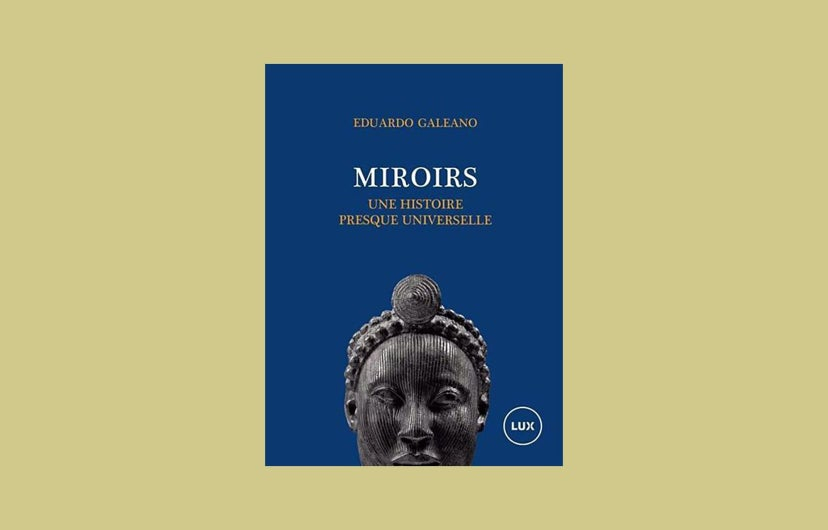
«Miroirs. Une histoire presque universelle»: Le regard d’un humaniste
Après une longue attente, la traduction tant espérée du livre phare Miroirs d’Eduardo Galeano est enfin accessible au public, permettant ainsi aux lecteurs francophones de découvrir l’œuvre sous un nouveau jour.
Moins connu en Amérique du Nord, l’écrivain et journaliste uruguayen Eduardo Galeano, décédé en 2015 à l’âge de 74 ans, est une véritable icône de la gauche latino-américaine qui a consacré sa carrière à chroniquer les injustices de la région. Son réquisitoire choc contre le colonialisme et le capitalisme Les veines ouvertes de l’Amérique latine (Plon, 1971) est d’ailleurs considéré par de nombreux militants comme une œuvre fondamentale et fut interdite lors de sa parution par plusieurs dictatures de l’époque, le Chili et l’Argentine en tête.
L’intellectuel de gauche n’a jamais eu la plume dans sa poche. Son parcours, fortement politique, est le reflet d’une époque tumultueuse. Ses positions et écrits l’ont très tôt contraint à quitter l’Uruguay après le coup d’État militaire de 1973. Sa tête a même été mise à prix. Contraint au départ, il a passé 12 ans en exil, notamment en Espagne, avant de pouvoir retourner en 1985 dans son pays natal, continuant sans relâche à prendre la plume pour dénoncer les iniquités.
C’est en 2008 qu’il publie Miroirs (Espejos en version originale) une histoire non officielle du monde — 5000 ans d’histoire — narrée en petites esquisses, un rapide paragraphe ici, quelques lignes là. Comme dans certains de ses précédents ouvrages, les chapitres sont présentés en forme de courtes capsules. Son style reconnaissable est séduisant. Il nous invite à la découverte. Le livre certes chronologique peut toutefois se lire sans forcément suivre un tracé linéaire.
Contre l’amnésie
L’auteur s’éloigne cette fois de la situation des pays d’Amérique latine et propose une vision globale, à l’échelle de la planète. Il retrace les origines du monde jusqu’à l’époque contemporaine. En ce qui concerne Adam et Eve, l’auteur souligne qu’ils n’avaient probablement pas la peau blanche puisque l’épopée humaine commence sur le continent africain. « Si nous refusons de nous rappeler notre origine commune, c’est peut-être à cause de l’amnésie que provoque le racisme, ou parce qu’il nous est impossible de croire qu’en ces temps lointains, le monde entier, vaste mappemonde sans frontières, était notre royaume et que nos jambes étaient le seul passeport requis », écrit-il.
Dès la première page, le maître à penser prévient les lecteurs que l’essai contient un ensemble de « presque six cents récits » posant parfois les projecteurs sur des figures méconnues ou oubliées de l’histoire de l’humanité. À l’ère où l’intolérance semble s’étendre aux quatre coins de la planète, il revient sur les inégalités que continuent de subir les femmes et les populations visées par les politiques racistes. En visionnaire, il se porte aussi à la défense des laissés-pour-compte, rejetés par un système économique qui ne vise aujourd’hui que la surexploitation des ressources naturelles.
Galeano puise dans une variété phénoménale de sources historiques qui fait de cette œuvre résolument engagée un témoin de son attachement acharné à la lutte contre toute forme d’oppression. La qualité de l’œuvre du regretté intellectuel autodidacte ne réside pas seulement dans la variété d’histoires qu’il raconte, mais surtout dans sa prose raffinée et soignée, traduite avec sensibilité par Alexandre Sánchez.
Ismaël Houdassine, Le Devoir, 15 février 2025.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte