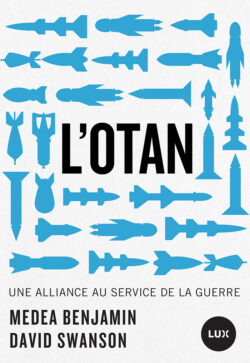Sous-total: $

«L’OTAN», cette alliance guerrière au service de Washington
En quelques mois, le désengagement du gouvernement Trump à l’international et ses menaces annexionnistes ont poussé le Canada et l’Union européenne à renforcer leurs investissements en défense et à réaffirmer le bien-fondé de l’OTAN, au nom de la paix et de la stabilité mondiale. Dans leur essai L’OTAN. Une alliance au service de la guerre, les militants pacifistes Medea Benjamin et David Swanson mettent en cause cette militarisation croissante en exposant les rouages de l’alliance transatlantique et, surtout, son pouvoir destructeur.
« Plusieurs pensent que [l’OTAN] est une institution nécessaire pour le maintien de la paix et du libéralisme dans le monde, mais ils ont besoin de comprendre qu’elle agit en violation flagrante de la Charte des Nations unies et qu’elle est une force extrêmement destructrice plutôt que bénéfique pour notre monde », résume David Swanson en entrevue avec Le Devoir.
Respectivement président de World Beyond War et cofondatrice de Code Pink, deux groupes militant pour la paix, Swanson et Benjamin ont amorcé l’écriture avec la volonté d’offrir aux lecteurs une analyse critique et accessible de l’OTAN, au-delà du discours politique ou médiatique ambiant.
Au fil d’une dizaine de courts chapitres, dans un style vulgarisé aux airs pamphlétaires, les auteurs explorent les origines de l’alliance après la Seconde Guerre mondiale, son fonctionnement, ses liens avec l’industrie de l’armement ainsi que son expansion et ses offensives militaires au fil des décennies. S’y dessine une organisation qui, sous le contrôle des États-Unis et de ses intérêts, s’est étendue au mépris du risque nucléaire, des droits de l’homme et de la paix, jusqu’à contribuer à « provoquer » l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.
« Par provocation, je ne veux pas dire que c’était excusable, permis, acceptable, sans faute ou sans blâme, précise David Swanson. Je veux simplement dire […] que des mesures ont été prises alors qu’on savait qu’elles rendaient [l’invasion] plus probable. » Lui et Medea Benjamin détaillent à ce titre l’intervention de diplomates, de dirigeants américains ou d’experts qui, dès les années 1980, préviennent du potentiel explosif d’une expansion de l’OTAN près des frontières russes, contraire aux engagements réitérés à Moscou par les pays occidentaux dans la foulée de la dissolution de l’URSS.
À la lecture, cette démonstration de l’attitude belliqueuse de l’OTAN fait néanmoins peu de place à la responsabilité militaire de Moscou, à ses aspirations impérialistes ou à ses crimes de guerre. Swanson justifie cette approche par souci de « corriger » le traitement unidimensionnel des médias américains de la Russie et de la guerre en cours. « Les gens ont besoin d’entendre que plusieurs choses peuvent être vraies simultanément. Que le gouvernement russe peut commettre le mal, mais qu’il peut aussi être encouragé dans un cercle vicieux d’hostilité par d’autres gouvernements. » À commencer par celui des États-Unis.
Le militant antiguerre salue à cet égard la reprise du dialogue entre Washington et Moscou, une initiative de Donald Trump, mais il doute qu’un accord de paix soit véritablement durable sans l’inclusion de l’Ukraine, de l’Europe et des provinces séparatistes russes au cœur des pourparlers.
Militarisme trumpien
Parmi les préjugés qu’ils déboulonnent, Benjamin et Swanson s’attaquent dans leur livre à l’idée que le président républicain, qui remet en question l’OTAN depuis 2016, constitue une menace sérieuse à l’alliance ou au militarisme américain.
« Donald Trump a dit beaucoup de choses, mais il n’a jamais fait quoi que ce soit pour nuire à l’OTAN, résume David Swanson. En fait, il est parvenu [durant son premier mandat] à convaincre les membres de l’OTAN d’augmenter leurs dépenses militaires plus que ne l’a fait Biden. » Le militant doute que l’alliance soit mise en péril par le républicain dans les années à venir, citant sa promesse non tenue de réduire les dépenses militaires durant son premier mandat de même que son appui sans réserve à Israël, qui représente un partenaire et fournisseur d’armes important pour l’OTAN.
Autre idée contestée par les auteurs : la légitimité de la cible de 2 % du PIB que devrait consacrer à la défense chaque pays membre de l’OTAN, ainsi que les récentes pressions de Trump pour le porter à 5 %. Ce taux, adopté en 2006 de façon « antidémocratique » sans l’appui des Parlements de chaque pays, est « complètement arbitraire et sans limite », critique Swanson, qui ajoute que l’industrie de l’armement tentera toujours de l’augmenter pour des raisons de profit.
L’écrivain réitère que l’armement militaire, loin d’être un bien public à valoriser, accentue le risque d’apocalypse nucléaire et fragilise la coopération internationale. Il s’inquiète en ce sens de voir l’Union européenne vouloir gonfler son budget de défense au détriment d’autres services publics. « Les États-Unis devraient apprendre de l’Europe, qui a une meilleure espérance de vie, une population plus heureuse, un environnement plus sain et une économie plus durable. Or, c’est le contraire qui se produit », dit-il.
Appel à la résistance
Benjamin et Swanson concluent l’ouvrage avec des solutions de rechange à opposer au militarisme ambiant, au rang desquelles on retrouve la diplomatie du désarmement et le renforcement des conventions internationales pour rendre les États responsables en cas d’infraction.
Pour Swanson, il importe que les pays rehaussent la pression sur les États-Unis pour infléchir leurs politiques étrangères et militaires, à l’image de l’Afrique du Sud qui « a pris l’initiative de faire respecter l’État de droit » en déposant une requête contre Israël auprès de Cour internationale de justice pour « génocide » à Gaza.
Plutôt qu’être un « acolyte » de Washington, le Canada devrait selon lui s’inspirer de cet exemple et « devenir un leader » en matière de droit international, comme il l’a fait durant la guerre du Vietnam ou en 2005 avec la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, signée à Ottawa.
« Il faut défendre un modèle, soutenir ce que les gens veulent vraiment. C’est-à-dire une vie sécuritaire, avec des écoles, de la santé et des hôpitaux, au lieu de toute cette belligérance. »
Simon Gionet, Le Devoir, 22 avril 2025.
Photo: Susan Walsh, Archives Associated Press. Une fanfare militaire passant devant la Maison-Blanche à l’occasion d’un dîner officiel entre l’ex-président américain Joe Biden et les pays alliés et partenaires de l’OTAN, le 10 juillet 2024, dans le cadre du 75e anniversaire de l’alliance.
 Mon compte
Mon compte