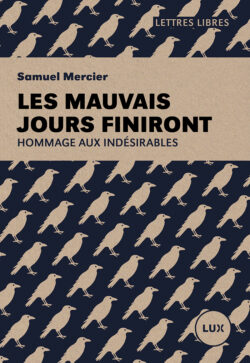Sous-total: $

«Les mauvais jours finiront»: la foi mélancolique de l’historien
Tout droit sorti des foires du XVIIIe siècle, gonflé par le fracas de la Révolution française, le Père Duchesne était un personnage type qui représentait l’homme du peuple. Avec sa pipe et sa moustache, il était le prête-nom d’une « grande colère » qui, à coups de pamphlets aussi colorés qu’indignés, dénonçait les injustices et les abus.
Le Père Duchesne a eu de nombreux continuateurs, entre autres pendant la révolution de 1848 et lors de la Commune de Paris, en 1871. Samuel Mercier le savait lorsqu’en mars 2022 il lui a prêté sa voix et ses idées en créant Des nouvelles du Père Duchesne. Une infolettre anonyme plus ou moins hebdomadaire, « destinée à un public restreint d’une douzaine de personnes », mais devenue grâce au bouche-à-oreille de moins en moins confidentielle.
Une initiative d’abord conçue, explique-t-il, pour répondre aux « guerres culturelles » de notre époque : la « cancel culture », la censure universitaire, le traitement des indésirables dans notre société — comme les vieux ou les migrants.
Les mauvais jours finiront reprend ainsi une vingtaine de ces textes, choisis par Samuel Mercier parmi les plus lumineux et les plus porteurs d’espoir. L’essayiste et poète (Les années de guerre, L’Hexagone, 2014), né en 1986 à Rivière-du-Loup, passé par l’Université du Québec à Montréal et par Concordia, est marqué à gauche et ne s’en cache pas : « Seule l’histoire qui vient d’en bas est en mesure de créer le commun. »
Instruments de résistance face à la « morosité ambiante », ces essais représentent aussi pour leur auteur un véritable « acte de foi ». Car, pour Samuel Mercier, l’optimisme est non seulement possible, il est plus que jamais nécessaire. « Qu’on l’appelle Dieu, le Progrès ou la Providence, l’espoir est le seul véritable geste révolutionnaire quand tout autour est au cynisme et à la débandade. »
« Je me suis mis à beaucoup lire sur ces questions, et les réponses les plus fascinantes que j’ai trouvées dans le fil de mes analyses et de mes infolettres étaient du côté des penseurs américains marxistes », explique-t-il en entrevue. C’est ainsi qu’il en est venu peu à peu à délaisser la question des « guerres culturelles » pour s’intéresser aux mille et une façons dont notre société produit de l’indésirable ou des rejets.
Tous dans le même bateau
D’abord polémiques et incendiaires, nourris d’une certaine fureur, ses essais se sont adoucis au fil des mois, s’éloignant du côté « tonitruant » du personnage du Père Duchesne. Samuel Mercier constate qu’il a été en quelque sorte rattrapé par l’Histoire.
À certains égards, fait-il remarquer, nous vivons aujourd’hui dans un autre monde. « Ce que j’identifiais comme des espèces de tendances médiatiques il y a trois ans, on les revoit aujourd’hui en action, mais de manière beaucoup plus effrayante, avec un pouvoir encore plus grand : on expulse maintenant les migrants par avion, des personnes trans ne peuvent plus avoir leur passeport. On est vraiment dans une période effrayante par rapport à ce que les marxistes appellent la réification des êtres humains, leur transformation en des catégories de choses. »
Car derrière la culture se trouve aussi toute une infrastructure : le mode de production dans lequel on vit, le système capitaliste, qui crée et qui entretient ces dynamiques. « Et je pense qu’il faut avoir une certaine clémence envers les gens. On se ramasse à être tous pris dans le même bateau en ce moment et à devoir trouver des solutions. »
Il y aborde aussi la boxe, la violence, la masculinité toxique. Il se fait critique des « gauches dévitalisées » ou partage avec nous des moments de pêche à la mouche sur la Côte-Nord et dans les Adirondacks. Des textes souvent obliques qui éclairent avec intelligence et une sensibilité combative notre époque menacée par des formes nouvelles d’obscurité.
Samuel Mercier, c’est son ADN, aborde les sujets politiques en historien et en littéraire. Comparatiste, il brasse et multiplie les sources, nous sert un bol d’air frais qui nous empêche de penser en rond.
« En relisant Les misérables il y a quelques années, j’ai été frappé par la foi inébranlable dans le progrès de Victor Hugo, dans l’idée que la justice finira un jour par triompher. Et c’est une chose qui m’a habité par la suite dans l’écriture du Père Duchesne. »
Si notre époque lui apparaît « objectivement mauvaise », la cause est entendue, il n’y a selon lui pas lieu de désespérer ou de s’enfermer dans une position exclusivement critique, au risque de produire du cynisme ou de l’immobilité. « On peut se dire que la connerie finit inévitablement par s’annuler elle-même, par s’écraser en générant ses propres contradictions. Et ce qui sera reconstruit après sera probablement pour le mieux. Je pense qu’il faut garder cette foi. C’est un peu le cœur battant du projet », raconte-t-il.
Un peu partout, il voit des signes que nous sommes « prêts à penser le commun et à travailler pour que notre monde ne soit pas aussi pourri qu’il en a l’air ». Au final, il se dit heureux d’avoir fait un livre dans lequel on parle de réparer le monde, un livre animé par « une espèce de foi mélancolique ».
Résister à l’effondrement
À la base, « simplement athée dans la version classique qui rejette tout en bloc », l’essayiste raconte avoir adopté une position plus ouverte à la suite de l’expérience de la COVID-19, après avoir vu notamment de près certains malades s’accrocher au geste de la prière, remettre leur sort en haut lieu.
En congé forcé comme beaucoup d’enseignants au début de la pandémie, Samuel Mercier avait rapidement répondu à l’appel du gouvernement du Québec en se portant volontaire pour travailler dans un CHSLD. « Un mélange d’énervement par rapport aux messages que je voyais passer sur Internet, souvent très sentencieux, et d’une sorte de bravache d’ivrogne. »
Il lui faudra de longs mois pour repenser à ce qui lui est arrivé. « Je le sentais dans mon corps, écrit-il, mais pas dans ma tête. J’avais vu l’abandon, la mort, la détresse, la peur, mais je ne voyais toujours pas ce qui m’était tombé dessus. »
Pour cet « universitaire repenti », spécialiste de l’histoire culturelle qui enseigne la littérature au cégep de Saint-Laurent, l’expérience a été aussi riche qu’éprouvante. Elle lui a fait voir l’état de décrépitude du lien social, « les vieux qu’on sortait par la porte des poubelles », les déchets humains que génère le capitalisme. « On est dans des sociétés de l’abandon, où le vieux est indésirable parce qu’il est improductif, parce qu’il n’est pas dans la logique du capital. »
À l’heure des amitiés virtuelles et de l’atomisation sociale, il importe de ne pas perdre de vue l’importance des espaces communs. « Il ne faut pas négliger le café du coin, le club de boxe, la chorale. C’est là où on construit quelque chose et où il y a déjà un peu de politique. »
« La mort est au fond une chose assez banale. La solitude est pire que la mort », pense Samuel Mercier, encore ému aujourd’hui lorsqu’il repense au courage de certaines personnes qu’il a côtoyées en CHSLD.
Mais face aux discours apocalyptiques et à la résignation, son point de vue d’historien le porte à replacer ce que nous vivons au sein d’une certaine continuité. « Quand bien même le monde s’effondrerait, il s’effondre déjà depuis des millénaires. L’important est de savoir résister à l’effondrement. L’humanité n’est pas à bout de ressources. Ce n’est pas parce qu’on recule de dix pas qu’on ne va pas avancer ensuite. »
Christian Desmeules, Le Devoir, 1er mars 2025.
Photo: Unsplash
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte