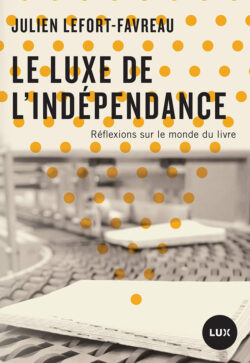Sous-total: $
Les communautés invisibles
Un de mes amis prétend qu’on ne lit plus que les gens qui n’ont pas le temps d’écrire. La vie qu’on mène, il dit. Le travail, les enfants… Même les réseaux sociaux ! Avant, les auteur·rices faisaient leurs livres d’une traite, elles et ils n’avaient pas le temps de s’en tanner. Leurs romans étaient plus homogènes, aussi, leur style n’évoluait pas d’un chapitre à l’autre. Et leurs récits étaient plus suivis, pas morcelés comme les nôtres…
Je ne sais pas si mon ami se trompe, mais il me semble que chaque page que j’écris est arrachée à mes obligations. Pour tout dire, l’essentiel de cet article a été écrit le soir, après mes journées de travail en ligne et le coucher des enfants. C’est l’une des raisons pour lesquelles je me suis tant reconnu dans « 2020_les écrivains et l’argent_ », que Stéfanie Clermont a fait paraître à LQ [NDLR :dans le dossier « La dérive des capitaux » du no 177], où elle racontait comment, pour elle, la possibilité d’écrire était liée à l’accès à l’argent. Avoir de l’argent devait lui permettre d’écrire, mais se présentait en réalité comme une quête circulaire lui prenant tout son temps. Même si j’ai choisi un parcours plus stable (j’enseigne la littérature au collégial), j’éprouve des difficultés analogues. Des gens plus sensés que nous demanderaient : pourquoi continuer ? S’il fallait que chaque personne sentant « l’appel de l’écriture » se mette à barbouiller le monde de ses créations, nous n’en finirions plus. Pourtant, des livres comme Le jeu de la musique, de Stéfanie Clermont (Le Quartanier, 2017), existent, qui justifient bien des mauvais manuscrits.
Écrire a presque toujours été une activité qu’on vole à ce que la vie nous coûte. Sauf exception, au Québec, les personnes qui y ont consacré les meilleures heures de leur existence avaient les moyens de le faire sans en attendre le moindre retour financier. Restent quelques auteur·rices populaires et une douzaine d’autres écrivain·es ayant bénéficié de circonstances socioéconomiques favorables.
Deux régimes de production organisent ce rapport au capital : le premier, marchand, repose sur la croyance que le travail est récompensé financièrement ; le second, qu’il est récompensé symboliquement. Clermont écrit :
Dans le régime capitaliste contemporain, [la] course, non seulement la course à la survie, mais celle à l’amitié, à la légitimité, au simple sentiment d’exister, se déroulent entre ceux qui travaillent le plus fort. L’argent, s’il y en a, viendra à la toute fin. En attendant, il faut faire semblant que de toute façon, l’argent nous importe peu, et que même le regard des autres nous importe peu. On fait ce qu’on fait par amour, parce qu’on est un artiste dans l’âme.
Ici, le leurre de la méritocratie prévalant en apparence dans le monde des arts est parfaitement démonté : il n’y a pas de lien entre la célébration (économique ou symbolique) des oeuvres et leur qualité ; et, si nous arrivons encore à écrire des livres qui nous tiennent à coeur malgré l’indifférence, voire le mépris dont ils font parfois l’objet, c’est que nous en ressentons réellement le besoin, quelque chose comme un appel, dont on peut se moquer, mais qui nous reste toujours tandis que nous envoyons nos enfants à la garderie ou que l’amour de notre vie se couche sans nous.
(Vertige : penser que cette vocation est entièrement construite, que nous n’y adhérons que pour nous sauver du caractère domestique de la vie, et que, pour ma part, je suis précisément en train de passer à côté de tout ce qui pourrait m’extirper de cette domesticité parce que je m’imagine mû par un besoin qui n’a rien de vital ni même de profond. Comme Swann, je me rends compte que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, pour une idée qui n’était rien !)
Mais si j’ai tant voulu écrire, c’est aussi que j’ai tant aimé lire. Or, là encore, le temps me manque. Quels livres valent le temps que je pourrais investir ailleurs ? Est-ce que c’est moi qui ai vieilli ? (Ne dites rien.) Autrefois, certains textes me paraissaient si brillants, audacieux ou radicaux qu’ils semblaient me défier ! Regarde, petit homme, regarde ce que ces gens ont fait ! C’était avec ces textes-là que j’avais envie de parler ; c’étaient les voix qu’ils donnaient à lire que je voulais maintenir en vie, porter un peu plus loin. Aujourd’hui, ces voix se sont amalgamées à la mienne – dans bien des cas, je les ai carrément intégrées à mon discours intérieur –, mais une part de cette admiration émulative s’est émoussée. C’est l’autre raison pour laquelle j’ai tant apprécié l’article de Clermont : parce que j’y retrouvais l’autrice du Jeu de la musique.
Je me rends compte que je brosse un portrait assez déprimant de la situation des écrivain∙es au Québec. Pourtant, de nombreux livres destinés à des publics très restreints y paraissent encore. En comparaison, aux États-Unis, un·e acteur·rice intervient avant même la sélection opérée par les maisons d’édition : l’agent·e littéraire, qui non seulement veille au meilleur placement des livres qu’on lui soumet, mais effectue un premier tri sur la base de critères mercantiles, qui déterminent son salaire. Évidemment, le lectorat américain est assez important pour qu’on y publie encore des livres avant-gardistes tout en gagnant de l’argent, mais on peut raisonnablement penser que la mise en oeuvre d’un système semblable au Québec ferait disparaître la tranche la plus audacieuse de notre littérature. Ainsi, le « combat » qui occupe les écrivain∙es soucieux∙ses d’une littérature non décorative ne concerne pas uniquement la « pureté de l’art », mais « l’indépendance de l’ensemble de l’écosystème éditorial », comme l’écrit Julien Lefort-Favreau dans l’essai qu’il vient de publier, Le luxe de l’indépendance : réflexions sur le monde du livre (Lux, 2021). Plus précisément, explique-t-il :
L’indépendance peut se lire à la lumière du choix, difficile à tenir, de bouleverser les codes d’un secteur de l’intérieur. L’indépendance désigne un entre-deux, contre-institutionnel et institutionnel plutôt qu’anti-institutionnel ou para-institutionnel. Dit autrement, toute déclaration d’indépendance implique, de son énonciateur, l’adhésion à une institution.
Du point de vue de l’écriture, l’adhésion à l’institution fait référence à la reconnaissance du caractère littéraire du texte produit : comme romancier, j’écris un livre que je veux irrévérencieux, disons, mais dont j’espère la reconnaissance de la valeur, malgré ou grâce à son irrévérence, par certaines instances appartenant à l’institution littéraire (par exemple : mon éditeur). L’indépendance, quant à elle, implique une manière spécifique de négocier cette appartenance avec une forme et un « message » qui ne soient pas nécessairement en phase avec les réalités commerciales du marché qui la régulent. Se focalisant sur les cas d’écrivains comme Guillaume Apollinaire ou Olivier Cadiot, ou de maisons d’édition comme P.O.L, Lefort-Favreau affirme qu’historiquement, « la forme incarne un valeur suprême, car elle est associée à une recherche de vérité ».
Dans cette perspective, l’emploi de procédés révélant le caractère fictif du texte de fiction concourrait à une « poétique de la vérité », dans la mesure où le « mensonge » de la fiction y serait donné pour ce qu’il est. Cependant, ce procédé se retrouve aussi bien chez certaines avant-gardes que chez les partisan∙es les plus conservateur∙rices de la « pureté de l’art », qui peuvent avoir avantage à ce qu’on n’associe pas leur oeuvre à la politique (le procédé était fréquent chez les collaborateurs français et s’observe encore chez les néoconservateur∙rices actuel∙les). J’ajoute qu’en dehors de toute considération de forme, le message même pose de plus en plus problème en regard de l’adhésion à l’institution, souvent prête à avaliser des oeuvres dans lesquelles l’attention est en quelque sorte détournée de contenus peu en phase avec les mécanismes de sa propre constitution, par des jeux formels plus ou moins pointus et exigeants, dont elle peut souligner la valeur sans qu’il lui en coûte.
Ce qui m’intéresse dans ce que dit Lefort-Favreau de la forme, c’est que Clermont aussi met de l’avant une sorte de « poétique de la vérité », mais qu’elle n’emploie à peu près pas les procédés évoqués plus haut qui attirent l’attention sur le caractère fictif de ses textes, sauf sous la forme de la mise en abyme. En effet, elle évite l’emphase autant que l’affectation généralement associées à la Littérature, et compte plutôt sur les non-dits que sur l’exploitation des affects. Même si elle ne se prive pas d’une certaine « plus-value » sur la langue usuelle, parlée de ses personnages, une large part de son travail d’écriture vise à en gommer le caractère construit.
C’est un peu triste à dire, mais, en ce sens, l’authenticité ne me paraît pas un critère d’indépendance structurant : ce n’est que le fonds de commerce des avant-gardes, d’Apollinaire à Cadiot et à Clermont, en passant par Huysmans, Morand, Céline, Duras et Quintane.
N’empêche, pour Lefort-Favreau, l’indépendance du monde du livre est intimement liée à la santé de la démocratie, qui repose sur la possibilité d’exprimer des idées différentes, voire radicales. Selon lui, en effet : « Il ne sert à rien de défendre la liberté d’expression et la liberté de création sans garantir l’indépendance et la pérennité des moyens de production. L’indépendance est une manière déraisonnable de publier des livres. » Sans indépendance éditoriale, pas de discours critique : on le comprend bien. Mais la chose est plus difficile à concevoir sur le plan littéraire. Stéfanie Clermont, elle, l’envisage comme une militante, en termes de liens sociaux, lorsqu’elle parle « d’espaces désaliénés. Des espaces où l’on se rencontre, pas pour faire du réseautage, pas pour se filmer, pas pour se faire un nom, pas pour s’applaudir – mais pour se rencontrer. » De tels lieux participeraient au maintien d’une vraie démocratie en ce qu’ils horizontaliseraient les relations entre acteur·rices du milieu, laisseraient la question de l’argent ou du succès de côté, déconstruiraient la figure de l’auteur·rice et favoriseraient l’échange de paroles marginales et peut-être même senties (on peut rêver). Mais, si j’ai à peine le temps de lire et d’écrire, où trouverai-je celui de me rendre en certains endroits pour discuter avec des gens que je ne connais pas (sans compter les difficultés d’ordre psychosocial – et sanitaire ! – que ce geste implique) ?
Reste un lieu où je peux rencontrer Stéfanie Clermont sans risque de m’y faire juger. Malgré le sentiment de ne pas en faire assez, ni pour mes proches ni pour mon travail d’écrivain ; malgré l’impression d’être complètement broyé par les nécessités les plus triviales, je peux encore ouvrir son livre – ses livres, j’espère ! –, lui céder les commandes de mon discours intérieur et retrouver l’oeuvre qu’elle a produite avec ce qui nous aliène et nous broie tous les deux, et les autres avec nous, réunis dans ces petits lieux de papier, espaces abstraits où nous nous retrouvons peut-être mieux qu’ici, et pour plus longtemps, les communautés invisibles.
Stéfanie Clermont, Le jeu de la musique, Montréal, Le Quartanier, 2017, 344 p.
Julien Lefort-Favreau, Le luxe de l’indépendance : réflexions sur le monde du livre, Montréal, Lux, 2021, 168 p.
Jean-Philippe Martel est né en 1976 à Sherbrooke. Il enseigne la littérature au Collège Montmorency depuis 2012. Fondateur du blogue Littéraires après tout, il collabore à L’Inconvénient, Liberté et LQ. Il a fait paraître deux romans : Comme des sentinelles (La Mèche, 2012, repris au Boréal, 2021) et Chez les Sublimés (Boréal, 2021).
Jean-Philippe Martel, Lettres québécoises, no 181, été 2021
 Mon compte
Mon compte