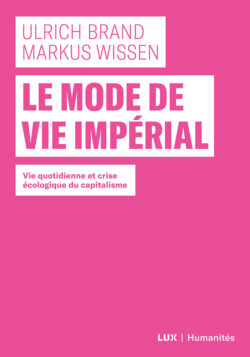Sous-total: $
Le mode de vie impérial. Entretien avec Ulrich Brand

Dans cet entretien Ulrich Brand, co-auteur avec Markus Wissen de l’ouvrage récemment paru Mode de vie impérial – À propos de l’exploitation de l’humain et de la nature à l’époque du capitalisme global (2017), relève un des plus grands défis de la théorie marxiste, à savoir la médiation entre la critique de la vie quotidienne et les structures du capitalisme à l’âge du réchauffement climatique. Loin de la posture moralisatrice écolo-bourgeoise qui juge les individus, Brand indique que le développement inégal du capitalisme à l’échelle globale met en œuvre une intégration différenciée autour de l’automobile. C’est ainsi qu’apparaît le concept de mode de vie impérial, qui va de pair avec d’autres apports théoriques comme la crise socio-écologique et les tensions éco-impérialistes, ainsi qu’avec la critique du capitalisme vert. Au cours de cet entretien, Brand engage le débat avec d’autres penseurs marxistes écologistes contemporains comme Andreas Malm et John Bellamy Foster, et brosse également un tableau instructif sur l’état actuel du marxisme dans l’espace germanophone.
Avant de passer plus directement à votre nouveau livre, qui s’intitule Imperiale Lebensweise – Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus [Mode de vie impérial – À propos de l’exploitation de l’humain et de la nature à l’époque du capitalisme global] (2017), je voudrais vous poser deux questions concernant le marxisme plus généralement. Actuellement, l’espace germanophone se distingue par des travaux très dynamiques sur la théorie marxiste de l’État, souvent inspirés par Poulantzas et Gramsci. D’où vient cette dynamique et comment décririez-vous l’état du marxisme germanophone ?
Nous assistons en effet à un renouveau du débat marxiste en Allemagne depuis la crise de 2007-8. Et dans le débat public l’attention et la reconnaissance sont plus fortes. Cela ne concerne pas seulement les débats relatifs à la théorie de l’État. Certes, il y a la tradition du marxisme occidental, inspirée par Gramsci et Poulantzas, qui met l’accent sur les changements dans la société, l’État et les rapports de force, et qui est étroitement associée à la théorie critique de l’Ecole de Francfort, dont Alex Demirovic est aujourd’hui un représentant éminent. Les travaux relatifs à la théorie de la valeur de Michael Heinrich, qui vient de publier en avril le premier tome de sa grande biographie de Marx, ont également eu un impact considérable. À cela s’ajoute en Allemagne des discussions intenses de Marx par des scientifiques ayant été socialisés en RDA comme Judith Dellheim, Michael Brie, Wolfgang Küttler ou Lutz Brangsch, qui travaillent notamment sur les questions de la transformations sociale. Ensuite, il existe l’économie politique internationale de tendance marxiste qui se développe désormais – depuis le décès récent de son protagoniste Elmar Altvater – notamment autour de Christoph Scherrer à l’Université de Kassel et des chercheurs à l’Université des sciences économiques de Vienne. À l’Université de Jena un groupe très intéressant autour de Klaus Dörre travaille sur la sociologie du travail et la sociologie industrielle et à l’Université de Linz il existe également un cercle intéressant autour de Brigitte Aulenbacher Ils font référence en particulier à The politics of produciton de Michael Burawoy. Puis, en Allemagne le féminisme marxiste a toujours été fort. Dans ce courant Frigga Haug, de la revue Das Argument, est centrale, mais Birgit Sauer à Vienne et Andrea Maihofer à Bâle jouent également un rôle de premier plan. En ce qui concerne la plus jeune génération il faut mentionner Gundula Ludwig et Katharina Hajek. Dans les débats sur l’écologie nous essayons avec Christoph Görg, Markus Wissen, Kristina Dietz et d’autres de répandre en Allemagne l’approche de l’écologie politique. Cette approche ne repose pas exclusivement sur Marx, mais s’en inspire quand même très fortement. La même chose vaut pour les débats postcoloniaux. En philosophie Frieder Otto Wolf et Wolfgang Fritz Haug continuent à jouer un rôle important, mais il existe également une plus jeune génération, incarnée par exemple par Urs Lindner. Parmi les historiens marxistes Marcel van der Linden et David Mayer ont élaboré des contributions importantes. Ce ne sont que quelques exemples qu’il faudrait compléter avec les recherches marxistes en psychologie critique, études culturelles, area studies, littérature et éducation politique critique, ainsi que les recherches sur les migrations. Par contre, dans le marxisme germanophone la théorie de la régulation s’est fortement affaiblie. Créée en France, elle arrive en Allemagne dans les années 1990 où elle a notamment été développé à Francfort, Marburg et Berlin avec des chercheurs comme Joachim Hirsch, Frank Deppe, Elmar Altvater et Birgit Mahnkopf. Aujourd’hui une plus jeune génération – Joachim Becker et Andreas Novy par exemple – tentent de reprendre le fil mais ce n’est pas toujours facile. Ce fait explique pourquoi dans les débats marxistes dans leur ensemble ce courant est moins significatif actuellement.
Par ailleurs, dans l’ensemble je dirais que face aux conditions imposées par le processus de Bologne, à savoir la licence et le master qui représentent deux sections d’études relativement courtes, il est désormais plus difficile de transmettre en profondeur de la théorie sociale critique en général et Marx en particulier. Car l’apprentissage de la pensée critique a besoin de temps et d’espaces de liberté, qui existent de moins en moins avec des cursus universitaires accélérés.
Votre livre résulte entre autres d’une initiative lancée par la fondation Rosa Luxemburg. Vu depuis la France le travail des fondations semble constituer une particularité allemande, dont nous ne saisissons pas exactement la portée. Dans quelle mesure le travail de la fondation Luxemburg représente un appui important pour la recherche marxiste ?
Le livre n’est pas directement issu d’un workshop de la fondation Rosa Luxemburg, mais nous avons discuté les premiers chapitres au sein de la fondation en été 2016. Markus Wissen est membre du comité scientifique de la fondation et depuis de nombreuses années j’y suis actif dans des départements différents. La fondation est très importante car à travers ses publications et ses travaux elle contribue au développement du marxisme. En Allemagne la plupart des chercheurs marxistes gravitent d’une manière ou d’une autre autour de la fondation. La signification de la fondation a été particulièrement tangible en mai dernier : pour les 200 ans de Marx elle a organisé la plus grande conférence de l’espace germanophone dans ses locaux à Berlin. Ce fut un très grand événement, certes avec un contenu plus large, mais cette conférence a montré l’importance de ce lieu pour la discussion d’approches marxistes. Je dirais qu’en soi la fondation est importante pour faire avancer les débats, et partiellement elle fait avancer la recherche. Mais les moyens de son think tank, l’Institut pour l’analyse sociale [Institut für Gesellschaftsanalyse], sont très limités. Néanmoins, il fournit des analyses importantes. De plus, dans les universités comme par exemple de Kassel, Jena, Marburg, Linz et Vienne ou autour de chercheurs indépendants mentionnés comme Michael Heinrich et Alex Demirovic il existe des possibilités beaucoup plus systématiques pour la recherche dans les domaines que j’ai mentionné. Ce que pourrait rendre la fondation plus forte – et elle essaie de faire cela – ce serait de rassembler des approches de recherche et de les rendre accessible pour la politique et le public. La revue « LuXemburg » illustre très bien cette démarche (https://www.zeitschrift-luxemburg.de/).
Passons maintenant à votre dernière publication. Avec Markus Wissen vous avez récemment publié Mode de vie impérial. Dans ce livre vous mettez l’accent sur le concept de mode de vie. Pouvez-vous expliciter à la fois en quoi consiste le mode de vie et son rapport au concept de mode de production, qui est plus répandu dans la pensée marxiste ?
De notre point de vue le concept du mode de production est central. Grâce à ce concept central du marxisme on peut éclairer une bonne part des dynamiques sociales. Or, avec notre livre nous avons voulu mettre l’accent sur le revers de la médaille : le mode de production se concrétise dans la vie pratique. Ce n’est pas si nouveau, notamment quand on pense aux débats du féminisme marxiste. Si nous voulons comprendre pourquoi la crise actuelle ne conduit pas à des changements radicaux, mais à la persistance, au maintien d’un mode de production et de vie précis, alors il nous faut aussi regarder la vie quotidienne et la vie dans les entreprises et les institutions. Il faut regarder la médiation des structures politiques, économiques et culturelles de la mondialisation capitaliste. La nouveauté de notre livre est d’avoir mis l’accent sur cette relation. Nous l’illustrons à l’exemple de la grande importance attribuée à l’automobile dans les sociétés du nord global, mais cette importance augmente aussi dans les pays du sud global. C’est l’industrie de l’automobile avec ses stratégies d’accumulation et son intérêt à générer du profit, mais ce sont aussi les intérêts des employés et leurs représentants ainsi que les politiques étatiques d’infrastructure, de technologie et d’exportation, qui se mondialisent avec avec une violence inquiétante et écologiquement destructrice. Mais justement les désirs et les ambitions de statut de ceux qui peuvent se permettre d’acheter une voiture n’y sont pas pour rien non plus. Je viens de rentrer d’un séjour au Mexique où j’ai tenu des conférences sur le mode de vie impérial et un autre domaine de recherche. Dans l’agglomération de Mexico le nombre de voitures est passé de 3,7 millions en 2005 au montant incroyable de 9,5 millions en 2015. Même à Paris, Berlin ou Vienne c’est difficile à imaginer : c’est un désastre en termes d’écologie, d’urbanisme et de justice sociale. Et c’est en lien avec l’essor de la couche moyenne et son mode de vie. Enfin, je précise que notre livre accorde une place importante au mode de production et sa mondialisation.
Les théories classiques de l’impérialisme raisonnent en terme de période particulière à l’intérieur du mode de production capitaliste. Dans votre concept de mode de vie impérial l’apport de la théorie classique de l’impérialisme, et notamment l’idée de Rosa Luxemburg que le capitalisme a besoin d’un extérieur non-capitaliste, semble apparaître. En quoi le mode de vie impérial a besoin d’un extérieur, d’externalisation ? Et dans quelle mesure ce besoin est susceptible de favoriser des relations internationales conflictuelles et des guerres ?
Vous avez raison, notre livre s’inspire fortement de Rosa Luxemburg et sa thèse selon laquelle le capitalisme a besoin de milieux non-capitalistes et nous arguons que ce besoin est systématique. Le capitalisme se reproduit en tant que rapport global inégal et crée ainsi des îlots de prospérité et des pôles d’accumulation, qui permettent à travers des constellations de compromis de donner une part du gâteau à la population. Mais notre livre est surtout marqué par la crise écologique, ou plutôt la crise socio-écologique. Dans ce cadre, nous arguons que la prospérité matérielle des centres capitalistes repose systématiquement sur l’apport de produits bon marché, l’accès à des puits de carbone, l’exportation de déchets et ainsi de suite. Le mode de vie impérial se caractérise par le paradoxe qu’il est incroyablement attractif et qu’il tend à la généralisation – il suffit de regarder les classes moyennes en Chine, en Inde et au Brésil. Lorsque les revenus et le statut augmentent les gens veulent vivre le mode de vie impérial. Cependant ce n’est pas possible : les téléphones portables, les voitures et la nourriture doivent systématiquement être produits sous des conditions d’exploitation écologique et sociale, car sinon ils ne seraient pas si bon marché et ne seraient pas en mesure d’assurer le mode de vie impérial.
Concernant la deuxième partie de votre question nous parlons de la tendance aux tension éco-impériales. Ce fait est évident quand on s’intéresse aux terres. La concurrence autour de la terre augmente fortement ces dernières années, ce que la science et le débat public discutent sous le terme de l’accaparement des terres. Dans cette dynamique de nouveaux acteurs aussi, pas seulement ceux du nord impérialiste, comme la Chine, la Corée du Sud ou l’Arabie saoudite tentent de contrôler les terres : D’un côté pour garantir l’accès aux ressources qui leur sont nécessaires, de l’autre côté pour faire du profit. Cette dimension est généralement sous-estimée mais avec notre perspective à la fois internationale et éco-marxiste nous sommes en capacité de la prendre en compte.
Dans l’introduction à La rupture écologique Foster, Clark et York écrivent que « le trait le plus important qui distingue la science et l’idéologie établies de leurs équivalents plus radicaux est la tentative de présenter le présent comme a-historique». À partir de votre livre, qui à travers le terme d’impérial renvoie à des rapports dans l’espace, pensez-vous qu’il serait nécessaire d’ajouter à cette remarque l’idée que le présent est également présenté comme a-spatial ?
C’est effectivement une bonne remarque. Mais il faudrait différencier un peu : bien sûr la science de l’histoire existe, mais la grande partie des sciences sociales pense au présent. Cela s’explique par le fait qu’elles se pensent occidentales et qu’elles considèrent que les choses sont bien telles qu’elles sont aujourd’hui. Les rapports réels doivent être masqués systématiquement. L’idée sur l’espace me semble très stimulante mais à nouveau il faudrait faire la part des choses : cela ne s’applique certainement pas au domaine de la politique internationale, qui traite tout à fait d’autres pays et espaces. Or, dans ce cadre il existe l’hypothèse implicite que le système occidental est le meilleur. Il y a donc une hypothèse en terme de théorie de la modernisation. Fondamentalement, la discipline de la politique internationale ne s’intéresse pas tellement aux autres régions du monde, précisément à cause des lunettes de la théorie de la modernisation. Les area studies doivent s’occuper du reste du monde – qui pourtant représente la majorité du monde – et l’idée de la domination de l’occident est maintenue. De plus ils ne voient que peu de relations entre les espaces. Avec le mode de vie impérial nous tentons justement d’éclairer cette dimension. Nous tentons de penser de quelle manière précise les relations systématiquement inégales du capitalisme associent politiquement, économiquement, culturellement et humainement – il suffit de penser aux flux migratoires – les espaces. À mon avis les sciences sociales dominantes s’y intéressent peu parce qu’elles n’ont pas de conception du pouvoir et de la domination. Lorsqu’on pense le pouvoir et l’autorité alors il faut penser historiquement et spatialement, ce qui n’est pas fait de manière suffisante.
Dans le discours contemporain sur l’écologie le travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et le concept d’anthropocène sont largement acceptés par les décideurs politiques. En même temps, les pratiques non-durables persistent. À partir de cette contradiction vous soulignez que dans des conditions capitalistes une crise socio-écologique peut seulement être gérée de manière hautement sélective. Qu’est-ce que vous entendez précisément par cette gestion hautement sélective de la crise ? Et quelle place joue le mode de vie impériale dans cette gestion ?
Il s’agit d’un point central : la crise écologique existe et on en parle dans les plus hautes sphères. On pourrait d’ailleurs ajouter à la liste les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU de septembre 2015 et l’Accord de Paris de 2015. Et pourtant on reste dans un schéma de modernisation écologique : à travers le bon cadre politique les investisseurs et les consommateurs doivent être incités à rendre leurs activités plus vertes. De tout évidence cette approche passe à côté du fondement du mode de vie impérial, qui doit être transformé de manière beaucoup plus systématique. Les rapports de force doivent être modifiés. Les débats du GIEC et des ODD sont des débats d’élites éclairés qui proposent des actions. Or, ils ne s’en prennent pas aux logiques et forces dominantes dans la société. Dans ce contexte, nous avons avec Markus Wissen forgé le concept de capitalisme vert il y a quelques années. L’économie verte représente le projet dominant de l’espoir d’une modernisation écologique au moyen de cadres bien adaptés. Bien entendu dans des pays développés le capitalisme vert provoquerait un changement tout à fait perceptible de l’économie et de la société. D’après cette idée il y aurait des domaines moins durables – l’utilisation croissante de téléphones portables ou la consommation d’une certaine nourriture – mais aussi d’autres domaines plus verts par exemple dans l’énergie ou la production de nourriture. Avec le concept de capitalisme vert nous voulons mettre l’accent sur le fait que dans certains domaines et dans certaines parties du monde une écologisation sélective est à l’œuvre. Dans la mesure où ce processus se déroule sous des conditions capitalistes – et donc sous la logique d’accumulation, de l’État capitaliste et de dynamique expansives – ce processus est sélectif.
De plus, le concept constitue un programme de recherche. De ce point de vue nous nous inscrivons d’une certaine manière dans la suite dans la théorie de la régulation en posant la question de l’émergence d’un nouveau mode de production et de vie ouest-européen – sous l’impact du changement climatique, d’un scandale du Diesel plus ample qui conduiraient à un vrai changement dans l’industrie de l’automobile ou l’industrie agricole par exemple. Dans ce contexte, nous interrogerions de façon analytique, et non pas affirmative – affirmatif signifierait de dire que nous devons tendre vers l’éco-socialisme, et on en parlera sûrement plus tard. Nous disons que tout n’est pas exclusivement du brown capitalism, ce qui nous intéresse sont les dimensions d’une formation lente d’un capitalisme vert. Ainsi, il faut d’abord poser la question de la fonctionalité, des conditions de réalisation : est-ce que les cycles de production dans le département 1 et le département 2 ainsi que les demandes des humains peuvent être assurés ? Deuxièmement, en utilisant Gramsci, la formation d’un capitalisme vert pourrait avoir lieu sous les conditions d’une révolution passive. Autrement dit, il y a une lutte de fractions au sein du bloc dominant et la fraction verte l’emporte. Ce serait donc dans un premier temps une formation par le haut. Néanmoins, il faudrait aussi une sorte de corporatisme vert, notamment dans des pays comme l’Allemagne ou l’Autriche où il y a encore des syndicats relativement forts. Une dimension supplémentaire serait donc que des associations de travailleurs acceptent une économie plus verte. Par exemple le syndicat IG Metall en Allemagne fait face à la crise de l’automobile, et cette crise vient du fait que la Chine s’est reconvertie dans les moteurs électriques pour des raisons compétitives, car elle ne pouvait pas rattraper son retard en matière de moteurs à combustion. Donc comment les syndicats réagissent-ils ? L’État – et ses politiques en matière de technologie, d’investissement et de réglementation énergétique – serait une autre dimension d’un capitalisme vert en devenir. Tout cela devrait s’articuler avec la population dans les centres capitalistes pour qui un mode de vie capitaliste-vert serait attractif. Ils conduirait des voitures électriques et n’achèteraient plus de nourriture industrielle et des vêtement bon marché produits au sud. Avec le concept du capitalisme vert nous abordons toutes ces dimensions. Bien entendu, dans ce cadre la crise aura été traitée de manière sélective, car pour que les conditions de vie restent de haut niveau en Allemagne ou en France, les conditions de vie doivent se dégrader en Amérique latine ou en Afrique qui fournissent les matières premières nécessaires.
Récemment Andreas Malm a argumenté que la critique des personnes qui consomment des produits chinois, et qui de ce fait porteraient la responsabilité du changement climatique, souffre d’un objet manquant. Il souligne que ce schéma suggère d’une part que les consommateurs des pays riches seraient absolument souverains dans leurs décisions. D’autre part ce schéma esquive le fait que les consommateurs occidentaux n’ont pas décidé de délocaliser la production, et donc les émissions en Chine, ils s’y sont même opposés. L’objet manquant sont donc les décideurs des grandes entreprises. Comment articuler la critique de la responsabilité des consommateurs de Malm et votre approche en terme de mode de vie ?
Malm a évidemment raison : les stratégies d’accumulation, les stratégies d’investissement et les décideurs des grandes entreprises sont fondamentaux. Mais à partir d’une perspective marxiste j’ajouterais que dans une entreprise il n’y a pas seulement les décideurs mais aussi d’autres groupes comme les actionnaires qui sont encastrés dans des logiques expansives. Les employés peuvent également avoir intérêt à l’expansion de l’entreprise. Donc je ne réduirais pas les entreprises aux décideurs même si ces derniers sont naturellement centraux dans une entreprise capitaliste. En même temps, j’insiste aussi sur le rôle de la politique car depuis une perspective d’économie politique nous devons toujours voir les intrications entre la politique et l’économie. Je n’oublierais pas non plus les consommateurs et la question de la consommation durable. Dans notre livre nous voulons justement souligner l’ambivalence de pouvoir choisir entre des alternatives, car les humains vivant sous le mode de vie impérial ont des marges de manœuvre.
De plus, Malm – que j’ai rencontré récemment à Malmö en Suède lors de la 6e conférence internationale sur la décroissance, où il a participé à un débat théorique dédié aux approches alternatives – sous-estime la question de l’État. Lors de ce débat, qui a été très intense, Malm s’est laissé aller à dire qu’il nous faut une sorte d’éco-léninisme, une avant-garde, et en fin de compte l’État doit tout arranger. Son message était que l’État doit mener la transformation. À partir d’une vision poulantzasienne je suis sceptique, car l’État est profondément impliqué dans le mode de production capitaliste, qui est fondamentalement non-durable. Les processus de transformation doivent donc être beaucoup plus complexes : il faut des mouvements sociaux, des pratiques quotidiennes, des élites dissidentes et bien sûr d’autres politiques étatiques. Mais j’avais l’impression que Malm homogénéise assez fortement l’État et formule un espoir plutôt abstrait à l’égard de l’État.
Vous écrivez que la mondialisation capitaliste repose sur un compromis politique entre les classes dominantes et une partie des subalternes, qui conduit à l’approfondissement du mode de vie impérial. Cette appréciation ressemble à une sorte de théorie l’aristocratie ouvrière écologique, qui, à l’instar de Lénine il y a 100 ans, explique le réformisme d’une partie du mouvement ouvrier. Qu’est-ce que vous déduisez de ce compromis pour l’élaboration d’un projet hégémonique qui entend rompre avec le mode de vie impérial ?
Cette interprétation n’est pas fausse. Souvent lors de discussions quelqu’un remarque que la plupart des gens du nord global vivent au détriment du reste du monde. Et ce n’est pas faux, mais il ne s’agit pas de déterminer un groupe. Ce qui nous intéresse est de concevoir le mode de vie impérial comme une catégorie de structure. Nous voulons souligner comment les humains du nord global sont systématiquement capturés dans un mode de production et de vie – à travers leur quotidien, leur subjectivité, leur travail, leur production et reproduction – et que c’est à travers ce mécanisme qu’ils gagnent de la marge de manœuvre et de la qualité de vie. Bien entendu à l’intérieur de ce mode de vie il faut distinguer selon les classes, genres et races. C’est une différence par rapport à Lénine.
Concernant la deuxième partie de la question, la grande question d’un projet hégémonique pour une alternative, dans le chapitre 8 nous écrivons de contours d’un mode de vie solidaire. Avec Gramsci, même s’il n’a jamais utilisé le concept de contre-hégémonie, nous nous intéressons à la formulation d’un projet contre le capitalisme néolibéral, impérial et autoritaire. Nous arguons que nous avons besoin de transformations critiques et émancipatrices partout, depuis l’intérieur du mode de vie impérial. Cela concerne des initiatives politiques comme par exemple le débat sur la sortie du nucléaire en France, mais aussi des initiatives économiques en fonction des rapports de force – il n’existe pas d’économie pure, mais l’économie est inscrite dans des rapports de force sociaux, des intérêts et des luttes. C’est pour cette raison que le débat sur le décroissance est important car il met en causse des évidences sociales comme l’idée que la croissance créerait de l’emploi. De plus nous insistons en particulier sur les nombreuses initiatives plus ou moins grandes qui existent déjà et qui réussissent régulièrement à s’imposer contre les schémas dominants : des luttes pour la municipalisation de l’eau et de l’énergie, ou les luttes contre le libre-échange qui créent des espaces pour un projet contre-hégémonique. Par ailleurs, dans les débats à gauche les pratiques sont souvent sous-estimées. Pourtant, dans la société il existe des moments où les humains agissent déjà différemment, même s’ils ne conçoivent pas ces actions comme politiques. Par exemple la voiture à Vienne : il y a quelques années le point de basculement a été atteint, autrement dit le nombre de ménages sans voiture a dépassé celui des ménages disposant d’une voiture. Pourtant malgré un bon réseau de transport public la mairie continue à faire comme si le trafic sur les routes devait continuer à augmenter. En ce moment il y a une polémique autour d’un tunnel qui devrait traverser une réserve naturelle par exemple. Récemment, après des discussions et des protestations pendant des années, il a été décidé de construire le tunnel pour améliorer les flux de trafic de la périphérie vers Vienne. Les préoccupations écologiques sérieuses, qui ont été mis en avant par le parti Vert et beaucoup d’ONG et d’experts, ont tout simplement été ignorées. Ainsi, il ne s’agit pas seulement d’un problème de protection de l’environnement mais aussi du renforcement de l’étalement urbain – et nous savons grâce à de nombreuses études que cela crée encore plus de trafic sur les routes. Le fait que beaucoup de gens n’ont pas besoin d’une voiture fournit une occasion politique. On pourrait dire la même chose à propos de la consommation de viande. Là où les pratiques se modifient nous avons des opportunités. Voilà ce que sont les contours d’un mode de vie alternatif et solidaire. Et nous devons penser internationalement : le principe de la bonne vie pour tous ne peut pas s’appliquer qu’à certains groupes en France, ce qui exclurait par exemple les migrants ou d’autres groupes socialement faibles. Le principe normatif de la bonne vie ne doit pas être appliqué au détriment de certains. C’est notre message politique de base pour discuter d’alternative. Il faut comprendre comment dans la vie quotidienne de quelqu’un à Paris ou à Vienne on peut rendre visible et modifiable le fait que le quotidien repose sur des flux de produits d’autres pays, qui ont été fabriqués sous des conditions sociales et écologiques précaires. Il faut ouvrir le débat sur d’autres formes d’échange international de produits, et sur la réduction et la régionalisation des flux de marchandises. Ce sont des questions relatives au mode de vie solidaire qui visent la construction d’un projet hégémonique alternatif.
Entretien réalisé et traduit depuis l’allemand par Benjamin Bürbaumer.
Période, 6 novembre 2018.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte