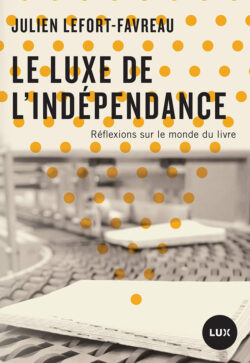Sous-total: $

Le luxe de l’indépendance – Page par page
Les rapports entre idées et argent sont contrariants,
– p. 158
mais ils ne sert à rien de les nier.
Il faut plutôt les démanteler.
En janvier dernier paraissait Le luxe de l’indépendance, le plus récent ouvrage du professeur de littérature française et d’études culturelles Julien Lefort-Favreau. Pour ce dernier, le monde du livre est aujourd’hui confronté à des défis aussi multiples que graves, en ce qu’ils concernent tous ses secteurs d’activité, de la production à la diffusion en passant par la consommation. Sans doute conscient de l’ampleur de son sujet, Lefort-Favreau s’attache surtout à la notion d’indépendance. Celle-ci, remarque-t-il, revêt différentes acceptions selon l’acteur.trice ou le contexte auquel elle est rattachée, et elle constitue donc un point d’entrée tout désigné pour penser la situation actuelle du monde du livre. Empruntant à la sociologie de la littérature aussi bien qu’à la théorie critique, Lefort-Favreau ne se propose toutefois pas seulement d’étudier les variations de sens de la notion d’indépendance ; il s’emploie également à documenter les différentes manœuvres et pratiques par lesquelles les acteur.trice.s du monde du livre se servent de cette notion. Évoquant le cas d’Actes Sud, Lefort-Favreau montre en effet que « la notion d’indépendance se coupe parfois de la réalité qu’elle est censée désigner » (p.59), au point de n’être plus qu’un argument de vente. Car si la célèbre maison d’édition française a longtemps été un modèle d’autonomie et de gageure – sise à Arles, elle se faisait forte de contribuer à la diffusion de la littérature étrangère en France –, elle n’a aujourd’hui plus rien à envier à « Galligraseuil », que ce soit en termes de chiffre d’affaires, de présence médiatique ou de prix littéraires.
Le constat de Lefort-Favreau n’a évidemment rien de très réjouissant. Entre le développement des plateformes de commerce en ligne comme Amazon et la concentration croissante de la sphère de l’édition, il semble que le monde du livre soit dans une posture pour le moins délicate. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai que l’embourgeoisement frappe un nombre toujours grandissant de villes et de quartiers, obligeant certaines librairies à prendre des décisions pour le moins pénibles. Ainsi de la librairie Olivieri, qui bien que située à proximité de l’Université de Montréal – et bénéficiant donc d’une forte communauté de lecteur.trice.s – n’a eu d’autre choix que de passer aux mains de Renaud-Bray en 2016, avant d’annoncer sa fermeture définitive en avril 2020. Face à pareille situation, il eut sans doute été facile de rejouer la scène de « la mort de la littérature ». Or ce que dénonce Lefort-Favreau, c’est moins l’évanouissement du fait littéraire que sa standardisation ; non pas sa disparition ou son épuisement, mais son homogénéisation. Aussi milite-t-il ici pour la création d’espaces de médiation – librairies, maisons d’édition, revues, etc. – qui favorisent la production et la diffusion de ce qu’il nomme des « œuvres complexes », soit des œuvres dont les propositions thématiques, formelles et politiques tranchent avec les injonctions de l’idéologie dominante.
Peut-être verra-t-on dans l’ouvrage de Lefort-Favreau une lecture un peu trop orientée de la chose littéraire. Faisant sienne la théorie des champs de Pierre Bourdieu, on pourrait en effet être tenté de lui adresser le même genre de critiques que celles que l’on a parfois adressées au sociologue français, à savoir que sa manière d’envisager le monde du livre confine la littérature à sa seule dimension politique. De fait, la question de l’indépendance esthétique n’est abordée qu’à la toute fin de l’ouvrage et sert avant tout à montrer que même le plus avant-gardiste des livres – ou des éditeur.trice.s – ne peut jamais échapper totalement à l’emprise de la logique marchande. Or si Lefort-Favreau accorde une telle importance à cette logique, c’est parce qu’il croit que « pour défendre une littérature expérimentale ou une “édition critique”, il faut être lucide quant aux rapports de force qui se jouent à l’intérieur même du champ » (p. 29). Ce n’est pas forcément chose aisée, surtout lorsque l’on est attaché à un certain idéal de l’autonomie de la littérature. Seulement, c’est d’abord en reconnaissant ce que le monde de l’argent fait au monde du livre qu’il sera ensuite possible d’agir en faveur d’une plus grande « bibliodiversité », c’est-à-dire en faveur d’une véritable pluralité de titres, d’idées et de voix. Car, affirme Lefort-Favreau, la signification d’un livre tient toujours à son inscription dans une communauté – celle de la chaîne du livre – aux prises avec des impératifs économiques. Aussi, pour que cette pluralité de titres, d’idées et de voix puisse effectivement être entendue, il est nécessaire de prendre à bras-le-corps la question des conditions matérielles de la chaîne du livre.
Antoine Deslauriers, Page par page, 30 juin 2021
Photo: Antoine Deslauriers
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte