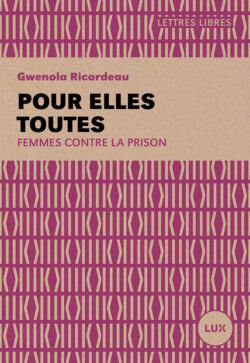Sous-total: $

L’abolitionnisme pénal, une lutte féministe? Entretien avec Gwenola Ricordeau
La notion d’ « abolitionnisme » réfère généralement, dans l’état actuel de notre culture politique, à la suppression de la peine capitale. Dans un contexte où celle-ci est officiellement supprimée, l’abolitionnisme s’est déplacé sur le terrain carcéral et plus largement pénal : en finir avec la prison, voire avec la pénalité elle-même. Cette perspective est notamment nourrie par la pensée féministe, non sans tension. C’est ce nœud qui est au cœur du livre de Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes. Femmes contre la prison (Lux, 2019).
CT : Avant même de te lire, on avait l’impression d’un renouveau ou d’une reprise des réflexions sur l’abolitionnisme pénal. Cette impression te semble-t-elle fondée ?
GR : La vitalité des réflexions suscitées par l’abolitionnisme pénal est incontestable, en tout cas aux États-Unis et plus largement en Amérique du Nord. Cette vitalité se traduit notamment par un champ éditorial extrêmement dynamique en la matière, avec la publication de nombreux livres sur l’abolitionnisme pénal[1] ou plus particulièrement sur l’abolition de la police[2]. La publication d’ouvrages sur la justice transformative[3] et les formes de justice communautaire développées en dehors du système pénal contribue également au foisonnement actuel des réflexions.
Plus généralement, de nombreux ouvrages parus ces dernières années participent à la critique du système carcéral et pénal, notamment sous l’angle de sa nature raciste. Parmi ces ouvrages, ceux de Keeanga-Yamahtta Taylor[4] et Robyn Maynard[5] ont même été traduits en français. Bizarrement, The New Jim Crow de Michelle Alexander[6], qui a pourtant rencontré un énorme succès critique et public, n’a toujours pas fait l’objet d’une traduction en français. D’autres ouvrages récents portent également une critique radicale du système pénal : je pense en particulier à deux ouvrages parus en 2018, Beyond These Walls de Tony Platt[7] et Carceral capitalism de Jackie Wang[8], publié dans la prestigieuse collection Semiotext(e) des presses du MIT et dont la traduction en français parait en ce mois de novembre. À tout cela s’ajoute le dynamisme des recherches entreprises dans le champ de la criminologie critique, que ce soit la criminologie dite « verte » ou marxiste[9].
Par ailleurs, s’il est peu étonnant que l’abolitionnisme soit discuté dans des journaux de gauche comme Jacobin ou The Nation, il est remarquable qu’il le soit aussi dans des médias grand public, comme récemment dans le New York Times ou Politico, mais aussi, au Royaume-Uni, dans Le Guardian. L’abolition de la prison a même été évoquée récemment par la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, représentante du 14e district de New-York au Congrès.
CT : Peut-on dater plus précisément cette tendance ?
GR : L’histoire des idées et mouvements abolitionnistes, des rapports entre les unes et les autres et de la circulation internationale des idées et pratiques militantes n’est pas toujours simple à retracer. L’histoire de l’abolitionnisme pénal reste en grande partie à écrire. Ceci étant dit, le foisonnement intellectuel et militant auquel on assiste aujourd’hui autour de la perspective d’abolir la prison et même le système pénal me semble constituer une « seconde vague » de l’abolitionnisme après celle des années 1970. Cette « première vague » avait notamment été marquée par les travaux de juristes et de criminologues européens comme Louk Hulsman, Nils Christie et Thomas Mathiesen. Dans le champ politique, elle s’est manifestée par le travail militant des quakers en Amérique du nord et la remise en cause de la prison et le soutien aux mouvements de prisonnier.e.s par les organisations révolutionnaires en Amérique du nord comme en Europe.
Cette « deuxième vague » de l’abolitionnisme, qui s’est formée autour de l’an 2000, doit beaucoup au monde académique, mais surtout à la montée en puissance des mouvements abolitionnistes. Je pense en particulier à Critical Resistance, fondé en 1998, qui compte Angela Davis parmi ses initiateurs-rices et qui publie depuis 2005 un journal, The Abolitionist, en anglais et en espagnol. Black Lives Matter a également beaucoup contribué, depuis sa création en 2013, à populariser les idées abolitionnistes.
CT : On peut donc parler d’un véritable « renouveau » de la pensée abolitionniste ?
GR : La manière dont, aux États-Unis, le système pénal et la stratégie abolitionniste sont pensés s’est assurément renouvelée depuis le milieu des années 1990. Sans entrer dans une généalogie qu’il serait fastidieux de retracer ici, on peut néanmoins avancer que trois éléments ont nourri ce renouvèlement. D’abord, la popularité du concept de « complexe carcéro-industriel » (prison-industrial complex), développé à partir du milieu des années 1990. Ensuite, le « tournant racial » pris par les analyses critiques de la prison et du système pénal et qui doit beaucoup à des chercheuses et militantes africaines-américaines comme Angela Davis[10], Ruth Wilson Gilmore[11] et Julia Chinyere Oparah (auparavant connue comme « Julia Sudbury »[12]). Enfin, le phénomène d’« incarcération de masse »[13], qui fait l’objet de nombreux livres[14] et débats scientifiques, par exemple sur le rôle des libéraux dans la mise en place de politiques qui l’ont permis.
Il y a donc un véritable renouvellement de la pensée abolitionniste et de la formulation des débats autour de l’abolitionnisme. Celui-ci tend à moins se focaliser sur la prison et sa critique porte désormais davantage sur l’ensemble du système pénal. Sur le terrain militant, la promotion de la justice transformative a, en partie, éclipsé le soutien aux luttes des prisonnier.e.s. Mais ces tendances ne doivent pas dissimuler que l’abolitionnisme est traversé par de nombreuses lignes de fracture et que celles-ci sont souvent anciennes. Elles découlent des positions variées prises par les abolitionnistes dans les débats, devenus classiques, sur la naissance de la prison et son articulation avec le capitalisme, mais aussi le racisme et le système esclavagiste. Ces lignes de fracture s’expliquent également par la diversité des choix stratégiques, qui sont liés aux traditions politiques variées sur lesquelles l’abolitionnisme s’appuie.
J’espère, pour ma part, voir l’avènement d’une troisième vague d’un abolitionnisme qui soit non seulement anticapitaliste et contre le suprématisme blanc, mais aussi féministe.
CT : À ce propos, peut-on dire parler également d’un renouvellement de la pensée féministe concernant le droit, la justice, la prison aujourd’hui ? Le contexte récent est-il propice de ce point de vue ? Ou bien les contributions majeures restent-elles plus anciennes ?
GR : Même si par beaucoup d’aspects (et notamment son ampleur), le mouvement #Metoo en 2017 est remarquable, il ne me semble pas avoir apportée d’idées féministes vraiment nouvelles sur le rapport au système pénal en matière de violences faites aux femmes. En fait, la dénonciation de l’impunité des auteurs de violences faites aux femmes n’a rien de très nouveau : cette dénonciation a été au cœur des mouvements féministes depuis les années 1970 et, dans un passé récent, on peut penser aux mobilisations féministes en France lors des poursuites pénales entamées à l’encontre de Bertrand Cantat ou de Dominique Strauss-Kahn. Ces mobilisations s’inscrivent parfaitement dans des débats politiques qui, en matière de justice, sont façonnés par ce qu’on désigne par l’expression de « populisme pénal », avec des appels à une criminalisation de davantage d’actes, des peines plus sévères ou la mise en place de nouveaux types de peines, comme la probation.
Aux États-Unis, la réflexion féministe sur le système pénal est plus avancée et critique qu’en France. Cela tient, à mon avis, au fait que l’incarcération de masse affecte particulièrement les femmes. En effet, alors que le nombre des hommes incarcérés a été multiplié par quatre entre 1977 et 2007, celui des femmes incarcérées a été multiplié par huit. De plus, si le nombre d’hommes incarcérés a commencé à diminuer autour de 2009, celui des femmes incarcérées continue, lui, d’augmenter. Par ailleurs, l’incarcération de masse touche également les femmes en raison de la solidarité (matérielle, financière, émotionnelle) et du soin des enfants qui sont souvent attendus d’elles lorsque des hommes de leur entourage sont incarcérés. Si les femmes sont criminalisées comme jamais auparavant, c’est en raison des politiques pénales menées au nom de la prétendue « guerre à la drogue », mais aussi de la lutte contre les violences domestiques.
L’augmentation des poursuites à l’encontre de femmes dans des situations de violences conjugales dans lesquelles elles se défendaient ou défendaient leurs enfants a été le point de départ de nombreux travaux critiques sur l’instrumentalisation des luttes féministes par les politiques pénales, comme ceux de Beth Richie[15] et d’Emily L. Thurma[16]. Ces réflexions ne sont évidemment pas détachées de mouvements qui, comme Survived and Punished, militent pour la libération de femmes incarcérées suite à des actes commis dans des contextes de violences domestiques.
Plus généralement, de nombreuses auteures, militantes et organisations mènent une critique du « féminisme carcéral » (carceral feminism)[17], expression qui désigne les courants du féminisme qui, depuis les années 1970, ont placé, au centre de leurs revendications, un recours accru à la judiciarisation pour faire avancer la condition des femmes. La critique des luttes menées sur le terrain du droit se retrouve aussi dans les mouvements LGBT : même s’il est loin d’être dominant, tout un courant politique (autour par exemple d’Against equality et Black and Pink) mène de front la lutte pour la libération LGBT et l’abolition du système pénal.
CT : Qu’en est-il en France ?
GR : Dans les années 1970, le féminisme a été traversé par des débats sur le recours à la justice pénale, comme le rappellent très bien les travaux de Jean Bérard[18] et comme en témoignent de nombreux documents de l’époque, comme l’article « Priorité aux violées » de Martine Le Péron. Ces débats ont malheureusement largement disparus. En partie, je crois, du fait du manque d’outils conceptuels, pour penser les contradictions au sein des femmes, mais aussi parce que les courants dominants du féminisme sont réticents à penser les questions de race et de classe.
Pourtant, je sais que la doxa du recours au pénal suscite des questions ou des malaises chez beaucoup de féministes et d’organisations féministes, y compris celles qui travaillent avec les victimes de violences faites aux femmes. Dans les débats d’idées, on entend rarement dire que l’avancement des luttes féministes ne doit pas passer par les politiques pénales ou se faire sur le terrain du droit. Par exemple, la traduction en français d’un texte d’Alex Press, « Metoo doit éviter le féminisme carcéral », est l’un des seuls qui exprime, en français, des réserves progressistes sur ce mouvement. Un autre exemple est celui des débats féministes sur la loi qui pénalise le harcèlement sexiste dans la rue : ils ont rarement été au-delà d’une critique de son inefficacité ou d’une discussion sur l’allocation des ressources. Le texte du groupe de réflexion Queer & Trans Révolutionnaires (QTR) et du collectif afroféministe Mwasi est l’une des rares expressions des critiques qu’on peut faire de cette mesure, à la fois raciste et qui entretient l’idée que le patriarcat serait soluble dans des mesures pénales.
Dans ce tableau un peu rapide, il faut néanmoins souligner que le Syndicat du travail sexuel (STRASS) mène un travail politique extrêmement important car il fait entendre des perspectives critiques sur ce que les politiques pénales font aux femmes et à d’autres catégories de la population au nom de leur protection.
CT : Quel est le rôle de ce contexte intellectuel et politique dans la rédaction de ce livre ? On devine que c’est un projet de longue haleine, réfléchi depuis longtemps. Mais l’écriture effective a-t-elle été « précipitée » par un effet de conjoncture ?
GR : Pour elles toutes a été très longuement mûri. Cela fait presque vingt ans que je suis abolitionniste et que je suis mêlée, de près ou de loin, aux luttes abolitionnistes et aux discussions autour de ces luttes. La question de l’articulation du féminisme et de l’abolitionnisme m’a assez vite intéressée, mais j’ai été souvent insatisfaite des réponses que je trouvais. Au cours du temps, j’ai eu de nombreuses discussions sur ce sujet et constaté que d’autres abolitionnistes et d’autres féministes partageaient cette insatisfaction. Malgré des sollicitations régulières pour animer des discussions sur l’abolitionnisme et le féminisme dans des lieux militants, j’ai longtemps eu des réticences à écrire sur le sujet – pour un tas de raisons, à commencer par le fait que les idées développées dans ce livre doivent beaucoup à d’autres que moi et qu’elles sont pour l’essentiel le fruit du travail politique de nombreuses militantes. Donc, bien plus que « précipitée », l’écriture a été plutôt une lente sédimentation de toutes ces années d’échanges et de lectures…
Par ailleurs, au-delà des réticences autour de l’écriture, se posait la question du livre lui-même : le recours à un éditeur à qui confier le texte, la marchandisation de celui-ci, la promotion qui va avec la sortie d’un livre… Bref, de par ma culture politique, je pense beaucoup plus naturellement à écrire un tract ou un fanzine qu’à publier un livre. Il a fallu la force de conviction de plusieurs personnes et ma rencontre avec l’éditrice Marie-Ève Lamy des éditions Lux pour que j’accepte l’idée que ce texte pourrait prendre la forme d’un livre.
CT : Tu as déménagé en Californie il y a quelques années, or c’est un foyer militant important en matière de lutte anticarcérale notamment. Est-ce que cela a influencé, d’une manière ou d’une autre, l’écriture du livre ?
GR : C’est à vrai dire plutôt l’inverse qui s’est produit : l’insatisfaction politique qui est à l’origine de ce livre m’a amenée à m’intéresser de près aux États-Unis et c’est cet intérêt, conjugué à des circonstances personnelles et à une opportunité professionnelle, qui m’a décidée à immigrer aux États-Unis et plus précisément en Californie. Je suis devenue abolitionniste autour de l’an 2000, au moment donc de la fondation de Critical Resistance. La lecture de beaucoup de leurs textes, comme leur déclaration conjointe avec Incite!, « Gender Violence and the Prison Industrial Complex »[19], a été importante dans mon cheminement militant.
Je me suis donc installée aux États-Unis notamment en raison de mon intérêt pour le foisonnement intellectuel et militant qu’il y a autour de l’abolitionnisme et des débats qui ne sont pas, ou à peine, engagés en France. Je pense tout particulièrement à l’articulation du système pénal aux questions environnementales que porte par exemple Fight toxic prisons ou les mouvements pour l’abolition de la police qui ont des propositions très concrètes, comme le programme de Rachel Herzing ou la coalition MPD150 à Minneapolis. Si mon installation aux États-Unis a influencé l’écriture du livre, c’est sans doute en me convaincant que je pouvais – ou devais – contribuer à la circulation des idées et des pratiques militantes entre l’Amérique du Nord et la France.
CT : Trouver une approche qui soit à la fois personnelle et « universitaire », mêler propos à la première personne et considérations générales est sans doute un exercice difficile. Était-ce d’emblée le pari que tu t’étais fixée, ou est-ce venu plutôt en cours de conception ou d’écriture ?
GR : J’ai conçu ainsi le livre depuis le début. Je souhaitais partager des savoirs et des réflexions, mais je ne voulais pas dissimuler ce qui est l’origine de mes convictions politiques et ce qui a façonné mon parcours intellectuel et militant. Néanmoins, mes propos à la première personne sont extrêmement circonscrits, manière de refuser l’assignation au témoignage à laquelle les proches des personnes incarcérées sont souvent confronté.e.s.
Mais mon écriture est personnelle dans le sens où j’ai écrit Pour elles toutes pour mes amies, pour les femmes et les militant.e.s que je côtoie. En effet, j’ai été très marquée par ce qu’évoque Nils Christie de son écriture de L’Industrie de la punition : « De façon imaginaire, j’écris pour mes « tantes préférées », c’est-à-dire pour le commun des mortels, qui m’apprécient assez pour essayer de lire mon texte, mais pas au point d’employer des mots et des tournures de phrases alambiquées destinés à le faire paraitre scientifique.» Lorsque j’ai écrit ce livre, j’ai essayé de toujours garder à l’esprit cette phrase. Donc mon écriture n’est pas « académique ». Mais, en même temps, il n’existe pas un champ académique français dans lequel les théories abolitionnistes sont discutées. Le jour où ce champ existera et si je pense pouvoir y contribuer, je me plierai alors aux règles strictes de l’écriture académique.
Cependant, mon livre est « académique » dans sa démarche qui consiste à essayer de saisir, méthodiquement, ce que fait le système pénal aux femmes, qu’elles soient victimes, criminalisées ou qu’elles aient des proches en prison. Beaucoup de travaux antérieurs se sont focalisés sur l’une de ces catégories de femmes, alors que j’essaie de les penser ensemble. Par ailleurs, mon livre repose sur des savoirs académiques qu’il me semble important de rendre accessible. Je pense en effet que l’accès à ces savoirs et à des espaces de diffusion des savoirs et des idées – qui va de pair avec la position d’enseignant.e-chercheur.se – est assorti d’une forme de devoir de contribuer à la circulation des savoirs, notamment entre les sphères académiques et militantes.
CT : Tu fais en introduction le « constat de certaines carences des analyses effectuées en français par les mouvements abolitionnistes et féministes ». Peux-tu en dire un peu plus sur ces « carences » ?
GR : Ces carences tiennent en partie du peu de ressources théoriques accessibles en français. Le livre de Catherine Baker, Pourquoi faudrait-il punir ?[20], qui date originellement du milieu des années 1980, est l’un des seuls livres en français sur l’abolitionnisme pénal, auquel s’ajoutent quelques traductions françaises d’auteur.e.s etranger.e.s, comme Nils Christie[21] et Angela Davis. On peut noter que The Politics of Abolition[22] de Thomas Mathiesen, un ouvrage « classique » qui a fait l’objet d’une réédition augmentée en 2015, n’a toujours pas été traduit en français. Le numéro « Abolitionnisme – Abolitionism » de la revue Champ pénal/Penal Field[23] est une des rares publications scientifiques sur le sujet, mais on notera qu’il a été dirigé par des universitaires canadiens et que beaucoup des contributions réunies sont écrites par des Nord-américain.e.s. Les ouvrages critiques sur la prison, comme ceux d’Alain Brossat[24] ou de Jacques Lesage de la Haye[25], sont plus nombreux. Pour trouver des réflexions féministes et abolitionnistes, il faut pour l’essentiel se tourner vers des ressources militantes, elles-mêmes peu nombreuses, comme les fanzines Lavomatic – Lave ton linge en public ou Réflexions autour d’un tabou : l’infanticide.
La rareté des publications, en France, sur l’abolitionnisme, reflète sa marginalité dans les débats d’idées. Cela peut surprendre au vu de la confrontation régulière à la répression pénale des mouvements sociaux, mais aussi de la montée en puissance des luttes contre les crimes d’État et les violences policières. Par ailleurs, il y a, dans les mouvements abolitionnistes, encore trop peu de discussions sur la manière dont les femmes sont spécifiquement affectées par l’existence de la prison et du système pénal. On n’y discute pas assez de victimation et de résolution des « situations problématiques » (pour reprendre le vocabulaire de Louk Hulsman), de la criminalisation des femmes et d’une question qui me tient particulièrement à cœur[26], les proches des personnes incarcérées et du travail de solidarité qui revient pour l’essentiel à des femmes.
CT : Tu as évoqué la marginalité de l’abolitionnisme dans le milieu académique en France. Qu’en est-il aux États-Unis ?
GR : L’abolitionnisme n’est certes pas le courant dominant du champ des recherches sur le système pénal, mais il est assurément sorti de sa marginalité initiale. Les chercheur.se.s qui se définissent comme « abolitionnistes » sont loin d’être une exception. Par exemple, dans le département de science politique et justice criminelle dans lequel je travaille à la California State University, Chico, nous sommes deux abolitionnistes parmi les sept titulaires du cursus de « justice criminelle ». Dans d’autres universités, la proportion d’enseignant.e.s abolitionnistes est plus élevée encore. En Amérique du Nord, de plus en plus de cursus de justice criminelle ou de criminologie comportent des enseignements sur l’abolitionnisme pénal ou la justice transformative. Dans mon université, il s’agit d’enseignements optionnels, mais tou.te.s nos etudiant.e.s entendent un jour parler d’abolitionnisme ! Il est aussi à noter qu’à la conférence annuelle de l’Association américaine de criminologie, qui regroupe certes généralement plus d’un millier de communicant.e.s, une quarantaine de personnes participent chaque année depuis plus de cinq ans maintenant à des panels autour de l’abolitionnisme pénal.
Que les universités invitent régulièrement des abolitionnistes comme conférencier.e.s me semble également révélateur de la place jouée aujourd’hui par l’abolitionnisme dans le débat d’idées aux États-Unis. Par exemple, mon université a récemment organisé une conférence avec Richie Reseda, connu pour ses positions radicales sur le système pénitentiaire et pour le programme féministe qu’il a mis en place auprès de ses codétenus lorsqu’il était lui-même en prison[27]. L’influence de l’abolitionnisme sur les campus se traduit également en termes militants, comme le montre la campagne Harvard, divest qui vise à ce que l’université d’Harvard cesse tous liens avec les entreprises ayant des intérêts dans le secteur des prisons. On note aussi une sensibilité croissante à la manière dont les étudiant.e.s sont affecté.e.s par l’incarcération de masse, avec de plus en plus d’universités qui, sous la pression de la campagne « Ban the box », ne vérifient plus le casier judiciaire des étudiant.e.s lors de leurs examens d’entrée. Il y a même, à l’université de Californie, San Diego, un club d’étudiant.e.s anciennement incarcéré.e.s ou ayant des proches en prison.
CT : Le chapitre 6, le dernier, celui qui dessine des pistes, ouvre des perspectives, a-t-il été le plus difficile à écrire ?
GR : Non, car écrire sur ce qui touche de près à ma propre histoire et à la manière dont l’existence de la prison a affecté ma vie, comme écrire sur les souffrances dont j’ai été témoin, sera toujours le plus difficile. L’immense responsabilité qu’on a envers ceux et celles dont on manie les histoires et qui nous font confiance en nous les livrant rend forcement l’écriture « grave ». Au regard de cela, évoquer des pratiques militantes émancipatrices, y compris les échecs par lesquels elles ont pu se solder, est toujours plus léger et rempli d’une forme d’espoir. Cela s’accompagne certes d’autres responsabilités : l’honnêteté intellectuelle qui consiste à en évoquer aussi les limites et les incertitudes. Il faut également s’assurer que la critique qu’on fait de certaines analyses et pratiques politiques soit constructive et entendue comme telle. Par exemple, ma critique de certains courants du féminisme n’est pas une critique du féminisme, de même que ma critique de l’abolitionnisme pour son manque de prise en compte des analyses féministes est une invitation à poursuivre la réflexion sur la construction du projet abolitionniste.
Mais l’évocation des pratiques et savoirs militants pose, à mon sens, une autre difficulté : celle de leur transposabilité. Dans les débats sur l’abolitionnisme pénal, des exemples de sociétés passées ou lointaines ne recourant pas à l’enfermement sont souvent mobilisés. Je pense que plutôt de mobiliser un passé ou un ailleurs enchanté – et qu’on connait parfois mal –, il vaut mieux miser sur l’inventivité humaine. Cela rejoint l’idée, importante à mes yeux, de Thomas Mathiesen d’un abolitionnisme essentiellement « inachevé ». En accepter le caractère « inachevé » permet de saisir ces pratiques comme des sources d’inspiration, tout en respectant la spécificité des cultures et des contextes politiques et sociaux dans lesquels elles s’inscrivent.
CT : Le livre porte non seulement sur la prison mais sur l’ensemble du système pénal ; c’est donc toute la conception dominante du « crime » qui est en jeu. Qu’est-ce qui explique l’inertie en la matière ? D’ailleurs, est-elle si forte, cette inertie, ou peut-on dire que les lignes bougent concernant les représentations sociales du crime, côté américain et/ou français ?
GR : Je pense que le sentiment d’une « justice injuste » à beaucoup d’égards est relativement partagé. Et beaucoup de féministes savent également très bien que les définitions étroites du droit pénal rendent mal compte de ce que le patriarcat fait aux femmes. Mais il n’est pas sûr que ce constat entraine une remise en cause du concept de « crime » ou d’un questionnement du recours à la punition – celui-ci étant intimement lié au concept même de « crime », comme l’a bien démontré Louk Hulsman dans ces travaux. Malheureusement, la vision d’une justice rétributive est assez « naturelle » et le travail politique de déconstruction des présupposés sur lesquels repose cette vision est, en la matière, encore considérable.
De plus, le sentiment d’une « justice injuste » peut parfaitement se conjuguer avec ce que les abolitionnistes ont depuis longtemps dénoncé sous le terme d’« innocentisme ». Ce terme désigne les argumentations qui critiquent la prison (ou le système pénal) sur la base de l’innocence – ou de la moindre culpabilité – de certaines personnes en raison de leurs caractéristiques (âge, état de santé, voire genre) ou des circonstances dans lesquelles ont été commis les faits pour lesquels elles sont criminalisées (absence de violences interpersonnelles, délit lie à l’usage de produits stupéfiants, etc.). La critique de la « politique de l’innocence » est au centre de la pensée abolitionniste. Elle ne rompt pas seulement avec le réformisme : elle permet justement de porter la critique non plus sur la « justice injuste », mais sur ce que permet l’usage même du concept de « crime ».
En France, dans le champ militant, le cas des luttes contre les violences policières me semble assez révélateur de la difficulté à dépasser une perspective certes critique, mais réformiste sur le fond, du crime. Ces luttes ont tendance à se limiter justement à la question des violences policières ou au caractère raciste de l’institution et laissent dans l’ombre la question de l’existence même de la police. C’est d’ailleurs un signe que les rares textes en français sur l’abolition de la police sont, à l’instar d’« Abolissons la police » publié par le site État d’Exception, souvent traduits de l’anglais.
*
Notes
[1] Notamment Maya Schenwar, Locked Down, Locked Out: Why Prison Doesn’t Work and How We Can Do Better, Oakland, Berrett-Koehler Pub., 2014 ; David Scott (dir.), Why Prison?, Cambridge, Cambridge UP, 2015 ; David Scott (dir.), Against Imprisonment: An Anthology of Abolitionist Essays, Hook, Waterside Press, 2018 ; Abolition Collective, Abolishing Carceral Society, Brooklyn, Common Notions, 2018 ; Massimo Pavarini, Livio Ferrari, dir., No Prison, Londres, EG Press, 2018.
[2] Alex Vitale, The End of Policing, Londres, Verso, 2017.
[3] Notamment : Ching-In Chen, Jai Dulani, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha (dir.), The Revolution Starts at Home: Confronting Intimate Violence within Activist Communities, Cambridge, South End Press, 2011. Voir aussi les nombreuses ressources publiées en ligne, par exemple par le Bay Area Transformative Justice Collective.
[4] Keeanga-Yamahtta Taylor, Black Lives Matter. Le renouveau de la révolte noire américaine, Marseille, Agone, 2017 [2016].
[5] Robyn Maynard, Noires sous surveillance. Esclavage, répression, violence d’État au Canada, Montréal, Mémoire d’encrier, 2019 [2017].
[6] Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, New York, The New Press, 2010.
[7] Tony Platt, Beyond These Walls: Rethinking Crime and Punishment in the United States, New York, St. Martin’s Press, 2019.
[8] Jackie Wang, Capitalisme carcéral, Paris, Divergences, 2019 [2018].
[9] Notamment : Valeria Vegh Weis, Marxism and Criminology. A History of Criminal Selectivity, Leiden, Brill, 2017 (voir aussi cet entretien en français) ; S. Bittle, L. Snider, S. Tombs, D. Whyte, Revisiting Crimes of the Powerful: Marxism, Crime and Deviance, New York, Routledge, 2018. Voir également G. Salle, « Approches marxistes du crime [guide de lecture] », Période, novembre 2018.
[10] Angela Davis, La Prison est-elle obsolète ?, Paris, Au Diable Vauvert, 2014 [2003].
[11] Ruth Wilson Gilmore, Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California, Berkeley, University of California Press, 2007.
[12] Julia Sudbury, dir., Global Lockdown: Race, Gender, and the Prison-Industrial Complex, New York, Routledge, 2005.
[13] Cette expression désigne la proportion sans précédent de la population (325 millions de personnes) qui est aujourd’hui soit détenue (2,3 millions), soit en probation (plus de 3,5 millions), soit en liberté conditionnelle (près de 900 000).
[14] Voir notamment : Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the War on Crime. The Making of Mass Incarceration in America, Cambridge, Harvard University Press, 2016 ; Naomi Murakawa, The First Civil Right: How Liberals Built Prison America, Oxford, Oxford UP, 2014.
[15] Beth Richie, Arrested Justice: Black Women, Violence, and America’s Prison Nation, New York, New York UP, 2012.
[16] Emily L. Thuma, All Our Trials. Prisons, Policing, and the Feminist Fight to End Violence, Urbana, Univ. of Illinois Press, 2019.
[17] L’expression a été forgée par Elizabeth Bernstein (« The Sexual Politics of New Abolitionism », Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, vol. 75, no 3, 2007, p. 128-151).
[18] J. Bérard, La Justice en procès. Les Mouvements de contestation face au système pénal (1968-1983), Paris, Presses de Sciences Po, 2013.
[19] Incite! Women of Color Against Violence, Critical Resistance, « Gender Violence and the Prison Industrial Complex », dans CR10 Publication Collective, Abolition Now! Ten Years of Strategy and Struggle Against the Prison Industrial Complex, Oakland, AK Press, 2008 [2001].
[20] Catherine Baker, Pourquoi faudrait-il punir ?, Lyon, Tahin Party, 2004 [1985].
[21] Nils Christie, L’Industrie de la punition. Prison et politique pénale en Occident, Paris, Autrement, 2003 [1993].
[22] Thomas Mathiesen, The Politics of Abolition Revisited, Londres, Routledge, 2015 [1974].
[23] Nicolas Carrier, Justin Piché, dir., « Abolitionnisme – Abolitionism », Champ pénal/Penal Field, vol. 12, 2015.
[24] Alain Brossat, Pour en finir avec la prison, Paris, La Fabrique, 2001.
[25] Jacques Lesage de la Haye, L’Abolition de la prison, Montreuil, Libertalia, 2019.
[26] Gwenola Ricordeau, « No abolitionist movement without us! Manifesto for prisoners’ relatives and friends », in Massimo Pavarini, Livio Ferrari, dir., No Prison, London, EG Press, pp. 191-204.
[27] Voir le documentaire The Feminist on Cellblock Y (Contessa Gayles, 2018) consacré à ce programme.
Contretemps, 7 novembre 2019
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte