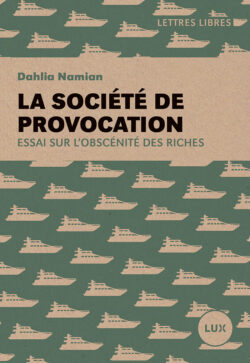Sous-total: $

«La société de provocation»: Dahlia Namian dénonce la pornopulence
Le gigayacht de l’Américain Jeff Bezos (4e fortune mondiale), baptisé Koru, venait de prendre la mer le mois dernier quand le fondateur d’Amazon a reçu en catimini la Légion d’honneur des mains du président Emmanuel Macron. Ce jour-là, les rues de Paris et d’autres villes de France débordaient à nouveau de manifestants contre la réforme du régime de retraite.
Le désormais chevalier Bezos était à l’Élysée en compagnie de Bernard Arnault, Crésus contemporain, qui vaudrait quelque chose comme le tiers d’un billion de dollars. Sa fortune a été bâtie sur les grandes marques du luxe. L’argent nourrit l’argent.
Le Koru, plus grand voilier du monde, aurait coûté près de 700 millions. Le constructeur néerlandais Océanco voulait démanteler une section du pont ferroviaire historique De Hef, à Rotterdam, pour faire sortir la merveille de ses chantiers. La mairie avait accepté le démontage, mais, comme des milliers de citoyens promettaient de lancer des oeufs sur le Koru, le yacht a finalement été remorqué de nuit vers un autre chantier naval, ouvert celui-là sur le grand large.
Le marché très, très niché des navires de haute plaisance rivalisant de finesse et de prouesse connaît une poussée fulgurante depuis la fin du XXe siècle. Les superyachts (longs de plus de 100 pieds) se comptent par milliers et les gigayachts (plus de 300 pieds de longueur), par centaines.
Ces palaces flottants, symboles par excellence de la prospérité et de l’ostentation, deviennent les miroirs révélateurs des défauts du capitalisme actuel. D’un côté, ils rappellent les moyens infinis de la classe dominante du 1 %. D’un autre côté, ils concentrent et amplifient les conséquences d’un mode de vie écocidaire.
« Dans la société globalisée, est-il étonnant que ceux qui ont su accumuler le plus de capital chérissent les océans ? » demande la professeure Dahlia Namian dans son nouvel essai, La société de provocation (chez Lux éditeur, pour l’ironie involontaire…), consacré à « l’obscénité des riches » (c’est son sous-titre). « N’est-ce pas là l’incarnation parfaite de l’espace sans frontière que promettait la libéralisation des échanges ? Mais cet éden postmoderne, ce paradis — fiscal, réglementaire, social — est réservé aux happy few de la mondialisation. Pour les migrants fuyant la misère en dérivant sur les flots, l’océan représente l’une des frontières les plus meurtrières de la terre. En Grèce, dans cette patrie des dieux, les migrants échouent par milliers sur les rivages de la mer Égée, morts, vivants, éclopés, tannés, lessivés. »
Une saine colère
Le ton est donné et maintenu pendant 250 pages tricotant autour de symboles forts et de thèmes porteurs (la nourriture, l’île, le voyage, etc.). Mme Namian possède un indéniable talent pour dénicher et rapprocher des histoires, voire des anecdotes éclairantes, ici avec le récit de la colonie Forlandia créée par Henry Ford au Brésil, là en référence à l’île grecque d’Hydra où Leonard Cohen s’était installé sur les conseils de Barbara Rothschild, rencontrée lors d’une fête pour happy few à Montréal.
La professeure Namian, sociologue de formation, enseigne au Département de travail social de l’Université d’Ottawa. Ses livres précédents portaient sur des sujets liés à la santé mentale, à la pauvreté, à l’itinérance ou à l’exclusion. Le nouvel essai dirige les projecteurs sur l’autre extrémité de l’ordre social.
« On ne peut pas penser les riches et les pauvres de manière séparée, dit-elle. J’ai commencé ce livre pendant la pandémie, une situation qui m’a beaucoup choquée. J’ai ressenti de la colère et je l’ai exprimée dans l’essai en voyant que la crise affectait encore davantage les plus pauvres, les plus démunis, les travailleurs de la base, alors que tous les jours on voyait les plus fortunés exposer leurs privilèges, se réfugier sur leurs yachts, leurs îles privées, leurs immenses résidences secondaires. »
Le titre de l’essai, emprunté à Romain Gary (dans Chien blanc), désigne « l’ordre social qui encourage une telle outrecuidance », où l’ostentation luxueuse et l’exhibitionnisme matériel poussent à la consommation tandis qu’une fraction importante de la population n’y a pas accès, ne peut pas assouvir ses besoins élémentaires. Les Anglos parlent de « wealthporn ». Osons « pornopulence »…
Les nantis ont pourtant toujours existé. Et n’ont-ils pas été, sinon admirés, du moins enviés presque partout ?
« Ce qu’il y a de nouveau avec la société de provocation, ce n’est pas l’exubérance décomplexée, mais le fait que l’exhibition grotesque de la richesse ne rencontre plus de résistance pour contester la provocation, réplique l’essayiste. Avec ce terme, on s’attendrait à un défi, à un duel, à une réaction, alors que maintenant les riches ne semblent pas avoir d’adversaires pour réagir. On est dans une époque de provocation tranquille. »
Déboulonner les mythes
Les créations culturelles (la télévision, le cinéma) se contentent souvent d’exposer les nababs surgonflés comme des conséquences d’un vice, d’une immoralité. À la limite, ce cynisme renforce le sentiment d’impuissance face aux puissants sans trop égratigner l’aura dont jouit cette upper high class mondialisée.
« On prête beaucoup de vertus aux riches, dit la professeure Namian. On les voit comme des entrepreneurs, des visionnaires qui ont bâti leur fortune grâce à leur génie et à leur talent. On louange leur générosité aussi. On en fait des demi-dieux. Évidemment, puisque notre société fondée sur l’argent voue un culte à l’accumulation et à la consommation. C’est vrai au Québec aussi. »
Dans les faits, le mythe de la méritocratie joue peu. La fortune se nourrit elle-même, et l’héritage reste un des meilleurs moyens de profiter. Oui, Jeff Bezos est parti de rien pour accumuler trop, mais il l’a fait grâce au travail de centaines de milliers d’employés, et les générations suivantes de Bezos pour des siècles et des siècles vivront dans les fastes légués.
La professeure rappelle que les écarts de richesse s’accroissent constamment à l’échelle planétaire. En mars, le magazine Forbes recensait 1426 milliardaires dans le monde, valant tous ensemble près de 7000 milliards de dollars, soit près de trois fois le PIB du Canada, pays se classant au 4e rang dans le monde pour son nombre de milliardaires (environ 65 au total) en proportion de sa population.
Un autre mythe veut que l’argent au sommet finisse par ruisseler vers la base de la pyramide et que les « pépites d’or » vont finir dans les poches des pauvres. « Cette théorie ne tient pas la route non plus, résume la sociologue. C’est l’inverse qui se produit depuis des années. Les riches s’enrichissent, les pauvres s’appauvrissent et les assises qui permettaient à la classe moyenne de prospérer sont remises en cause de différentes façons. »
La conclusion s’impose d’évidence pour la spécialiste des inégalités : il faut reprendre et actualiser la critique du capitalisme. « Il faut recommencer à parler de classe sociale, dit-elle. Il faut imposer les grandes fortunes. »
Selon les calculs d’Oxfam, si le Canada décrétait un impôt supplémentaire sur la fortune de 2 % pour les millionnaires, de 3 % pour ceux qui possèdent plus de 50 millions et de 5 % pour les milliardaires, cela permettrait d’amasser 50 milliards de dollars annuellement.
Et vogue la galère…
Stéphane Baillargeon, Le Devoir, 4 mars 2023.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte