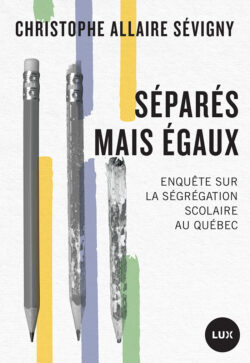Sous-total: $

La ségrégation scolaire est une trahison tranquille
Jeudi, le Québec rendait hommage à Guy Rocher, en se remémorant notamment son combat contre les inégalités. Se souvenir de l’héritage, surtout dans le contexte des compressions budgétaires, fait mal. Ce n’est pas que l’argent qui manque: c’est le projet de société, la vision d’avenir.
Une perte collective
Dans les années 1960, nous nous étions donné une mission ambitieuse: bâtir une école commune. Le sociologue Christophe Allaire Sévigny, dans l’ouvrage Séparés mais égaux, paru chez Lux, rappelle les mots d’une «mère fondatrice» de ce Québec moderne, Jeanne Lapointe. On rêvait d’un lieu où l’avocat de demain côtoierait le mécanicien. Apprendre ensemble afin que chaque jeune trouve sa place en société au contact de l’autre. Des décennies plus tard, nous nous sommes éloignés de la mission initiale.
Le livre de Sévigny est à lire pour voir comment cette ségrégation nous concerne tous. Troublant de voir l’écart immense entre l’héritage reçu de ces «parents fondateurs» et ce que nous en avons fait. Ils ont créé des ponts, on a recréé des murs.
Les élèves perdent des pairs, et les classes, leur équilibre. Le personnel porte l’impossible, et les parents, l’angoisse des choix individuels et des coûts collectifs. L’école publique qui devrait rassembler finit par trier.
Si l’on a l’impression de parler du phénomène en théorie, la réalité des classes le rend tangible. Que se passe-t-il à l’école qui devrait permettre à tous d’apprendre?
L’enseignant Sylvain Duclos résume bien la réalité de plusieurs: «Entre l’avènement du privé et des projets particuliers, la classe “régulière” ne l’est plus. La réalité, c’est une surconcentration d’élèves en difficulté. Malgré le discours sur l’équité des années 2000 qui nous oblige à être flexibles, comment peut-on l’être avec des ressources limitées (enseignants-ressources, orthopédagogues, etc.)? Répondre aux besoins de chacun devient quasi impossible.»
Et pour les parents? Finie l’école de proximité et la véritable gratuité. S’ajoutent le magasinage scolaire, le stress et la gestion d’un jeune ado en pleine transition vers le secondaire, souvent au prix de la perte de son réseau.
Tout le monde est perdant sur toute la ligne.
Que faire maintenant?
C’est là où on parle au coordonnateur d’École ensemble, Stéphane Vigneault. Son plan a été salué par des chercheurs australiens qui, au passage, citent le Québec comme un contre-exemple en matière de système d’éducation: trop d’écrémage, trop de ségrégation. Est-ce vraiment pour ça que les «parents fondateurs» se sont battus?
On s’est enfermés dans une fausse querelle privée contre le public plutôt que de s’attaquer à la ségrégation scolaire. Pendant ce temps, l’école s’est transformée en «centre de tri social», pour reprendre les mots de Sévigny. On sépare les élèves, on concentre les défis, on éparpille les ressources.
Il y a pourtant une voie de passage. École Ensemble propose une solution clé en main: un réseau commun, en mettant fin à la concurrence entre les écoles. Résultat: plus d’équité, plus de réussite, un climat apaisé et des économies d’environ 100 M$ en fonds publics.
On ne nivelle pas par le bas: on élève tout le monde.
La ségrégation scolaire est une trahison tranquille.
La vraie question n’est pas «faut-il agir?», mais «quand?».
Shophika Vaithyanathasarma, Le Journal de Montréal, 6 octobre 2025.
Photo: Agence QMI
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte