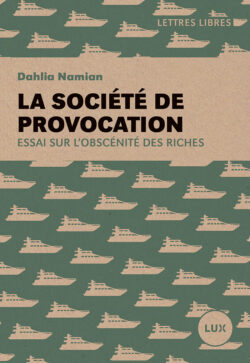Sous-total: $

La richesse comme scandale
Sociologue et enseignante à l’École de travail social de l’Université d’Ottawa, Dahlia Namian travaille entre autres sur les inégalités sociales, sur la pauvreté, sur les aspects sociaux des troubles psychologiques. On lui doit l’ouvrage Entre itinérance et fin de vie. Sociologie de la vie moindre (2012), issu de sa thèse de doctorat, dans lequel elle analyse les limites des modes d’intervention axés sur l’autonomie des individus.
Par son analyse du mode de vie et du pouvoir de la strate la plus riche de la population, La société de provocation offre un portrait décapant des inégalités sociales contemporaines. Le titre s’inspire d’un roman de Romain Gary (Chien blanc, 1970, dont Anaïs Barbeau-Lavalette a récemment tiré un film) dans lequel l’expression est utilisée pour désigner une société qui exhibe effrontément les richesses, provoquant ainsi des désirs matériels toujours plus grands, tout en restreignant les moyens de les combler pour une grande partie de la population.
Le sous-titre de l’ouvrage (Essai sur l’obscénité des riches) annonce d’entrée de jeu une prise de position forte de l’auteure, à savoir que l’explosion actuelle de la richesse est obscène, c’est-à-dire « [qu’elle] offense ouvertement la pudeur [qu’elle] présente un caractère très choquant en exposant sans atténuation, avec cynisme, l’objet d’un interdit social, notamment sexuel » (Le Grand Robert de la langue française). Pas question de sexualité ici, mais d’une grande variété de thèmes (philanthropie, agriculture, tourisme, urbanisme, organisation du travail…), à travers lesquels l’auteure montre que, de nos jours, la richesse s’étale sans vergogne, que ses détenteurs jouissent de pouvoirs considérables et provoquent, par leurs actions et leurs décisions de graves dégâts sociaux et environnementaux.
Étalage obscène
Yachts, fusées, îles privées, vacances, maisons, vêtements et parures de luxe, la consommation ostentatoire1, déjà analysée par Veblen à la fin du XIXe siècle, prend de nos jours des dimensions vertigineuses… jusque dans la vertu.
En effet, au-delà du mode de vie des riches abondamment (et pertinemment) décrit par l’auteure, une des manières bien particulières dont se manifeste cette ostentation est la philanthropie. Ainsi, on étalera sa collection privée d’oeuvres d’art, « offrant » un musée à une population n’ayant pas les moyens de voyager en Europe (dixit Carlos Slim au Mexique). Ainsi, on mettra sur pied une fondation servant telle ou telle œuvre (promotion de l’égalité pour Zuckerberg ou lutte contre les changements climatiques pour Gates). Ces actions ne règlent pas les problèmes en question et ils procurent autant, voire davantage, de bénéfices aux donateurs qu’aux récipiendaires.
Cette « philanthropie » permet aux riches de neutraliser l’État en en soustrayant des moyens colossaux et en orientant l’action vers des fins choisies par eux plutôt que par l’ensemble des citoyens. Elle permet également, une vraie aubaine, d’apaiser la grogne et de contribuer à l’aura des « bienfaiteurs » de l’humanité qui, après tout, pourraient bien conserver leur fortune intacte ! « Pour ces milliardaires, mieux vaut s’engager à offrir l’écume de leur fortune et la saupoudrer d’une rhétorique compassionnelle et égalitaire, que de transformer en profondeur un système qui rend possible leur enrichissement » (p. 54).
Discours obscène
Quel qu’en soit le moyen, cet étalage obscène des fortunes privées ne provoque pourtant pas forcément de scandale. La richesse est, en effet admirée, symbole de réussite. Le mythe du « self-made man » est encore bien ancré. « Pour faire briller les élites, la méritocratie est le vernis le plus résistant. » (p. 14).
Mieux, les idées et les pratiques promues par les riches incitent chacun à se libérer des lourdeurs de l’existence et à devenir soi-même des incarnations de l’efficacité. Par exemple, pour travailler plus, on suggère qu’un idéal serait de consacrer moins de temps à des « futilités » comme l’alimentation (et le repos) en ayant recours à des « technologies » (sic) (comme des substituts de repas ou des drogues dites « intelligentes »). Le life hacking nous invite ainsi à devenir de plus en plus efficaces afin d’accorder le temps « perdu » au soin de soi (et d’autrui !) à des activités plus productives, lire faire de l’argent et en faire faire aux grands de ce monde. Le tout, puisqu’il s’agit de « technologies », présenté comme le « progrès ».
Mais « progrès » pour qui ? Et pour quoi ? L’auteure observe que les « technologies », loin de réduire le rythme de nos vies ou de nous faire économiser du temps, nous poussent à toujours plus d’activités, à un rythme de plus en plus soutenu et ce, au profit de l’accumulation du capital. Namian rappelle que Marx, déjà, soulignait que l’augmentation de la productivité ne libère pas le temps de ceux qui travaillent, mais sert plutôt l’accumulation du capital et la puissance qui en découle.
Exploitation obscène
Justement… C’est bien connu, l’inégalité sociale est en augmentation depuis quelques décennies, surtout parce que les fortunes se multiplient et augmentent en valeur, soutenues par les politiques néolibérales qui ont produit les conditions structurelles de l’accroissement des richesses en les soustrayant à l’imposition et à la réglementation, ces « fardeaux », allègrement pourfendus par les oligarques et leurs valets. La part de la richesse accaparée par les plus fortunés ne cesse de croître pendant que les institutions et les services publics (et le personnel y oeuvrant) sont mis à mal.
Dans le secteur privé, le cas de Amazon, de mieux en mieux documenté, illustre bien les conditions de travail menées à leurs limites : salaires insuffisants, prescription tatillonne du travail, surveillance, aliénation, précarité, antisyndicalisme féroce. Le tout est enveloppé dans un discours managérial dit « bienveillant » où l’on enjoint les employés à « gérer » leur stress, à faire du yoga et autres gadgets contemporains du ressourcement. Ainsi, les millions d’objets à portée de clics qui sont supposés faire le bonheur de leurs acheteurs, font en fait le malheur de ceux qui travaillent dans l’ombre à les produire et à les distribuer, travailleurs que l’on culpabilise ensuite, leur imputant la responsabilité individuelle de se guérir des maux infligés par les organisations.
La violence de cette situation disparaît de la conscience et devient une suite de comportements ordinaires qui, détachés de leur contexte, paraissent (ou sont présentés comme) anodins. Namian, s’inspirant de l’idée de « banalisation du mal » chez Arendt, explique que la vie humaine est assujettie à l’accumulation du capital, situation qui « réduit la valeur d’une vie à de simples calculs de pertes et profits » (p. 79). Autrement dit, les soi-disant impératifs de croissance économique et de profit sont tellement enracinés dans les organisations et les consciences qu’ils en deviennent la manière normale d’organiser la vie et que plus rien ni personne ne semble responsable des souffrances qu’ils infligent. D’autant moins responsables que le langage qui nous permet désormais d’appréhender le monde reflète la rationalité gestionnaire qui semble la manière la plus raisonnable, la plus naturelle de penser… masquant la réalité de l’exploitation et de l’appropriation privée des produits du travail, les bases réelles de l’enrichissement et de la « réussite ».
[…] la banalisation du mal peut aisément, dans les sociétés néolibérales, se passer d’un chef. Elle se loge dans l’esprit d’une rationalité financière sans visage et dans la langue béate des gestionnaires, celle qui, en complément aux manuels de développement personnel, nous invite, buzzwords et sigles abscons à l’appui, à « innover » et à « faire preuve de créativité » dans l’atteinte des « objectifs de performance et de rentabilité » (p. 79-80).
D’une violence à l’autre, la richesse s’accumule et est appropriée par une part restreinte de la population pendant que d’« autres » meurent carrément de faim ou sont de plus en plus soumis à la précarité et donc incapables de se soustraire à un régime qui demande de plus en plus tout en offrant de moins en moins. La famine n’est pas un fait nouveau, mais l’auteure rappelle utilement que pendant que, sous l’oeil de médias complaisants, d’aucuns se promènent dans l’espace pour « sensibiliser la population à l’importance de l’eau potable », 50 millions de personnes sont au bord de la famine et 800 millions vivent la faim au quotidien (selon l’ONU en 2019), situation risquant de s’aggraver, notamment en raison des changements climatiques. Les reportages sur les banques alimentaires fournissent de manière récurrente la preuve que le problème existe parmi nos concitoyens et, quoiqu’en disent les François Lambert de ce monde, il ne s’agit pas d’un problème individuel.
La richesse s’accumule aussi au détriment du milieu qui permet à la vie de s’épanouir. C’est archiconnu… et depuis longtemps. Mais ça ne s’arrête pas là. Namian explique que nos oligarques rêvent de coloniser l’espace soit pour y déplacer les industries qui nuisent à la Terre, soit pour y établir des colonies humaines. Ils rêvent aussi, échec jusqu’à présent, de seasteading, création de cités-nations indépendantes en mer, espaces échappant en partie au contrôle des États, permettant de se regrouper à l’abri de l’impôt. Réalistes ou non, ces projets ne sont que l’aboutissement le plus achevé (pour l’instant) de l’extractivisme qui nous lèse collectivement, non seulement par l’appropriation privée des ressources, mais également par la destruction des conditions nécessaires à la vie humaine.
Pouvoir obscène
Pire encore, ceux-là mêmes qui sont les plus responsables de la destruction du vivant, non seulement par leur propre empreinte écologique, mais également par les décisions qu’ils prennent et imposent au reste du monde, promettent des « solutions » sous la forme « d’innovations technologiques » qui servent bien davantage à pérenniser le capitalisme que la vie (ou l’« environnement »). Pour ne prendre que ce seul exemple, pendant qu’elle fait des milliards de profits, l’industrie pétrolière mise sur le captage et le stockage du carbone, techniques d’ailleurs financées et promues par l’État, alors que leur développement est embryonnaire et que leurs perspectives d’efficacité sont bien inférieures à ce que les discours technophiles laissent envisager2.
Je pense qu’on pourrait à la limite voir le spectacle de la richesse comme un moindre mal, s’il n’était pas le symbole d’un pouvoir tentaculaire (et largement invisible) exerçant un poids démesuré sur les affaires de la cité. Tout au long de son ouvrage, l’auteure décrit ce pouvoir de l’argent auquel on pense peu parce que ses « accomplissements » sont banalisés et présentés comme des gestes de bon droit, légitimés par l’institution de la propriété privée et les mythes associés à la réussite personnelle. Ainsi, on peut construire des villes dans les déserts quasi inhabitables et se promener de lieu climatisé en lieu climatisé dans des sites de luxe… ou, pourquoi pas, aller dans l’espace. On peut prendre des décisions qui affectent le bien-être et la santé des populations, ou, pourquoi pas, détourner les richesses produites par le travail d’autrui. On peut piller les ressources pour des projets qui ne sont que pur gaspillage ou, pourquoi s’en priver, transformer ses caprices en « besoins » qu’une population assujettie a pour rôle de satisfaire. On peut « nettoyer » des quartiers populaires pour en faire des zones chics où les loyers deviennent rares et inabordables ou encore, bâtir des quartiers entièrement organisés autour de la consommation. Toutes ces décisions, et bien d’autres ont pour caractéristiques le pillage des ressources, l’appropriation du travail d’autrui, la glorification de leurs auteurs ainsi que la négation de leurs conséquences environnementales, sociales et existentielles.
L’ouvrage de Namian, qui tient à la fois du réquisitoire et de l’analyse sociologique, met en lumière le scandale de l’ordre socioéconomique qui est le nôtre. Une documentation abondante, appropriée par un esprit vif et rendue par une plume claire, portée par une juste colère, convainquent le lecteur que la neutralité axiologique recherchée par la sociologie pour rendre compte de la réalité avec justesse, doit parfois, précisément pour jouer ce rôle, s’exercer en laissant une place à la révolte devant l’évidence des ravages de l’ordre social.
- Cette consommation se définissant comme « des loisirs et des dépenses somptueuses qui n’ont d’autre utilité que de rendre manifeste la supériorité de ceux et celles qui les possèdent » (p. 124).
- Voir, notamment, Alexandre Shields, « Environnement. Une nouvelle forme de subvention aux énergies fossiles au Canada ? », Le Devoir, 30 mars 2023.
Chantale Lagacé, Les Cahiers de lecture de L’Action nationale, vol. 17, no 3, été 2023.
 Mon compte
Mon compte