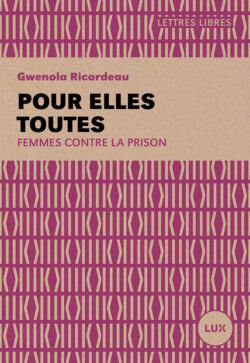Sous-total: $

«La cause des femmes sert de prétexte pour justifier des politiques de plus en plus punitives»
Basta ! : Vous êtes féministe et vous voulez abolir la prison, donc là où on enferme les agresseurs. Ces positions sont-elles difficilement conciliables ?

Gwenola Ricordeau [1] : Ces positions sont plus que « conciliables ». Mon travail propose une analyse féministe du système pénal et de ce que celui-ci fait aux femmes. Cela permet de faire plusieurs constats. Tout d’abord, les personnes détenues sont pour l’essentiel des hommes, mais la vie des femmes de leur entourage, mère, sœur, compagne, fille, est souvent affectée par cette incarcération, notamment à travers les diverses formes de travail domestique qui sont attendues d’elles et qui incluent le soutien moral, à travers les visites, le courrier, etc. Par ailleurs, quand on regarde qui sont les femmes qui sont en prison, on note qu’elles partagent de nombreuses caractéristiques avec les hommes détenus : elles sont en grande partie d’origine populaire et issues de l’histoire de la colonisation et des migrations. Mais les femmes détenues ont aussi des particularités. Une très grande proportion d’entre-elles ont été victimes de violences sexuelles. Ces violences ont façonné leur parcours de vie, leur isolement social ou leur parcours délictuel.
Et lorsqu’on examine la protection que les femmes peuvent attendre du système pénal, on ne peut que constater un échec flagrant. L’enjeu de mon livre est donc de questionner les courants majoritaires du féminisme qui entendent s’appuyer sur le système pénal pour demander davantage de condamnations et des peines plus lourdes pour les hommes auteurs de violences sexuelles.
En quoi les politiques pénales contre les violences sexuelles sont-elles un échec à vos yeux ?
Des décennies de durcissement des politiques pénales contre les violences sexuelles pour arriver à 94 000 femmes majeures qui déclarent, chaque année, avoir été victimes de viol ou de tentative de viol [en France]. Plus de 550 000 victimes d’agressions sexuelles chaque année ! J’appelle cela un échec flagrant. Je ne vois pas bien comment on pourrait encore essayer de nous faire croire que ce genre de politique finira par marcher.
À cela s’ajoute le désastre qu’est la manière dont sont traitées la plupart des victimes, depuis le dépôt de plainte jusqu’à l’éventuel procès. Ce que permet aujourd’hui l’incarcération de certains auteurs de violences sexuelles, c’est la garantie qu’ils ne commettront pas d’agressions sexuelles pendant leur peine – et encore, on fait là un peu vite abstraction des violences sexuelles commises en prison – et le sentiment que tous les crimes ne restent pas impunis. C’est, à mon sens, un lot de consolation bien maigre au regard du crime de masse que sont les violences sexuelles.
Mais une justice est-elle envisageable en dehors du système pénal ?
La « Justice », ou le « système pénal », est le système qui est censé « rendre justice » lorsque des délits ou des crimes sont commis. Donc, la police et la prison font partie de ce système. À partir de là, on peut faire plusieurs remarques. Tout d’abord, la Justice n’est pas toujours juste… Selon les origines sociales et ethniques ou le sexe, les risques d’être poursuivi, condamné ou incarcéré ne sont pas les mêmes. Les victimes ne sont pas non plus égales face au système pénal : selon l’auteur des faits et leurs propres caractéristiques, les victimes n’ont pas toutes les mêmes chances d’obtenir une condamnation des faits.
Il faut rappeler que le système pénal n’a connaissance que d’une petite partie des comportements problématiques et des transgressions sociales. Pour deux raisons. Tout d’abord, par définition, le système judiciaire ne s’intéresse qu’aux faits qui sont définis comme des « délits » ou des « crimes ». Ensuite, nous choisissons souvent de ne pas faire intervenir le système pénal dans nos différents ou lorsque nous subissons un tort.
La justice qui est rendue par le système pénal est essentiellement punitive et rétributive, dans le sens où elle repose sur l’identification d’un coupable et le prononcé d’une peine qui constituerait une forme d’équivalence – de « rétribution » – du tort fait à la victime. Mais il y a d’autres conceptions de la justice, en particulier des conceptions non-punitives, comme la justice réparatrice ou la justice transformative.
Sur quels principes se basent les justices « réparatrice » et « transformative » ?
Comme la justice réparatrice – qui est basée sur la réparation plutôt que la punition – la justice transformative s’oppose aux approches punitives. Elle considère qu’il existe des responsabilités individuelles, mais aussi des conditions sociales rendant possible la commission de certains faits. Les pratiques de justice transformative qui se sont développées à partir de l’an 2000 en Amérique du Nord partent d’une critique de la justice telle qu’elle est rendue par le système pénal. Elles ont d’abord été essentiellement pensées et expérimentées dans des communautés, au sein de milieux radicaux états-uniens, qui, de fait, ne pouvaient pas espérer la « justice » du système pénal.
C’est donc parmi les minorités ethniques et les communautés queer que se sont développées ces pratiques, en particulier pour répondre au besoin de justice quant aux violences faites aux femmes. Ces pratiques sont des pratiques communautaires, c’est-à-dire que les personnes impliquées dépendent des situations en cause. Cela signifie aussi que la « responsabilité communautaire » est centrale et que les procédures visent à « transformer » la communauté. La justice pénale désigne et condamne un auteur, la justice transformative part des besoins de la victime – sécurité, vérité… – elle confronte un agresseur et travaille à son implication dans une démarche individuelle et collective de réparation et de transformation. Et elle contribue à des changements collectifs de valeurs et de manières de faire.
Vous parlez dans votre livre de « populisme pénal », que cela signifie-t-il ?
L’expression de « populisme pénal » est utilisée depuis le début des années 2000 dans le monde anglophone. Elle désigne la manière dont les politiques pénales, en s’appuyant sur la montée des mouvements de victimes et des sentiments réactionnaires, se servent du besoin de sécurité des populations pour justifier des politiques de plus en plus répressives et sans réel effet sur le nombre de délits et de crimes.
Lorsqu’on analyse les politiques pénales, on observe que ces dernières décennies, en France comme dans la plupart des pays occidentaux, les femmes ont servi à justifier des politiques de plus en plus punitives. La cause des femmes sert de prétexte à la création de nouvelles catégories de crimes et de délits, à l’allongement des peines, mais aussi à des innovations pénales, comme le bracelet électronique, les prélèvements systématiques d’ADN. Les politiques pénales en matière de violences à caractère sexuel, de violences domestiques ou de prostitution – entendue comme un « esclavage sexuel » – prétendent « sauver » les femmes en judiciarisant certains hommes. Bref, il ne faut pas se contenter de regarder ce que les politiques pénales prétendent faire – protéger les femmes – mais analyser quelles sont leurs effets sur les femmes et notamment sur les violences faites aux femmes.
Pensez-vous qu’une partie du féminisme s’est désintéressée du sort des femmes en prison et de celles qui ont un proche en prison ?
Les courants dominants du féminisme évoquent rarement les femmes détenues. Pourtant, les femmes détenues sont aussi confrontées au patriarcat et celui-ci façonne leur vie de bien des manières. Beaucoup de femmes incarcérées ont été victimes de violences sexuelles : rien que cela devrait suffire à attirer l’attention de ces courants dominants du féminisme. Le patriarcat, pour les femmes détenues, c’est aussi le fait d’être davantage que les hommes séparées de leurs enfants, parce qu’elles sont en prison ou suite à des décisions judiciaires spécifiques. On reproche plus aux femmes détenues d’être de « mauvaises mères » qu’aux hommes détenus d’être de « mauvais pères ». C’est aussi le traitement différentiel, en prison, des hommes et des femmes, qui se traduit par des offres de formation ou de travail moins nombreuses pour les femmes, ou une sexualité des femmes incarcérées davantage contrôlée que celle des hommes. Il faudrait aussi parler de la santé sexuelle et reproductive des femmes incarcérées, de la précarité menstruelle en prison, de l’indignité des conditions d’incarcération des femmes trans dans des prisons pour hommes.
La prison, ça n’arrive pas à n’importe qui. Les femmes qui sont incarcérées et celles qui ont des proches en prison, ce n’est pas « n’importe quelles femmes ». Dans certains milieux, l’incarcération d’un proche est une expérience relativement commune. En se désintéressant des femmes qui sont en prison et de celles qui ont des proches incarcérés, certains courants du féminisme indiquent quelles sont les origines sociales des femmes qui les composent et à quelles formes d’émancipation ils aspirent. À l’inverse, des mouvements qui se revendiquent d’un féminisme populaire, un féminisme pensé par et pour les femmes racisées, comme l’afroféminisme, réfléchissent et mettent en œuvre une sororité qui ne s’arrête pas aux portes des prisons.
Jugez-vous aussi que les mouvements abolitionnistes de la prison ne pensent pas suffisamment la question des violences sexuelles et des violences envers les femmes ?
Ces mouvements sont variés, notamment en termes de tactiques et d’expressions politiques. Par exemple, aux États-Unis, il y a des mouvements de femmes victimes de violences qui sont abolitionnistes comme l’organisation new-yorkaise Survived and Punished [2]. Elles sont abolitionnistes justement parce qu’elles ont été victimes de ce type de violences, qu’elles ont fait l’expérience du système pénal et de son approche punitive et qu’elles croient en d’autres types d’approches, à la fois pour survivre a ces violences et pour y mettre fin.
En France, les mouvements abolitionnistes ont longtemps été peu sensibles aux luttes féministes, en particulier à la question des violences faites aux femmes. Je pense que c’est en train de changer car de plus en plus de féministes s’intéressent aux analyses féministes du système pénal et aux approches abolitionnistes. Le collectif afroféministe Mwasi a ainsi, depuis sa création, une ligne abolitionniste [3].
Quelle est la différence entre abolitionnisme de la prison et abolitionnisme pénal ?
L’expression « abolitionnisme pénal » désigne des courants de pensée et des mouvements qui, depuis les années 1970, visent l’abolition du système pénal et donc de ses principales institutions que sont les prisons, les tribunaux et la police. Les luttes anti-carcérales, contre les prisons, font donc partie de l’abolitionnisme pénal. Pour ma part, je me réclame de l’abolitionnisme pénal plutôt que du seul abolitionnisme de la prison. Je partage certaines analyses qui indiquent que la prison pourrait bien disparaitre pour un tas de raisons – d’un point de vue capitaliste, elle est peu rentable et pourrait assez bien être remplacée par l’utilisation de technologies de surveillance – sans pour autant que sa disparition n’affecte l’ordre social. Prendre pour cible le système pénal plutôt que la seule prison permet de rendre plus clair une position politique foncièrement révolutionnaire, qui s’attaque au capitalisme et au suprémacisme blanc.
Des mouvements pour l’abolition de la police prennent de l’ampleur aux États-Unis, renforcés par les manifestations contre les violences policières. Est-ce un phénomène nouveau, ou est-ce en continuité directe des revendications d’abolition de la prison ?
Comme je l’évoquais, l’abolitionnisme pénal vise à abolir l’ensemble du système pénal, donc autant la prison que la police. Pour des raisons tactiques, certains mouvements choisissent de se porter plus spécifiquement sur une institution, la prison, la police… mais la perspective politique est identique. Les luttes anti-carcérales étaient l’aspect souvent le plus connu de l’abolitionnisme pénal. Aujourd’hui, l’idée de l’abolition de la police se répand au-delà des seuls cercles abolitionnistes. Depuis le milieu des années 2010, dans le sillage de Black Lives Matter, est apparue une distinction de plus en plus claire entre des mouvements de lutte « contre les violences policières » et ceux qui luttent « pour l’abolition de la police ».
Les luttes antiracistes jouent ici un rôle central ?
Aux États-Unis, les luttes abolitionnistes se positionnent clairement comme des luttes contre le suprémacisme blanc et donc le racisme du système judiciaire. Tous les mouvements antiracistes ne sont pas abolitionnistes ; certains pensent que le système est réformable, qu’il faut des policiers issus des minorités, qu’il faut former les policiers pour qu’ils recourent moins à la force et qu’ils n’aient plus de comportements racistes. Les abolitionnistes représentent encore une minorité. Néanmoins, des décennies de politiques pénales racistes, l’ampleur des crimes policiers, tout cela contribue à ce qu’un nombre croissant de personnes ne croient plus aux approches réformistes.
Quelle est la place du féminisme dans le mouvement pour l’abolition de la police ?
Une des critiques qui peut être faite à la police est son rôle dans les violences faites aux femmes – sans parler des policiers auteurs de ce type de violences et qui constituent une proportion plus importante de cette profession que dans d’autres corps de métier. Les critiques peuvent être portées à différents niveaux. Tout d’abord, on peut reprocher à la police de ne protéger que certaines victimes – les « bonnes victimes » -, de mal recevoir les victimes, de ne pas intervenir lorsqu’elle est appelée, d’arrêter indistinctement toutes les personnes lorsqu’elle intervient suite à un appel pour des violences domestiques, etc. Mais les mouvements féministes et abolitionnistes formulent des critiques plus profondes du rôle de la police. Aujourd’hui, le recours à la police et au système pénal est souvent présenté comme une évidence pour lutter contre les violences sexuelles. Or, il s’agit d’un système profondément raciste et qui touche de manière disproportionnée les classes populaires. On ne peut pas faire passer le recours a la police comme un moyen d’émancipation collective.
Des positions abolitionnistes existent-elles aussi dans les mouvements LGBT, à partir du constat que la police n’agit pas toujours non plus réellement contre les violences homophobes ?
Les courants dominants de ces mouvements ne se réclament pas de l’abolitionnisme. Il y a néanmoins une tradition très forte, dans les communautés LGBT, de critiques et de pratiques abolitionnistes. Cela s’explique à la fois par le manque de protection que ces communautés peuvent attendre du système pénal, des formes de harcèlement policier qu’elles subissent, et leur plus forte criminalisation que le reste de la population.
La justice transformative est-elle aussi pensée comme alternative à la police ?
La mise en place de procédures de justice transformative permet de se passer de la police. Mais ce n’est pas en termes d’« alternative » qu’il faut penser la justice transformative. Comme toutes les pratiques qui se développent dans une perspective abolitionniste, elle entend surtout contribuer à la construction d’un monde où ce que nous déléguons aujourd’hui à la police, nos besoins de sécurité et de justice, soit pris en charge collectivement.
Notes
[1] Gwenola Ricordeau est professeure assistante en justice criminelle à la California State University, Chico, aux États-Unis, et chercheure associée au Centre d’études et de recherches sociologiques et économiques, de l’Université de Lille. Elle est l’autrice de Pour elles toutes. Femmes contre la prison paru en 2019 chez Lux.
Propos recueillis par Rachel Knaebel, Basta,
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte