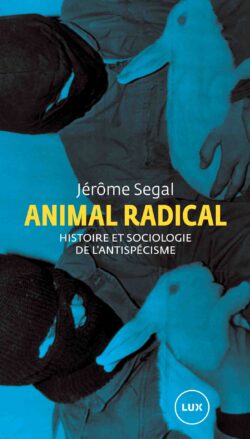Sous-total: $

Jérôme Segal: «Qui sont les animaux?»
La planète est donc paralysée. « Le coronavirus à l’origine de l’actuelle pandémie provient indiscutablement de la consommation d’animaux », vient de rappeler un collectif essentiellement constitué de médecins. Jérôme Segal, historien et chercheur, a cosigné cette tribune. Si l’apparition de maladies liées aux types de relations que nous entretenons avec les animaux n’est évidemment pas inédite, peut-être cette crise sanitaire-ci amènera-t-elle à les reconsidérer en profondeur, avance l’essayiste. Son dernier ouvrage, Animal radical, vient de paraître (du moins le sera-t-il vraiment lorsque les librairies rouvriront). Sous-titré Histoire et sociologie de l’antispécisme, il donne à lire la diversité souvent contradictoire de ce mouvement philosophique et politique. Fort d’une enquête conduite en France, au Canada et en Israël, il rappelle également ses racines historiques au sein de la tradition socialiste — et plus encore libertaire —, avant même de s’être déployé sous le nom d’antispécisme dans les années 1970 via la gauche anglosaxonne. Nous revenons avec lui sur le tableau qu’il brosse.
Jusque dans les rangs anticapitalistes, il existe des détracteurs de la cause animale particulièrement virulents. Jocelyne Porcher et Paul Ariès, par exemple, arguent que l’antispécisme est à bannir, car il serait extrémiste, et que le véganisme ferait le jeu du capitalisme mondialisé…
D’abord, l’extrémisme mériterait d’être défini. Qu’est ce qui est « extrémiste » ? penser qu’un porc, dont les capacités cognitives sont supérieures à celle d’un chien, doit vivre l’intégralité de sa vie en enfer — séparé de sa mère à la naissance, castré à vif, les dents limées, la queue coupée, passant sa vie dans un hangar sur caillebotis en n’apercevant la lumière du jour que lorsqu’il est conduit à l’abattoir — ou penser qu’on peut très bien vivre en bonne santé, à tous les âges de la vie, avec une alimentation végétale ? Être minoritaire (les véganes sont moins d’1 % dans la population), ce n’est pas forcément être « extrême », même si on remet en cause une part profonde de notre culture, concernant l’alimentation et les loisirs (plus de zoos ni de chasse, d’équitation ou de corrida). L’accusation d’extrémisme recoupe celle de radicalité, souvent associée à tort à la violence… L’attitude néolibérale du président Macron est par exemple plus « radicale » que celle du Parti animaliste, prêt à s’allier avec des écologistes ou des socialistes pour des élections. Macron est radical dans le sens où il ne déroge pas de son credo, qu’il n’envisage aucun changement de cap. S’il parle de nationalisation en temps de crise pandémique, ce n’est que pour mutualiser les pertes en attendant de pouvoir privatiser à nouveau les profits — comme lors de la crise bancaire de 2008 où les banques ont été renflouées avec de l’argent public.
Et lorsque Jocelyne Porcher et Paul Ariès déclarent que les véganes sont les idiots utiles du capitalisme mondialisé, c’est tout bonnement stupide. Leur raisonnement, si l’on peut employer ce terme, consiste à dire que puisque des véganes consomment des produits industriels comme des « steaks végétaux » ou du « lait d’amande » (dénominations interdites dans les commerces par le lobby agroalimentaire), ils sont les promoteurs de cette industrie, effectivement mondialisée. C’est ridicule ! D’abord, la plupart des véganes que j’ai rencontrés pour écrire mon livre, que ce soit en France, en Israël, au Québec ou en Autriche, où je vis, ne sont pas du tout des adeptes des produits industriels. Ils cuisinent, tout simplement, avec les légumes qu’ils achètent, ajoutant des céréales, des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, et ne se soucient pas des « veggie burgers ». C’est le capitalisme qui, faisant feu de tout bois, surfe sur la mode végane. Et puisque les ventes de laits végétaux et de substituts aux produits carnés ont des taux de croissance à deux chiffres, un juteux marché se développe. Il faut se rendre compte qu’il existe bien un effet de mode pour le véganisme, notamment car des études montrent qu’une telle alimentation est meilleure pour la santé, mais que tous les véganes ne sont pas militants antispécistes !
La nuance n’est pas forcément évidente pour le lecteur ordinaire…
On peut être végane car on a entendu une joueuse de tennis comme Venus Williams dire que ce régime lui était bénéfique, ou parce que tel ou tel acteur d’Hollywood est végane, sans pour autant être antispéciste — c’est-à-dire lié à un engagement politique.

La « viande de synthèse » obnubile Ariès et Porcher !
Elle est actuellement développée dans quelques laboratoires. Si des véganes ont pu approuver ces recherches, c’est simplement par stratégie : on sait que de nombreux Occidentaux ont du mal à se passer de viande au motif que « La viande, c’est quand même vachement bon ». Un militant antispéciste « radical », dans le sens étymologique du terme, à savoir celui qui va à la racine du problème, répondra qu’une préférence gustative ne peut être opposée à un argument éthique (c’est « mal » de tuer et faire souffrir des êtres qui ne demandent qu’à vivre et être sujets de leur vie, avec les émotions et sentiments qui l’accompagnent). Un militant plus pragmatique pourra répondre « Eh bien goûte-moi cette viande de synthèse
, tu ne feras pas la différence ! ». Ce n’est pas pour autant que les antispécistes sont les suppôts du grand capital : Porcher et Ariès n’ont vraiment rien compris !
On peut donc clairement affirmer qu’il n’existe aucune incompatibilité entre la lutte sociale et la cause animale ?
Oui ! D’abord, les antispécistes posent comme point de départ, suivant en cela le darwinisme, que l’Homme est un primate. Ses intérêts doivent donc être considérés, comme ceux de tous les animaux sentients, c’est-à-dire capables de sentiments, d’éprouver de la douleur, de développer une personnalité. Les antispécistes sont donc de prime abord enclins à s’élever contre toutes les formes d’oppression — qu’il s’agisse de racisme, de sexisme, de capacitisme, d’âgisme, de classisme ou encore de discriminations à l’encontre des minorités sexuelles. La plupart des militants que j’ai rencontrés cumulaient plusieurs engagements. Il existe d’ailleurs un débat autour de l’intersectionnalité et de la convergence des luttes, porté par des militants de la cause animale. À côté de cela, il existe des antispécistes, comme Sasha Boojor, le fondateur de l’association 269 Life, en Israël, qui estiment que la cause animale doit être prioritaire car les animaux n’ont absolument aucun moyen de faire valoir leurs droits — à commencer par le plus élémentaire d’entre eux, celui de ne pas être tué. Chez ces militants, la souffrance des animaux est telle et les résultats de leur politique si maigres, qu’ils peuvent parfois développer une forme de misanthropie liée à une forme de désespoir.
Ils sont minoritaires ?
Tout à fait.
Vous le rappelez d’ailleurs : historiquement, socialistes et anarchistes ont été liés à la cause animale — qui a pris le nom d’antispécisme dans les années 1970. Qu’en est-il de ce lien, aujourd’hui ?
C’est assez compliqué. Je dirais que l’anarchisme et le socialisme restent présents dans l’esprit de nombreux militants antispécistes mais que les instances de ces mouvements gardent leurs distances avec le mouvement animaliste. Prenons les anarchistes, par exemple. Dans son Petit lexique philosophique de l’anarchisme, paru en 2001, Daniel Colson consacre une entrée à l’antispécisme, mais essentiellement pour démarquer ce mouvement de la pensée libertaire1. En premier lieu, selon lui, la libération doit venir des sujets opprimés eux-mêmes, refusant les intermédiaires ou représentants de leurs intérêts. Or les animaux ne peuvent pas faire d’actions directes et les militants qui disent les représenter n’ont, dans cette optique, aucune légitimité. Deuxièmement, poursuit-il, l’antispécisme s’appuie largement sur une philosophie utilitariste visant une maximisation du bien-être qui ne correspond pas aux aspirations anarchistes, puisque l’utilitarisme est compatible avec les inégalités et reconnaît un prima du bonheur sur l’idée de justice. Enfin, toujours selon Colson, dans sa volonté d’accorder des droits aux animaux non-humains, l’antispécisme se rapproche sans le vouloir d’un humanisme devenu suprémacisme humain — car c’est bien l’Homme qui décide quels sont les animaux sentients dignes d’être défendus.

Mais les « fondateurs » de l’antispécisme en France sont issus de la mouvance anarchiste…
Oui. David Olivier ou Yves Bonnardel, à l’origine des Cahiers antispécistes à partir de 1991, s’en réclament au moment où ils créent cette revue. Les fondateurs de l’association L214, Brigitte Gothière et Sébastien Arsac, viennent aussi de ce milieu — et aujourd’hui encore, on trouve dans leur association des signes qui rappellent ces origines, par exemple la collectivité des décisions et le salaire unique (2 300 euros brut) quel que soit le poste occupé au sein de l’association. Du côté des socialistes ou de ce qu’on nomme souvent aujourd’hui « la gauche de la gauche », c’est un peu la même chose. Les partis ou grandes associations ont du mal à soutenir ouvertement la cause animale, tant la rupture sociétale que suppose l’antispécisme est grande. La fin de l’élevage, par exemple, pour laquelle L214 organise chaque année une grande manifestation, est un mot d’ordre inaudible pour le syndicat de gauche des paysans, la Confédération paysanne. Parmi les antispécistes, la conduite à tenir vis-à-vis des « petits éleveurs » constitue d’ailleurs un point de discorde. Certains, plutôt pragmatiques, estiment que la cause première de souffrance des animaux est l’élevage intensif de type capitaliste dont la Ferme aux mille vaches est devenue un symbole en France. La Confédération paysanne et L214 se sont rencontrés contre ce projet. D’autres, au contraire, représentés par exemple au sein d’associations comme 269 Life France, 269 Libération animale ou Boucherie Abolition, estiment qu’il ne peut exister de bon « élevage » et que si l’on veut vraiment fermer les abattoirs, il n’y a pas lieu de s’allier avec des éleveurs, petits ou grands.
Dans le cadre de votre enquête, avez-vous pu confirmer l’idée, très répandue, que les partisans de la cause animale sont économiquement privilégiés ?
C’est tout à fait faux. Pour mieux connaître ce milieu, j’ai pratiqué l’observation participante : la plupart des militants rencontrés vivent très modestement, souvent au RSA, et sont parfois en rupture avec la société. Je me souviens notamment d’une jeune femme d’une vingtaine d’années qui ne pouvait venir à une action prévue à Paris le 1er novembre 2018 — il s’agissait, le jour des morts, de présenter en silence des affiches révélant ce qui se passe dans les abattoirs sur une place parisienne emblématique — car elle n’avait pas les moyens de prendre un train de banlieue. Il y a aussi le mouvement « freegan » qui prône le véganisme en récupérant les invendus des marchés et supermarchés dans les poubelles. Ces militants ne viennent généralement pas du tout des classes aisées. Bon nombre de militants vivent sur des refuges qu’ils ont créés en pleine campagne pour les animaux qu’ils ont « sauvés » (ou « volés », selon la perspective), dans les abattoirs ou dans les élevages. Il y a aussi bien sûr des militants de type « universitaire », dont je fais partie, relevant d’une sociologie propre aux milieux qui permettent de faire de longues études, donc plutôt aisés. Mais ces universitaires font partie de ce milieu car ils sont universitaires, et non en raison de leur antispécisme, souvent tardif.
La cause animale semble davantage investie par les femmes que les hommes — on a même pu parler d’une cause « féministe ». Comment le comprendre ?
Effectivement, il y a bien plus de femmes parmi les représentant·e·s de la cause animale. Le Parti animaliste français a eu beaucoup de mal à établir des listes paritaires ! Lors des premières élections où le parti s’est présenté — les législatives de 2017 —, ils ont dû payer une amende importante car ils avaient trop de femmes sur leurs listes ! Son financement public a ainsi été amputé de 36 %, ce qui, à mon avis, ne respecte pas l’esprit de la loi visant à promouvoir la participation des femmes à la vie politique. Je vois deux raisons à cette surreprésentation des femmes au sein de ce mouvement. L’une politique et l’autre biologique — au risque de m’attirer les foudres de certain·e·s… La première est l’expérience des discriminations : les antispécistes s’attaquent au carnisme, l’idéologie selon laquelle il serait bon, naturel et nécessaire de consommer de la viande, notamment pour ce qu’elle représente en termes de force et de virilité. Manger de la viande, c’est pour beaucoup assumer une virilité machiste, vivre le mythe du chasseur qui domine la famille — même si aujourd’hui les hommes ne chassent la viande que dans les rayons de supermarché, sans avoir à trop se fatiguer.

es femmes sont méprisées au rang d’animaux, appelées de façon générique « poules » ou « dindes », voire « ma biche » dans l’intimité. La métaphore animale recoupe aussi l’idée d’une domination sexuelle, très bien exposée par Carol J. Adams dans La Politique sexuelle de la viande. Dans mon livre, je cite les propos d’une prostituée qui s’est sentie vivre en tant « qu’animal » lorsqu’elle faisait de « l’abattage », et que les clients la traitaient comme un « morceau de viande »… En réaction, cette femme est devenue végane puis antispéciste. L’autre raison est issue de ce que j’ai pu entendre lors de nombreux entretiens : l’expérience de l’allaitement. Des femmes m’ont expliqué qu’en allaitant leur enfant, souvent pendant de longues périodes, elles ont pris conscience de leur réalité de mammifère. Depuis, elles réalisent combien il est atroce de retirer un veau à une vache dès la naissance pour le placer dans une cage d’engraissement. Il n’y a rien de normatif dans cette observation que je livre, et cela n’a rien non plus de prescriptif : je rapporte juste un constat et cela me semble expliquer, en partie, la surreprésentation des femmes dans la cause animale. Et puis cette surreprésentation des femmes s’explique également mécaniquement par une sous-représentation des hommes. La société impose un modèle de « virilité » aux garçons, puis aux hommes, qui les éloigne de domaines comme la défense des animaux — considérés comme de la sensiblerie. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons choisi, avec mon éditrice, cette couverture où un homme cagoulé tient dans ses mains un lapin. Une certaine tendresse se dégage de cette photo qui va à l’encontre des clichés : l’homme cagoulé est associé à tort à la violence, puisqu’on le voit tenir un lapin blanc avec délicatesse.
Vous avez également constaté la spécificité de la cause animale en Israël. D’un côté, majoritaire, une récupération gouvernementale, un phénomène de mode qui contribue à dissimuler la colonisation en Palestine. De l’autre, des militants antispécistes usant de l’action directe pour agir. Les seconds ne devraient-ils pas aussi lutter contre les premiers ?
Oui, il y a un effet de mode très fort en Israël pour le véganisme. Si vous demandez un cappuccino dans un café de Tel Aviv, on vous proposera presque automatiquement trois ou quatre types de laits végétaux. On trouve des magasins de chaussures proposant des modèles sans cuir, avec un logo « vegan friendly » sur la vitrine. Le gouvernement exploite ce filon, comme il le fait avec la vie LGBTIQ+ assez développée dans cette ville de bord de mer. Jean Stern a consacré un livre à ce qu’il nomme ainsi le « pinkwashing ». On peut de même parler d’un « vegan washing » : promouvoir un aspect positif, moderne et bienveillant pour cacher des aspects moins reluisants comme le traitement réservé aux minorités non-juives (à commencer par les Palestiniens d’Israël, les Bédouins et les Druzes), mais aussi, bien sûr, la colonisation en Cisjordanie, les bombardements réguliers à Gaza, les assassinats ciblés et autres manquements aux droits de l’homme régulièrement dénoncés par Amnesty International.
J’ai parlé de tout cela de façon très ouverte avec des militants antispécistes israéliens. Ils condamnent tous la politique de Netanyahu mais se sentent malheureusement impuissants. Certains sont même devenus antispécistes en réaction à des années ou des décennies de militantisme inutile pour le camp de la paix. Avec la cause animale, ils obtiennent enfin des succès. D’autres s’engagent pour les animaux par priorité, estimant que les Palestiniens ont déjà de nombreux alliés. Mais je ne pense pas qu’il nous incombe, à nous qui vivons en Europe, d’expliquer aux Israéliens quels doivent être leurs combats. Ne serait-ce, par exemple, pas plus efficace de faire pression sur le gouvernement israélien à partir de l’extérieur du pays, comme ce fut le cas dans la lutte contre l’apartheid ? Et puis, surtout, s’engager dans la cause animale ne représente pas une lutte « secondaire », selon l’idée qu’après tout, il ne s’agit que d’animaux. À quelqu’un qui s’engage contre le racisme, demande-t-on aussi de s’engager pareillement pour la lutte contre le changement climatique et contre les méfaits du capitalisme ? Non, on reconnaît à SOS Racisme, par exemple, le droit de focaliser sa lutte sur ce sujet. Pourquoi ne serait-ce pas pareil pour l’antispécisme ?

Vous avancez dans un texte qu’affirmer sa judéité passe, que l’on soit croyant ou athée, par un engagement inconditionnel pour une cause perçue comme juste. Est-ce là une explication satisfaisante de l’ampleur que prend, sous des formes diverses, la cause animale en Israël ?
Ça n’est pas exactement ce que j’ai écrit. Dans mon livre Athée et Juif — Fécondité d’un paradoxe apparent, je m’intéresse à la diversité de l’identité juive pour mettre en valeur une forme d’identité souvent négligée bien que très répandue, celle qui croise l’athéisme et la judaïté (simplement définie par le fait de dire « je suis juif »). Je décline cette identité, par essence multiple, en traitant le cas des Juifs qui se définissent comme tels à cause des persécutions subies pendant la Seconde Guerre mondiale, en traitant aussi le cas de ceux qui se sentent juifs en raison d’un attachement inconditionnel à Israël ou encore de ceux qui se sentent juifs car, bien qu’athées, ils respectent certaines pratiques comme celle de la circoncision que je condamne sans ambiguïté. Et à côté de ces catégories, je m’intéresse à celle à laquelle je m’identifie le plus (moi qui suis aussi athée et juif) : les Juifs qui se sentent juifs à travers la solidarité inconditionnelle qu’ils éprouvent avec les opprimés. Il y a donc deux contresens à éviter : on peut très bien être athée et juif sans ressentir cette solidarité et on peut très bien vivre cette solidarité sans être juif ou sans être athée !
C’est en écrivant ce livre sur l’identité juive que j’ai découvert la cause animale. Peter Singer, par exemple, auteur de La Libération animale, livre considéré comme le premier ouvrage de philosophie justifiant la pertinence de l’antispécisme, m’a accordé deux entretiens. Il m’a expliqué que c’est en tant que juif, probablement parce qu’il est juif, qu’il en est venu, au début des années 1970, à prendre le parti des animaux si maltraités par les humains. De même, Henry Spira qui est le premier militant animaliste à obtenir une victoire politique — en l’occurrence la fin d’expériences aussi atroces qu’inutiles faites sur des chats au muséum d’histoire naturelle de New York — explique l’importance de sa judaïté dans son cheminement. Il a toujours vécu du côté des victimes d’injustice, qu’il ait été anarchiste, syndicaliste, enseignant ou militant de la cause animale. En Israël, on trouve des gens qui vivent leur engagement auprès des animaux sur ce modèle. On trouve aussi des gens qui luttent pour les animaux car ils sont frustrés, comme je l’ai dit, de leurs échecs pour mettre en place une paix avec les Palestiniens… et aussi des véganes qui le sont pour des raisons religieuses, estimant que les animaux sont aujourd’hui si mal traités qu’ils ne peuvent plus être considérés comme casher !
Vous avez cosigné, avec notamment Thomas Lepeltier et Yves Bonnardel, une tribune demandant des « assises nationales de la question animale » dans un grand quotidien. À qui vous adressiez-vous ?
Cette tribune parue en mai 2019 s’adressait à un public large, dans l’idée de le sensibiliser à la question animale. Il y a des moyens simples pour faire prendre conscience à nos concitoyens du caractère arbitraire du spécisme : les chiens et les chats disposent de lois qui les protègent (il est par exemple interdit de leur faire du mal), on leur consacre des salons de beauté, des rayons entiers de nourriture dans les hypermarchés, etc., alors que les porcs, par exemple, sont traités d’une horrible façon. La plupart des gens sont dans un état de dissonance cognitive : d’un côté ils reconnaissent que les violences subies par les animaux d’élevage ou par ceux qui sont victimes de la chasse n’ont pas lieu d’être, que c’est « cruel ». De l’autre, lorsque l’heure du repas approche, ils n’ont aucun problème à croquer dans un steak ou se repaître de sécrétions mammaires de jeunes vaches, chèvres ou brebis, fermentées à l’aide de coagulant prélevé dans le quatrième estomac de jeunes ruminants (oui, c’est bien là la recette du fromage !). Les Assises de la question animale auxquelles nous appelons dans cette tribune viseraient à informer le public sur qui sont les animaux, quelles sont leurs facultés (sentir, ressentir, éprouver de la douleur, de la compassion…), ce qui se passe actuellement dans les élevages et les abattoirs ou encore les alternatives aux produits animaux. Des conclusions pourraient en être tirées, sur la meilleure façon d’en venir à une abolition de l’exploitation animale. Sur certains sujets, comme la corrida, qui repose sur une séance de torture de taureaux pendant 20 minutes avant une exécution plus ou moins rapide et douloureuse, on sait déjà que les Français sont prêts à mettre un terme à ces pratiques aujourd’hui encore tolérées dans quelques départements.

Vous dites ne pas vouloir « passer sous silence les dérives du mouvement » : quelles sont-elles ?
Il y en a plusieurs. Historiquement, il y a eu d’abord l’hygiénisme : considérant que les hommes devaient s’astreindre de produits d’origine animale pour des raisons de santé, des anarchistes comme Georges Butaud, Sophie Zaïkowska et Louis Rimbault ont créé au début du XXe siècle des « communautés végétaliennes » dans lesquelles on proscrivait aussi le tabac, l’alcool et tout ce qui était déclaré nuisible. Il y avait de plus en plus de règles à respecter pour une hygiène de vie toujours plus exigeante… et ces communautés ont fini par se déliter. Dans la revue Le Néo-Naturien, fondée par Rimbault, on a vu apparaître des récits enthousiastes sur les foyers analogues qui se développaient au Brésil, qualifiés de « Néo-Aryens », engagés pour l’obtention d’une nouvelle race humaine… De même, à la pension Monte Verità, fondée en 1900 dans le Tessin helvétique, on trouve des personnages aussi importants que Franz Kafka, Isadora Duncan, Otto Gross, Max Weber ou encore Hermann Hesse, puis l’amour de la nature laisse place à un culte du corps et de la force virile. Certains s’engagent dans le national-socialisme ou le servent indirectement, comme Rudolf von Laban, qui, après avoir dirigé à Monte Verità une école d’été de la danse, de 1913 à 1919, mettra en scène un spectacle de 1 000 danseurs pour les Jeux olympiques nazis, à Berlin en 1936.
Et aujourd’hui ?
Une dérive du mouvement peut être la recherche de pureté absolue — un écueil d’ailleurs très tôt identifié par Françoise Blanchon en 1993, dans les Cahiers antispécistes. Certains militants, assez rares, repoussent toujours plus loin les contraintes qu’ils s’imposent. Ils n’achètent pas de légumes dans une boutique qui vend également de la viande pour ne pas que leur argent serve l’exploitation animale. Et même dans le choix de leurs légumes, ils vont veiller à ce qu’ils ne soient pas produits en utilisant des engrais animaux comme le fumier. Ces militants peuvent aussi se couper d’autres compagnons de lutte, jugés trop « compromis ». C’est une dérive qu’on retrouve sûrement dans d’autres mouvements politiques… Enfin, il y a quelques militantes ou militants qui tiennent des propos très sévères pour dénoncer dans un même souffle le spécisme et le patriarcat, appelant à libérer les animaux d’élevage et les femmes voilées : Solveig Halloin, de Boucherie Abolition, a ainsi pu dire qu’il fallait arracher les voiles des femmes qui le portent pour les « libérer »2…
« Assurer la sécurité des agriculteurs » face à des « extrémistes » aux actions « idéologiques » : que penser de la création de la cellule Déméter mise en place par le ministère de l’Intérieur ?
Il s’agit clairement d’une concession faite au lobby de l’agriculture productiviste, la FNSEA. D’abord, la sécurité des agriculteurs n’a jamais été menacée ! S’il y a bien eu quelques intrusions dans des élevages, c’était à visage découvert, sans aucune arme et sans blesser ni menacer quiconque. Et sur « l’extrémisme » et l’accusation de « radicalité », je vous ai déjà fait part de mes réserves… En fait, plus inquiétant que cette cellule Déméter, il y a le concept « d’agribashing » largement repris dans les grands médias.
Pourquoi ?
N’importe quelle critique de l’élevage est considérée comme de l’agribashing, un mépris à l’encontre des agriculteurs, pour ce qu’ils sont et non ce qu’ils font ! Un militant qui prend en photo un éleveur en train de claquer des porcelets — une pratique courante consistant à tuer, en les frappant contre un mur les porcelets jugés trop faibles ou souffrant de malformation — sera accusé d’agribashing. Un écologiste se plaignant des pollutions aux algues vertes générées par les élevages porcins bretons, sera lui aussi accusé d’agribashing.

Nous nous trouvons en ce moment en pleine pandémie, née de la consommation d’animaux. La question se pose évidemment : les antispécistes avancent-ils des arguments liés à la santé humaine pour faire valoir leurs thèses ?
Parfois, oui. Même si c’est davantage par stratégie car, pour eux, la souffrance des animaux est la priorité. Il se trouve que depuis octobre 2015 l’OMS définit les produits transformés à base de viande (charcuteries, « cordons bleus », « nuggets », etc.) comme cancérogènes et la viande rouge comme probablement cancérogène. Mais les dégâts causés par l’industrie de l’élevage sont infiniment plus graves. L’antibiorésistance, par exemple, directement liée au élevages intensifs, fait 700 000 morts par an dans le monde. Les chercheurs s’intéressent aujourd’hui aux grandes épidémies de grippe qui trouvent leurs origines dans des épizooties au sein d’élevages. La grippe espagnole de 1918–19, qui fit 30 millions de morts en quelques mois, soit à peu près autant que le sida de 1981 à aujourd’hui, est liée au virus H1N1, probablement d’origine aviaire. Le sous-type H5N1 provient lui indiscutablement d’une grippe aviaire, qui se répand par les élevages de poulets, comme les grippes de 1957 et 19683 qui ont fait respectivement, selon l’OMS, trois millions de morts.
Depuis janvier de cette année, c’est en effet une pandémie d’un nouveau coronavirus, SARS-CoV‑2, qui a trouvé son origine en Chine à Wuhan dans un marché aux animaux sauvages, et cause la maladie Covid-19. On ignore encore l’ampleur que prendra cette pandémie mais on sait qu’une pandémie de l’ampleur de la grippe espagnole est possible à tout moment… Les antispécistes notent, non sans malice, qu’il n’y a jamais eu de « grippe carottière » ou de maladie neuro-dégénérative liée à la consommation de pois chiche ! C’est bien la consommation de viande, plus que tout autre aliment, qui nuit à notre santé. Il y a 13 ans déjà, des épidémiologistes notaient qu’il n’est pas surprenant que les trois-quarts des nouveaux pathogènes ayant affecté les humains dans les 10 dernières années proviennent des animaux ou des produits animaux. À coté de leurs arguments éthiques, les antispécistes se feront peut-être, avec la pandémie actuelle, mieux entendre.
llustration de bannière : Miroco Machiko | mirocomachiko.com
Ballast, 2 avril 2020
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte