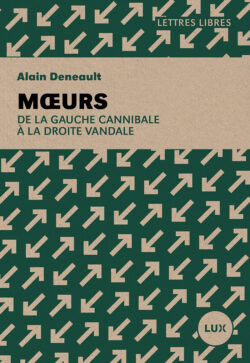Sous-total: $

«Je suis pas opposé à la radicalité; je suis opposé à la bêtise» —Alain Deneault
Ce texte est la seconde partie d’une entrevue accordée par le philosophe Alain Deneault, qui a délaissé l’Université de Moncton, où il enseigne, pour revenir cette semaine dans sa région natale, Ottawa-Gatineau, où il vient prendre la parole à l’Université d’Ottawa et à la librairie Bouquinart.
Le Droit : Revenons aux perceptions entourant la radicalité…
Alain Deneault: Je ne suis pas opposé à la radicalité – je la trouve même pertinente – je suis opposé à la bêtise. Je n’aime pas qu’on soit simpliste, [surtout] dans des raisonnements de cette nature. Si vous vous sentez tout d’un coup d’une certaine façon parce que vous avez entendu telle chose, et si au nom de ce sentiment-là vous vous permettez TOUT, tous les abus, toutes les violences, et bien ça, c’est tout simplement inacceptable! C’est une insulte à l’entendement, à l’intelligence. Donc, la radicalité, oui! Mais la radicalité pensée et réfléchie, qui s’inscrit dans un rapport adéquat aux choses.
Et je répète que [Karl] Marx était réfléchi et non pas un fou furieux. Rosa Luxembourg [autre porte-étendard de la gauche communiste] n’était pas une déchaînée en proie à je ne sais trop quelle furie. Ces modèles restaient des gens qui certes avaient des émotions, des malaises et des passions – c’était même le moteur de toute leur action – mais qui s’enquerraient vraiment et toujours, et j’insiste vraiment là-dessus, des RAISONS de leurs passions. «Quelle est la raison de mon malaise, de ma colère ou de mon indignation? » Chez eux, c’est la raison qui est en cause. Comme chez Aristote, pour qui l’éthique commence quand on est conscient des affects. L’éthique commence quand on pense les affects, quand on les structure, qu’on les agence et qu’on les situe [dans un contexte], et pas seulement quand on se contente de les produire.
C’est très intéressant de voir, par exemple dans le monde syndical, dans les milieux [visant à une] réforme radicale comme les partis socio-démocrates des années 60 et 70, ou [au sein des] mouvements d’extrême gauche du 20e siècle, encore plus exigeants… Ç’a été très intéressant de voir, au milieu du 20e siècle, des femmes et des étrangers dire «bon, vous militez pour [notre] émancipation, mais vous restez une bande d’hommes blancs tous issus du même milieu social, qui monopolisez la discussion et la présence publique, alors que nous, on continue de servir le café, faire la vaisselle et torcher [les enfants].»
Ce discours intersectionnel est passionnant, mais dans un contexte donné [et non pas lorsqu’on l’utilise de façon absolutiste].
Le Droit : Vous venez de citer Marx et Rosa Luxembourg; avez-vous le sentiment, d’être – ou d’être perçu – comme un radical, aujourd’hui, malgré le fait que, vous le répétez, ce qui sous-tend votre démarche, ce qui vous importe, c’est moins l’humeur ou l’indignation que «la raison» qui les motive?
AD: Vous parlez de perceptions, alors oui, très certainement. J’ai milité pour le démantèlement du Canada et je milite pour l’abolition des multinationales. Il y a peut-être des gens qui trouveront cela radical. Moi, ce que je dis, c’est que ce n’est pas la radicalité qui pose problème. La radicalité non seulement peut être intelligente, mais elle doit l’être. Sauf que si l’on veut être radical, on doit être encore plus exigeant [envers nous-mêmes] sur le plan de la pensée, et tenir une réflexion qui soit en adéquation avec un réel historique.
Maintenant, ce que j’ai souvent dit, c’est que s’il y a bien un régime radical qui opère aujourd’hui, c’est le régime capitaliste. Il détruit tout sur son passage. Il saccage le vivant. Il fait disparaître [l’équivalent de la superficie de] l’Autriche en forêt, chaque année. Il met à risque un million d’espèces dans le monde; on n’a pas vu ça depuis des millions d’années. C’est impensable à quel point ce régime est violent. On est capable de faire rentrer dans un petit wagon la poignée de multimilliardaires qui [possèdent] autant que la moitié de l’humanité la plus pauvre. C’est un régime extrémiste. Et c’est pour ça que [je qualifie] notre régime ‘d’extrême centre’.
Alors, à côté de cela, oui, on peut voir mes positions – et celles de tant d’autres – comme étant radicales… mais en définitive il s’agit d’aller au fond des choses, de les prendre à leurs fondements.
C’est en cela que la radicalité est aujourd’hui non seulement pertinente, mais nécessaire. Pour faire face à une autre [radicalité], qui, elle, ne se nomme pas, sauf par des fanfaronnades comme l’expression «extrême centrisme»

***
LD: Cette «radicalité nécessaire», avez-vous le sentiment qu’elle perd du terrain? Qu’elle peine à s’exprimer au sein de l’espace public, faute de plates-formes adaptées à une réflexion en profondeur? Ou au contraire qu’elle en gagne? Avez-vous l’impression de prêcher dans le vide? Ou le fait que vos propos soient relayés dans les médias vous donne l’impression d’avoir un impact positif sur la reconstruction du débat?
AD: [montrant des signes d’agacement] J’ai l’impression que si je vous réponds, je vais donner l’impression d’être une sorte de vendeur de salades. [Nous occultons, à sa demande, la partie marketing de sa réponse.] Il y a un intérêt pour ces questions-là. Regardez comment la multinationale Total fait l’objet de frondes, cette année. Il y a aujourd’hui, dans la population, un appétit immense pour des discours, des réflexions, des modes d’être qui ne sont ni ceux de la ‘technoscience’ et de la science de pointe comme on la pratique de manière hermétique dans bien des universités, ni pour les productions médiatiques ‘à la chaîne’ qui sont… «trop peu substantielles», disons, qui ne nourrissent pas assez. Il y a un appétit immense pour les discours qui ne relèvent pas de la simple idéologie.
Aujourd’hui, dès qu’on est un petit peu éveillé, on cherche à faire face à des défis formidables, en sachant déjà que cette mondialisation extractiviste-productiviste,-consumériste-capitaliste est chambranlante. Partout, il y a des bris d’approvisionnement. On voit bien qu’on ne peut pas satisfaire, à l’échelle du monde, un développement qui serait conforme au modèle occidental. On ne peut pas mondialiser les opérations comme on le fait. On ne peut pas mettre sous pression le vivant, comme on le fait par exemple dans le domaine agricole. On voit bien qu’il faut repenser toute autre chose. Et il y a [au sein de la population] un appétit pour ça.
Et je pense que, parfois, les quelques dérives intersectionnelles – sur lesquelles on insiste beaucoup trop; qui sont un vrai problème, mais qui ne sont pas LE problème – sont parfois, de la part des militant.e.s, un transfert. Un transfert sur des questions spécifiques, quant à des enjeux plus grands. Comme ceux qui concernent le vivant. Quelle question peut être plus grande que celle-là? [Donner une nouvelle orientation à] l’organisation du monde, c’est le défi de notre siècle.
L’Avenir est aux biorégions
LD: Vous dites que cette société mondialisée est «chambranlante». Je sais que vous prenez en général garde à ne pas prophétiser un effondrement que la gauche a trop souvent annoncé, dans le passé. Mais avec l’urgence qui est la notre – la Conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, qui se déroule ces jours-ci en Égypte, est encore une fois en train de le rappeler – cet effondrement ne risque-t-il pas d’arriver plus tôt que tard?
AD: Ah, mais on n’est même pas sur le régime de la prophétie: c’est du domaine du savoir. On est évidemment face à ce que j’ai appelé le ‘sale quart d’heure universel’ qui nous attend. Mais le terme «effondrement» est un peu [erroné à mon sens]…
LD: Pardon! Effectivement, je sais que vous n’aimez pas trop ce mot. Vous lui préférez, je crois, celui de «glissement» ou «renouvellement».
AD: L’érosion exponentielle… mais ça veut dire la même chose. J’apprécie beaucoup ce que font Pablo Serving, Raphaël Stevens, Yves Cochet et bien d’autres [auteurs s’intéressant à la transition écologique]. J’apprécie beaucoup le GIEC [NDR: le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]. Il faut vraiment être ‘hors-sol’ pour ne pas voir les nombreux signes qui nous montrent aujourd’hui l’envergure du ressac qui se prépare!
Il me semble évident qu’il y aura dans ce siècle une contraction de la géopolitique, que nous passerons de la mondialisation extractiviste-consumériste à une échelle biorégionale. [Un avenir] où il n’y aura plus de pétrole ni de minerais abondants, et où il faudra réapprendre à s’organiser à une échelle viable. Où il faudra faire en sorte que ça tienne, comme on essaie aujourd’hui de faire tenir ce régime capitaliste.

Mon travail sur les mœurs n’est qu’un excursus [une digression]. Tout mon travail des dernières années, notamment dans le cadre de mon programme d’université d’été dans la péninsule acadienne – qui s’appelle «L’été des humanités» – a été d’inviter des étudiants du premier cycle universitaire à réfléchir sur la notion de biorégions [un territoire défini non plus par ses frontières politiques, mais par des contingences liées à sa géographie ainsi qu’aux sociétés humaines et aux écosystèmes qui le compose, NDLR.] Pour moi, il est clair que la péninsule où j’habite est une biorégion. C’est un laboratoire, cette presqu’île.
Une biorégion est une région qui a un statut géopolitique, mais qui se pense en fonction de ses dynamiques écologiques. C’est un espace dans lequel on sera amené à réfléchir aux questions politiques fondamentales, à savoir quels sont nos talents, nos forces, nos dispositions, nos compétences; quels sont nos aspirations, nos désirs, nos projets d’autre part. Et quelles sont nos urgences.
Et il faudra s’organiser en cessant d’exporter à des Chinois ou des Américains une matière première ou je-ne-sais-trop-quoi qui aura été transformé en produit industriel pour être revendu… tout ça pour nous permettre, [grâce à] un petit pouvoir d’achat, de consommer dans ces grandes enseignes qui dominent aujourd’hui la marche du monde. […] Le capitalisme ne pourra pas quadriller encore longtemps le fonctionnement du réel.
Certitudes, Tartufferies et ventres mous
LD: Revenons à votre livre, Moeurs. En résumé, quelle en est la conclusion?
AD: Ce n’est pas comme si j’arrivais avec une sorte de certitude. Il n’y a pas de conclusion, mais une intention. La visée de Moeurs, c’est de nous faire sortir du «ni-ni».
J’ai constaté que beaucoup de gens sont «ni-ni». [Dans le premier camp], on dit qu’on n’est pas Bock-Côté, ni Martineau, ni Le Pen, ni Legault, ni aucun de ces [idéologues] atrabilaires enfermés dans leurs trois ou quatre certitudes, qui confisquent l’État au peuple pour en faire strictement une agence de développement des grandes entreprises… et une instance de folklorisation des peuples, à commencer par le leur. Au [nom] de l’identité – parce qu’il faudrait que tout le monde soit identiques à soi!? – ces gens plongent des populations dans le formol.
D’autre part, il y a tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette rigidité, qui se disent «je ne suis pas ça», mais qui ne se reconnaissent pas non plus dans [les sermons] des mouvements exacerbés où, pour un symbole, un mot ou une amende non-payée par une militante noire en Nouvelle-Écosse [Viola Desmond, NDLR] il y a des décennies, on va se battre pour une couleur [de peau], pour un mot. Et on finit pas monter les choses en épingle et faire ce que Freud appelle «du déplacement et de la condensation», c’est-à-dire que tous les enjeux d’antan finissent par se retrouver dans des broutilles… et autorisent des abus, des excès, le fanatisme et les Tartufferies.
Bref, il y a tous ceux qui se disent «pas ça non plus!»
Pour moi, le problème, c’était de sentir que tous ceux qui ne sont pas dans le ni-ni ne savaient plus trop quoi dire, dans le débat public. Face à des cas comme Robert Lepage [accusé d’appropriation culturelle lorsqu’il montait le spectacle Kanata], face à des cas comme l’affaire [du «mot en N» prononcé] par une professeure à l’Université d’Ottawa, ceux qui se disent «je ne suis ni de ce côté-ci ni de ce côté-là, il y a bien un entre-deux» sont nombreux.

J’ai donc essayé [dans le livre] de jeter les bases d’un discours positif, où on peut penser la justesse, l’adéquation, la rigueur – tout en restant radical. Cela m’importait. Qu’on soit, sans être dans la molesse du «un peu de oui, un peu de non, un peu de tout, et on va trouver un compromis» qui fait l’affaire des grandes entreprises.
Quand on est ‘ventre mou’, on a alors une sorte de représentativité de façade, effectivement, mais on reste dans un monde qui continue de dominer les femmes et les paysans, qui continue de dominer le tiers-monde et tous ceux qui ont historiquement été dominés.
L’élément le plus important, dans cette évolution, c’est le primat de l’intelligence. La radicalité doit rester intelligente pour rester radicale – et pas simplement fanatique, ou de l’ordre de la Tartufferie.
• • • • •
Alain Deneault s’est fait connaître pour ses prises de position indignées – mais documentées – sur le capitalisme sauvage et le recours des multinationales aux paradis fiscaux. Ses écrits sur les pétrolières Irving et Total (Écosociété) étaient d’ailleurs le terreau de deux documentaires télévisés diffusés ces derniers jours, l’un à l’émission Enquête, l’autre sur la chaîne européenne Arte. Télé-Québec propose en outre, ce mercredi 9 novembre, le documentaire Pour nous chez nous, qui porte sur l’autonomie alimentaire et s’inspire de réflexions étayées par M. Deneault dans sa série sur Les Économies (Lux Éditeur).
Yves Bergeras, Le Droit, 11 novembre 2022.
Photo: Étienne Ranger / Le Droit
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte