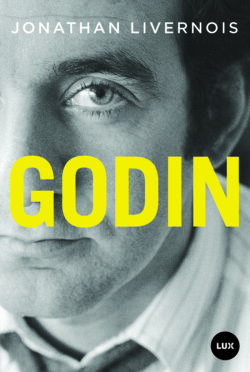Sous-total: $
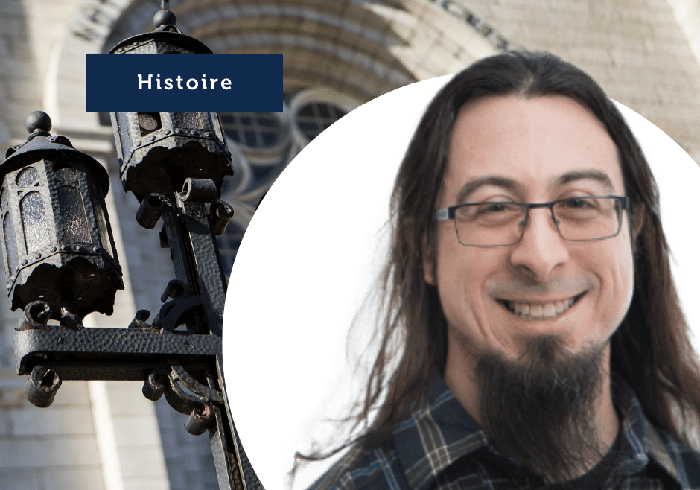
Gérald Godin, le député humaniste
Gérald Godin est décédé le 12 octobre 1994, victime d’une deuxième récidive de sa tumeur au cerveau, un mois avant son 56e anniversaire. À l’occasion du 30e anniversaire de ce décès, il m’a semblé opportun de faire un bilan de la vie grandiose de ce député-poète montréalais d’origine trifluvienne, qui a considérablement marqué tout le Québec. C’est pourquoi j’ai lu la première biographie qui lui est consacrée, rédigée par Jonathan Livernois, professeur au Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval à Québec. (Lux Éditeur, 2023, 544 p.)
Poète, journaliste, homme politique, ministre, voyageur, écrivain, amoureux des femmes… nombreux sont les épithètes que l’on peut accoler aux passions de cet homme bien ancré dans l’existence et dans l’importance du geste vers l’autre. Même si l’on croit tous connaître Gérald Godin, cet ouvrage nous ouvre des portes pour mieux connaître son réseau social et ses amitiés (dont l’écrivain Réjean Ducharme) puis saisir toutes ses contradictions, ses angoisses et ses espoirs ainsi que l’évolution de sa pensée, passant du conservatisme traditionnel au nationalisme indépendantiste afin de sortir de l’aliénation québécoise.
D’emblée, Jonathan Livernois sait très bien comment nous plonger dans les diverses aventures, projets et controverses entourant Godin et les nombreuses crises ou tragédies qu’il a dû traverser pendant sa vie. C’est une lecture que je recommande à toute personne qui s’intéresse à l’histoire récente du Québec ou qui souhaite comprendre d’où peut provenir cet élan du cœur dans le désir de fonder un pays pour sa nation.
Cependant, l’auteur aime personnaliser son écriture en ajoutant quelques rares commentaires personnels qui sont teintés – que ce soit des expressions anglaises (You bet, guess why), des vieilles expressions littéraires qu’à peu près personne n’utilise (d’aucuns) ou des citations latines non traduites (tempus fugit), ce qui peut irriter le lecteur. De plus, on retrouve parfois des jugements de valeur sans les justifier ni en faire la démonstration comme l’idée que le Parti québécois aurait rejeté l’héritage de Godin en tant que « héros progressiste et le défenseur des communautés culturelles » et ce, depuis plus de deux décennies… Néanmoins, l’érudition de Livernois compense pour ces écarts et nous dévoile en détails la force de Godin.
Une vie engagée pour le Québec
Né à Trois-Rivières, le 13 novembre 1938, et baptisé dans l’impressionnante cathédrale néogothique de l’Assomption, Gérald Godin est le petit-fils d’un important organisateur électoral du Parti libéral et le fils d’un militant de l’Union nationale. Ses parents, Louisa Marceau et Paul Godin (un médecin qui habite et exerce au coin des rues Hart et Bonaventure), se sont mariés à Sainte-Anne-de-la-Pérade en 1936. Comme le précise l’auteur, « les futurs enfants du couple Marceau-Godin seront donc doublement mauriciens ».
Ce jeune homme conservateur, formé dans le milieu de droite que sont les institutions religieuses (Filles de Jésus, Séminaire Saint-Joseph), devient alors en quelques années un jeune homme de gauche qui fait la promotion « d’un nationalisme québécois moderne, décomplexé et humaniste ». En réalité, Livernois nous apprend que ce sont les missionnaires qui visitaient les élèves des Filles de Jésus qui ont éveillé chez lui le goût de la découverte et la curiosité des autres civilisations. D’autre part, la tante de Gérald, Florence, avait épousé un ingénieur haïtien, Adrien Georges, un oncle que tout le monde appréciait dans la région.
À la fin des années 1950, après du théâtre amateur, Godin délaisse ses études et débute le journalisme au quotidien Le Nouvelliste, où il travaille pendant cinq ans. Déjà en 1963, âgé de 25 ans et conscient de l’importance de la culture, il consacre l’un de ses articles à la piètre situation des bibliothèques du Québec.
Il déménage ensuite à Montréal où il devient rapidement recherchiste pour Radio-Canada, jusqu’en 1969, puis pour l’Office national du film (ONF), notamment pour la comédie musicale IXE-13 de Jacques Godbout ainsi que pour le documentaire On est au coton (1976) de Denys Arcand, portant sur la vie des Canadiennes françaises dans l’industrie du textile, qui subit la censure et sera interdit de diffusion pendant cinq ans.
Ensuite, il consacre sa vie, ses énergies et une bonne partie de ses revenus à la direction des Éditions Parti pris (1963-1976) qui édite des penseurs et des essayistes québécois. Même s’il manque l’opportunité de publier le manuscrit des Belles-sœurs de Michel Tremblay, il se reprend en publiant l’ouvrage Nègres blancs d’Amérique du révolutionnaire Pierre Vallières, qui va devenir malgré lui une pièce à conviction dans le procès contre les felquistes. À cette époque, en collaborant avec une trentaine d’éditeurs d’ici, Godin souhaite lutter contre l’édition française qui possède alors trop de pouvoir sur les librairies québécoises.
Lors de la Crise d’octobre 1970, il fait partie des 500 prisonniers politiques et se fait arrêter en pleine nuit, à 5h AM, embarqué par la police avec sa femme Pauline Julien, et devient le prisonnier numéro 13 AD 1. Cette incarcération sans mandat est permise par la Loi sur les mesures de guerre, adoptée par le Parlement fédéral, dirigé par Trudeau père. Alors que ce dernier était un intellectuel encensé à la revue Cité libre, respecté et admiré par Godin, c’est à partir de ce moment que la rupture est définitive entre les deux : il considère que cette « infâme [loi] est le point le plus près où nous sommes allés en direction du fascisme ».
À ce moment, il devient directeur de l’information de 1969 à 1973 pour Québec-Presse, un nouveau média autogéré avec près de 50 000 exemplaires par tirage qui offre une ligne éditoriale indépendante et plus à gauche. Le périodique Québec-Presse cherche une autonomie parmi les grands conglomérats de la presse de cette époque. Ses opposants l’appellent le « journal FLQ ». Selon Livernois, c’est le plus important projet de sa vie professionnelle. Malheureusement, certaines chicanes intestines et un manque chronique de financement conduisent à sa disparition en 1974. Quoique Godin se recycle en professeur de journalisme à l’UdeM et à l’UQÀM, cette libération douloureuse lui permet de se présenter en politique en battant le Premier ministre de l’époque, Robert Bourassa, dans sa propre circonscription, le 15 novembre 1976.
La politique dans la peau
Son implication au Parti québécois, une formation qu’il associe aux Patriotes de 1837-38 et à Louis-Joseph Papineau, lui permet de transformer le Québec et d’affirmer sa vision du pays. Au départ, Godin représente souvent le gouvernement québécois dans des événements tenus dans le reste du Canada. On le présente également comme l’un des « plus influents députés d’arrière-ban de la majorité à l’Assemblée nationale ».
Lors du référendum de mai 1980, Godin participe à la rédaction du Livre blanc sur la souveraineté-association en collaboration avec Denis Vaugeois et Camille Laurin pour parler d’histoire nationale. Il corédige notamment un manifeste qui en appelle au respect du droit des Québécois de choisir leur destin. Après ce qu’il nomme « le Grand Refus », il comprend que le nationalisme québécois doit passer par les immigrants et la minorité anglophone du Québec, comme lors de l’insurrection de 1837-38. Il souhaite « un nationalisme beaucoup plus ouvert et beaucoup plus soucieux de respecter les autres qui sont ici, et de faire en sorte que chacun apporte sa contribution à la construction du pays ». Cette idée-phare de faire le pays avec les autres cultures présentes au Québec est toujours pertinente pour l’achèvement du projet.
Au départ, René Lévesque est plutôt réticent à le nommer ministre, mais l’enracinement de Godin et son engagement auprès des minorités ethniques de sa circonscription lui plaisent beaucoup. En 1980, il est d’abord nommé ministre de l’Immigration, ensuite ministre d’État (par intérim) au Développement culturel et scientifique, en 1982, puis ministre des Communautés culturelles et de l’immigration.
Godin s’illustre entre autres comme directeur de la commission parlementaire qui doit réviser la loi 101 en tant que Ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française. En effet, Lévesque l’a nommé Ministre délégué aux affaires linguistiques. Il deviendra aussi ministre des Affaires culturelles, mais l’élection générale de 1985 fait perdre le pouvoir au Parti québécois. Grâce à sa lucidité, sa franchise et la cohérence de sa pensée, porté vers la tolérance et les compromis, il devient alors « le ministre peut-être le plus respecté de ce gouvernement, particulièrement dans les milieux anglo-québécois et allophones ».
Sans être un fanatique, Godin souhaite que le Parti québécois pose clairement la question à la prochaine élection : « indépendance ou assimilation ». En juin 1985, il est l’un des proches de René Lévesque qui lui demeure fidèle jusqu’à la fin et tente même de le convaincre de rester en poste. Rapidement déçu de Pierre-Marc Johnson, il manœuvre en coulisses pour le retour de Jacques Parizeau comme chef du PQ.
Enfin, par sa poésie, centrée sur le parler des classes sociales populaires et ouvrières, Gérald Godin a en quelque sorte revitalisé le mouvement de défense du joual (le parler québécois) et permis dans un sens la promotion des élocutions locales en sauvegardant des perles du trésor de la langue québécoise ou de d’autres cultures linguistiques présentes sur son chemin. Selon Livernois, c’est au milieu des années 1960 qu’il trouve sa voie qui se situe « à mi-chemin entre le joual, la poésie moderne et les traditions populaires », notamment grâce aux éditions trifluviennes du Bien public, dirigées par l’écrivain Clément Marchand (1912-2013). Godin, poète de la quotidienneté, reçoit au moins sept prix majeurs, dont le Grand prix littéraire de la SSJB de la Mauricie en 1970. Parmi ses œuvres, rappelons Chansons très naïves (1960), Poèmes et cantos (1962), Les Cantouques (1966), Libertés surveillées (1975) et Sarzènes (1983).
D’ailleurs, moins d’un an après son décès, le nouveau collège francophone de l’ouest de l’Île-de-Montréal annonce, le 30 août 1995, que l’institution va porter son nom en son honneur, car il fut « un homme d’action qui a incarné le Québec français en même temps que l’accueil et le respect des autres cultures ».
Jean-François Veilleux, La Gazette de la Mauricie, 9 octobre 2024.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte