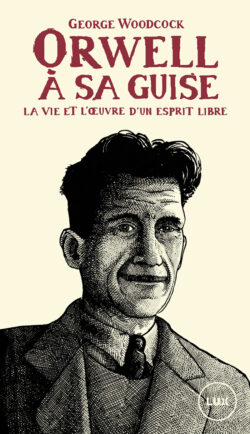Sous-total: $
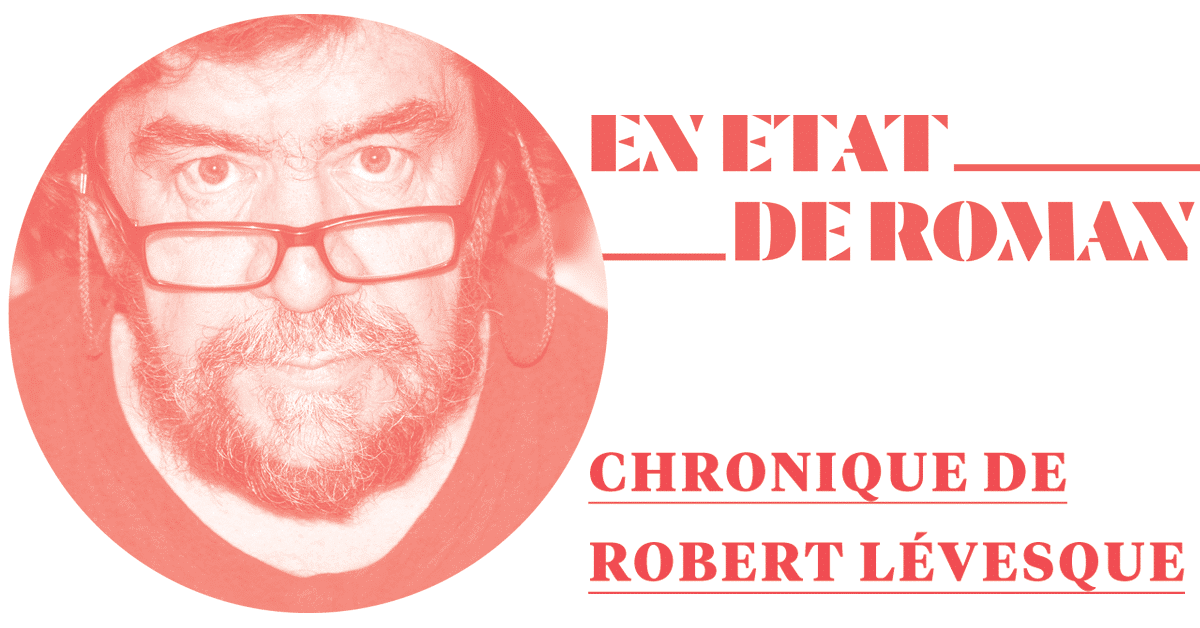
George Orwell: Écrire pour des idées
Deux mille vingt et un est une année importante pour l’auteur de 1984 car son œuvre tombe à la fois dans le domaine public et entre dans la Bibliothèque de La Pléiade. Elle sera à la fois accessible à tous et logée dans le palace le plus huppé de la littérature mondiale, entre Nietzsche et Pascal. Il y sera inconfortable, ce qui lui sied à merveille car cet Orwell était un irascible, partout, toujours.
Il aura été le type même de l’écrivain qui écrit non pas pour plaire, mais pour conscientiser, non pas pour être aimé ou simplement admiré, mais pour défendre ses idées bien à lui envers et contre tout, et contre tous, car formé à Eton il y vilipenda l’élite, communiste il détestait les staliniens, anarchiste il combattit les pacifistes, socialiste il s’en prit de front au Parti travailliste, devenu fier patriote quand éclata la guerre il fut des plus critiques envers Churchill, engagé à la BBC il ragera envers la propagande officielle qu’on y diffuse outremer, vers l’Inde, bref, George Orwell, qui, de santé cassable, avait, la gloire venue, interdit par testament que quiconque écrive sa biographie, semblait ne vouloir rien savoir de personne.
Sur sa tombe, basta son célèbre pseudonyme, il ne fit écrire que son vrai nom de naissance, Eric Arthur Blair, né en 1903, mort en 1950. Le gars, austère de nature, colérique à ses heures, ne blairait personne, si je puis dire. Bref, l’auteur de La ferme des animaux, le livre qui l’a fait connaître aux États-Unis et en Angleterre, avait une humeur de chien. Mais un chien de chasse dont les proies à viser, à atteindre, à mordre à pleines pages étaient toutes les méchancetés du monde : l’arrogance, l’autoritarisme, le mépris de classe, l’hypocrisie du colonialisme, le sort humiliant fait aux pauvres, la terreur idéologique, la dérive du pouvoir, et le danger de mort qui guettait la liberté des individus, ses semblables, ses frères.
On connaît les deux grands romans que cela a donné, Animal Farm en 1945 et, en 1949, Nineteen Eighty-Four, une fable animalière puis un roman d’anticipation planétaire, donc une moquerie puis un cauchemar, tous deux de grands pamphlets déguisés en romans qui ont établi Orwell au rang des grands écrivains politiques de son siècle, le vingtième, avec ses deux guerres mondiales et ses puissances de mort, une époque sans doute révolue aujourd’hui depuis la chute de l’Union soviétique mais, et c’est la force qu’a gardée le simple titre de 1984 car ce roman est devenu une bible de protection contre tout totalitarisme, toujours utile à brandir, toujours nécessaire à relire et que l’élection de Trump à la Maison-Blanche a ramené à la devanture des librairies en 2016.
Mais Orwell n’a pas qu’écrit ces deux chefs-d’œuvre, et l’entrée en Pléiade, soixante-dix ans après sa mort, est l’occasion pour les lecteurs intéressés par une littérature sociopolitique, à une littérature d’idées (écrire pour des idées — tel mourir pour des idées chez le bon Brassens, qui ajoutait mais de mort lente…), de lire plusieurs autres de ses ouvrages, moins célèbres mais tout autant vigoureux, tous nourris d’un idéalisme social, et l’occasion aussi de constater qu’Orwell est un digne descendant de Montaigne et de son ami La Boétie, reprenant chez le premier ce que l’essayiste du XVIe siècle qualifiait de « modelle commun et humain » en évoquant « la vertu politique seule capable de tenir tête aux barbaries », et en reprenant chez le cher ami la thèse comprise dans le Discours sur la servitude volontaire qui sert de point de comparaison pour lire La ferme des animaux, cette fort drôle parodie du communisme stalinien où Napoléon, le cochon en chef, a mené une révolution en chassant les hommes des pâturages pour les remplacer par ses semblables — mais pas tous égaux — camarades, les cochons intelligents et les chiens forts d’abord (la nomenklatura), puis les moutons, les poules et les canards, le chat errant et les chèvres bêlantes, puis les inévitables rats.
Comme Gorki pour son drame Les bas-fonds, comme Jack London l’avait fait avant lui, l’un des premiers grands livres méconnus d’Orwell est celui qu’il va écrire vers la fin des années 20, dans l’entre-deux-guerres, en décidant de tout quitter et d’aller vivre la misère des clochards, des indigents, dans deux grandes villes, Paris puis Londres. J’ai enfin pu lire Dans la dèche à Paris et à Londres dans le papier missel de La Pléiade. Cet ancien d’Eton, ce chroniqueur, cet homme de radio, choisit la rue et va à la rencontre de la misère. Réellement. Il a vendu ses habits, s’est trouvé des fringues usées, et durant plus d’un an il va survivre pour ensuite écrire ce monde d’en bas où il a crevé de faim, dormi avec les punaises des asiles de nuit, connu des amitiés et fait face à des dangers. Lecture costaude que ce livre-là.
Marchant, sentant, vivant sa misère, Orwell donne l’impression de se punir pour se dédouaner de sa condition sociale, pour avoir le droit par la suite de prendre la plume au nom des déclassés de la terre. L’homme s’use, mais sa plume n’en sera que plus vraie, sa littérature plus forte. Le grand critique George Steiner disait de la force d’écriture d’Orwell qu’elle était manuelle, qu’il saisissait les détails avec la poigne d’un charpentier. Philippe Jaworski, qui présente l’œuvre en Pléiade, décrit Orwell comme « un homme à tout faire » que le bricolage intéresse plus que la théorie, qui privilégie le récit d’expérience à l’analyse abstraite.
Le Canadien George Woodcock, qui a connu Orwell dans les dix dernières années de sa vie, a publié un excellent essai sur l’écrivain anglais en 1986, un ouvrage qui reparaît aujourd’hui à Montréal sous le titre Orwell à sa guise, un titre qui dit tout de la vie et de l’œuvre de cet esprit libre qui décida de devenir écrivain à sa manière pour décrire le monde qui lui apparaissait à ses yeux, dans ses disparités, ses inégalités, ses aspérités et ses dangers. Woodcock dit d’Orwell que l’homme qu’il a croisé à Londres dans les années 40 était « un saint séculier de la guerre froide ». Il nous le décrit « austère, socialiste, amoureux de la nature et vieux jeu »…
Arthur Koestler, dans La quête de l’absolu, écrit : « Son intransigeante honnêteté intellectuelle était telle qu’elle le faisait paraître parfois presque inhumain. »
Robert Lévesque, Les Libraires, 15 février 2021
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte