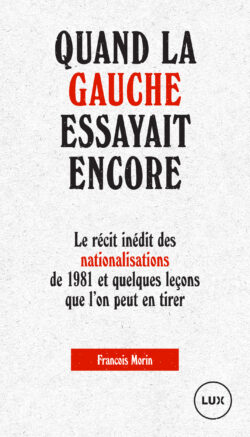Sous-total: $

François Morin: «Il ne sert à rien de nationaliser si c’est pour tomber dans les mêmes erreurs»
Pour l’économiste keynésien François Morin, conseiller du gouvernement lors des nationalisations de 1981, il vaut mieux mettre en place une démocratie économique radicale. Avec des rapports plus égalitaires entre salariés et actionnaires (ou l’Etat).
Revoilà un mot que l’on pensait enterré avec la gauche. Et qui vient paradoxalement du camp libéral : pour sauver les grandes entreprises de la crise, il faudrait les nationaliser… Mais seulement de façon temporaire, et sans contrepartie. Est-ce tout de même l’esquisse du début d’un possible changement des règles du jeu économique ? Rien n’est moins sûr aux yeux de François Morin, qui a participé à la préparation des lois de nationalisation de 1981. Dans son récent essai Quand la gauche essayait encore (Lux), l’économiste raconte les péripéties politiques qu’entraîna cette promesse de François Mitterrand sur la base du programme commun de la gauche élaboré dans la décennie précédente. L’expérience fut brève, balayée dès 1986 par une première vague de privatisations. Elle n’en reste pas moins riche d’enseignements pour aujourd’hui : face au néolibéralisme, il faut surtout changer les rapports sociaux dans la société et dans les entreprises.
Vous parlez des nationalisations comme d’une «question taboue». Quelque chose a-t-il changé avec la crise qui s’amorce ?
Le mot revient en effet dans le débat public, notamment pour sauver de grandes entreprises en perdition, ou les prémunir d’une prise de contrôle étrangère. Il s’agit donc de nationalisations temporaires, avec un retour ultérieur au secteur privé et sans aucun projet social. «Nationaliser» est donc toujours un gros mot, chargé d’idéologie. Depuis 1986, on compte une centaine de privatisations ou de baisses de participation de l’Etat, sous des gouvernements de droite comme de gauche. Inversement, il me semble que l’Etat n’est intervenu que dans deux augmentations de capital, l’une dans Alstom et l’autre dans les Chantiers de l’Atlantique.
Vous ne plaidez pas prioritairement pour des nationalisations comme en 1981. Pourquoi ?
Il ne sert à rien de nationaliser si c’est pour tomber dans les mêmes erreurs. Si on veut un projet vraiment émancipateur, il faut trouver des formules de démocratisation économique susceptibles de satisfaire à la fois les salariés et les actionnaires (ou l’Etat, dans le cas d’entreprises publiques). C’est la raison pour laquelle il faut mettre en place une démocratie économique assez radicale. Je plaide pour que les conseils d’administration et de surveillance, mais aussi les organes de direction, comme le comité exécutif ou le directoire, respectent la règle d’une codétermination à parité. C’est seulement à ces conditions que l’on peut changer substantiellement le lien de subordination dans l’entreprise, et donc les rapports sociaux. Cela peut se faire à travers des nationalisations, mais aussi par la loi, notamment pour les plus grandes entreprises. On peut penser à Air France, Accor, etc. mais aussi aux banques : avec ce système, je pense que la distribution du crédit ne se fera pas uniquement sur des critères de rentabilité classiques, et pourra donc contribuer à changer les règles du jeu économique.
Vous proposez également de créer des monnaies citoyennes. En quoi cela consiste-t-il ?
C’est une condition sine qua non pour changer de modèle. Pouvoir faire des avances, du crédit, est un acte fondamental. Pourquoi ce pouvoir est-il privé ? Pourquoi la distribution du crédit est-elle le fait du privé ou de Banques centrales indépendantes des Etats ? Cela a été l’innovation majeure du néolibéralisme. En 1981, l’une des forces du programme commun était de rendre aux Etats la souveraineté sur les émissions monétaires, et donc la distribution du crédit. Il faut reprendre cet objectif avec des monnaies citoyennes. On pourrait imaginer que des régions, des municipalités puissent battre monnaie. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, et cela ampute un certain dynamisme économique local. Mais l’euro peut aussi en devenir une. Pour cela, il faut donner au Parlement européen le pouvoir de mener sa propre politique monétaire, et donc de mettre fin à l’indépendance de la Banque centrale européenne vis-à-vis des Etats. Ces dernières semaines, sa présidente, Christine Lagarde, a annoncé qu’elle veillerait à ce que les taux d’intérêts des dettes à long terme ne soient pas trop importants. Elle va donc intervenir pour racheter davantage de dette italienne que de dette allemande. Au nom de quelle légitimité s’arroge-t-elle un tel pouvoir politique ? C’est inadmissible ! Une décision de cette nature devrait revenir à une instance démocratique.
Comment expliquez-vous l’échec des nationalisations de 1981 ? Quels enseignements peut-on en tirer pour prendre de bonnes décisions aujourd’hui ?
Dans les années 70, la montée du néolibéralisme s’était traduite par une montée en puissance des plus grands groupes industriels et financiers qui remettaient en cause le rôle de l’Etat. Cela avait sidéré la gauche, qui espérait poursuivre ce qui avait été commencé en 1936 et après-guerre : conférer à l’Etat et à ses représentants un rôle d’influence et de contrôle des principaux leviers de l’économie. On était dans une logique plutôt offensive, avec l’idée fondamentale que l’Etat ne devait pas se laisser submerger par l’importance des capitaux privés. Ainsi, en 1981, l’idée était de nationaliser dans le but de démocratiser, d’où la mise en place de conseils d’administration tripartites où se retrouvaient Etat, salariés et personnalités qualifiées. Mais on a assisté à une étatisation plus qu’à un réel changement des rapports sociaux. Il est évident qu’aujourd’hui, il n’est pas question d’aller dans cette direction.
Il y avait aussi le clivage politique de la gauche au gouvernement.
Les contradictions entre une ligne radicale et une autre réformiste sont très vite apparues au sein du gouvernement avec la préparation du projet de loi. La première souhaitait nationaliser à 100 %, pour changer les rapports de production. La seconde considérait qu’un contrôle majoritaire de l’entreprise suffisait, et qu’il fallait tenir compte du contexte de mondialisation. Finalement, les deux lignes politiques ont été successivement défaites. Ce fut le cas pour les radicaux avec les privatisations de 1986. Quant aux sociaux-démocrates, ils n’ont plus vraiment le vent en poupe aujourd’hui. Alors que le néolibéralisme a considérablement gagné en puissance, nous sommes à nouveau à la croisée des chemins entre ces logiques politiques. Ce que l’on va affronter dans les prochains mois, c’est le danger de relancer l’économie sur des bases pratiquement équivalentes, avec quelques adaptations nécessaires, comme des investissements dans le secteur sanitaire ou des nationalisations temporaires. Mais il y a des attentes fortes pour changer vraiment de modèle, comme l’a montré le mouvement des gilets jaunes. Il s’agit notamment de renforcer les circuits courts, les économies locales.
L’ennemi, c’est la finance ?
Le néolibéralisme a mis la finance mondialisée au poste de commande. Elle n’a cessé de s’affirmer par rapport à l’économie réelle. Mais, à chaque fois que son influence a grandi, il y a eu une instabilité économique et financière croissante. Depuis les années 70, pas moins de quatre cycles financiers se sont achevés par des crises systémiques majeures : le krach obligataire de 1987, la crise des pays asiatiques de 1996-1997, puis celle de 2007-2008. La quatrième, c’est la nôtre. La question est de savoir si nous allons ensuite entamer un cinquième cycle, avec une financiarisation à outrance qui aura des effets mortifères et délétères sur l’économie réelle.
Thibaut Sardier, Libération, 5 mai 2020
Photo: A Matignon, le 23 février 1982, les nouveaux patrons d’entreprises nationalisées (dont une seule femme, Lisette Mayret, nommée à la banque Hervet) avec le Premier ministre de l’époque, Pierre Mauroy, et les ministres Jacques Delors (Economie), Pierre Dreyfus (Industrie) et Jean Le Garrec (Nationalisations). © Michel Clément / AFP
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte