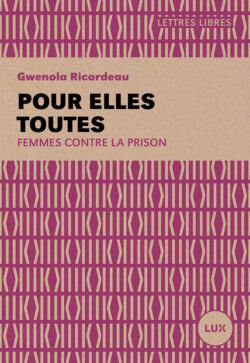Sous-total: $
Féminisme, justice pénale, coronavirus et révoltes dans les prisons
Entretien avec Gwenola Ricordeau
Dans le cadre de la série d’articles intitulée Coronavirus et confinement, les rédacteurs et rédactrices d’Harz-labour ont interviewé Gwenola Ricordeau à propos de son dernier ouvrage, Pour elles toutes : Femmes contre la prison. « Cet entretien fut l’occasion d’aborder plusieurs des sujets traités dans son livre, pour en faire un résumé à l’usage de ceux qui ne l’ont pas encore lu, mais aussi pour demander des précisions et tenter d’aller plus loin. Nous avons aussi, bien entendu, échangé à propos de la situation inédite dans laquelle nous sommes plongés, et des révoltes en cours dans les prisons. »
Bonjour, et merci d’avoir accepté cet entretien. D’abord, dans cette situation particulière, comment vas-tu ?
J’habite depuis deux ans et demi en Californie du nord, dans un comté rural. Le 19 mars, l’État de Californie a ordonné le confinement de la population, qui est moins strict qu’en France. Une semaine auparavant, l’université où j’enseigne était passée « en ligne ». Ça fait donc maintenant plus de trois semaines que je suis confinée. J’ai la chance de passer ce confinement dans de bonnes conditions matérielles, même si l’incertitude qui plane sur la possibilité de me rendre en France dans les mois à venir me pèse beaucoup. Bien sûr, j’ai beaucoup de sujets d’inquiétude, à commencer par mes proches, mes ami.e.s, mes étudiant.e.s… Alors, comme beaucoup de personnes qui ont la chance de pouvoir être confinées, mon temps est souvent aspiré par l’angoisse, le flux ininterrompu d’informations, la tristesse et la colère que celles-ci suscitent – tout cela entrecoupé de « trêves », quand mes activités professionnelles me procurent un sentiment de quasi normalité.
Si nous faisons tou.te.s face à un événement inédit à l’époque contemporaine, nos ressources pour y faire face sont inégales. Les États-Unis sont un pays particulièrement inégalitaire et la situation des personnes les plus vulnérables me préoccupe beaucoup : les travailleur.ses précaires, les personnes sans titre de séjour valide, les SDF (qui sont nombreux ici avec l’explosion des prix des logements dans la région de San Francisco), etc. – et puis bien sûr les prisonnier.e.s. À travers mes étudiant.e.s, qui pour beaucoup sont d’origine latino-américaine et/ou les premier.e.s de leur famille à suivre des études supérieures, je vois déjà la catastrophe sociale en cours : beaucoup ont déjà perdu leur emploi ou travaillent dans des conditions qui ne leur assurent pas une protection adéquate.
L’inégalité des ressources est frappante au niveau local : dans mon comté, nous avons eu, il y a seize mois, Camp Fire, l’incendie le plus dévastateur qu’ait connu la Californie. Plus de 20 000 personnes ont perdu leur logement et cette catastrophe a affecté beaucoup d’aspects de nos vies. Nous avons vécu des semaines avec des masques et l’incertitude persiste des conséquences pour notre santé d’avoir vécu aussi longtemps dans une fumée épaisse. Beaucoup de personnes vivent encore dans de l’habitat précaire. Mais je retiens aussi de cette catastrophe sociale les incroyables élans de solidarité et de multitudes de formes d’auto-organisation – et c’est une source d’espoir.
Pourrais-tu développer sur ces formes d’auto-organisation ?
L’ouragan Katrina en 2005 et le fait que les communautés africaines-américaines en Louisiane ont été affectées de manière disproportionnée, car laissées à l’écart des aides fédérales et étatiques, ont inspiré le Mutual Aid Disaster Relief. Ce mouvement éduque et fournit des ressources pour s’auto-organiser lors des catastrophes « naturelles ». Ce mouvement existait déjà localement, avec le North Valley Mutual Aid, lorsque le Camp Fire s’est produit. Aujourd’hui, aux États-Unis, il y a plein de groupes de ce type (une autre liste ici). Le collectif qui existe dans ma région organise des collectes/distribution de nourriture et d’autres produits essentiels (notamment pour les SDF qui se retrouvent dans des lieux d’hébergement, mais sans ressources), il propose aussi des interventions dans des contextes de violences domestiques – ce qui permet d’éviter le recours à la police. Autre exemple d’auto-organisation dans le contexte de l’épidémie : ce guide pour les prisonniers et leurs proches.
Ton livre Pour elles toutes. Femmes contre la prison est assez décapant, dans sa manière de traiter des diverses façons dont les femmes sont affectées par le système pénal et par la prison. On est surpris par la diversité des thèmes traités, à tel point qu’on a presque l’impression à la lecture qu’il y a plusieurs livres en un. Peux-tu nous dire ce qui a motivé ton choix de développer dans le même ouvrage la critique du féminisme dominant qui considère que la prison est la solution face aux violences sexistes et sexuelles, et la situation des femmes face à la prison (détenues ou épouses de détenus) plutôt que de le faire dans deux ouvrages différents ? Peut-être peux-tu nous parler du parcours qui t’a mené à l’élaboration de ce livre…
Chacune de ces questions (la critique du « féminisme carcéral » et ce que fait le système pénal aux femmes) mériterait un livre à part entière – et sans doute pas qu’un seul. Mais j’ai fait le choix de traiter toutes ces questions en un seul livre car je pense que si les courants dominants du féminisme privilégient autant l’outil du pénal, c’est parce qu’ils sont portés par des femmes qui ignorent, du fait de leur position sociale, les effets du système pénal sur une large partie de la population, en particulier les milieux populaires et les personnes issues de l’immigration et de l’histoire coloniale.
En fait, ce livre est le résultat d’un long parcours : ça fait vingt ans que je suis abolitionniste ! Il est le fruit d’années de discussions, de participation à des débats… Ce parcours militant s’est aussi nourri de ma carrière académique et de ma connaissance des débats et luttes abolitionnistes en Amérique du Nord. Comme j’aborde dans ce livre des sujets qui sont encore assez peu discutés en France, je le conçois comme une invitation au débat – et à l’écriture d’autres livres !
En tant que militante pour l’abolition du système pénal, tu critiques un certain féminisme qui, face à l’ampleur des violences sexistes et sexuelles et à l’impunité de la majorité de leurs auteurs, appelle à la création de nouvelles infractions, au durcissement des peines, à la suppression des délais de prescription, ou à une application plus ferme par les tribunaux des lois existantes. Tu reviens sur les trois arguments principaux qui cherchent à légitimer le système pénal, à savoir la dissuasion, la rétribution, et la réhabilitation. Peux-tu nous en dire plus, pour ceux et celles qui n’ont pas (encore) lu ton livre ?
L’abolitionnisme pénal part d’un constat : au regard de ses prétendues missions, le système pénal fonctionne assez mal. Il est censé prévenir la commission d’infraction (c’est sa fonction dissuasive), mais les tribunaux sont remplis de personnes sur lesquels la dissuasion n’a manifestement pas eu d’effet. Le système pénal est aussi censé permettre la réhabilitation des auteurs d’infraction – or la formule selon laquelle « la prison est l’école du crime » dit bien le peu de crédit qu’on accorde généralement à la prison en la matière. Par contre, le système pénal remplit bien sa fonction rétributive ou punitive – c’est-à-dire, l’idée que certaines infractions « méritent » d’être punies. Or l’abolitionnisme pénal soutient que les approches punitives des infractions fonctionnent mal – en plus d’être philosophiquement discutables.
Tu écris que la manière dont un certain nombre de mouvements féministes cèdent au populisme pénal en développant des revendications qui, si elles étaient satisfaites, impliqueraient l’incarcération de centaines de milliers d’hommes, tient essentiellement à leur caractère réformiste. Il ne nous semble pas évident d’expliquer ces revendications par le seul caractère réformiste et non révolutionnaire de ces mouvements. On peut aussi y voir un choix politique, sécuritaire et punitif, en phase avec l’air du temps … Car ne pas croire en la révolution et chercher à améliorer le système existant n’empêche pas en soi de préférer mettre en avant d’autres options que celles de la justice pénale pour faire face aux violences des hommes envers les femmes, qu’elles soient liées à l’éducation des garçons, à la possibilité ou à l’obligation de soins ou de participation à des groupes de parole pour les hommes qui ont commis des violences, à l’égalité économique et sociale pour que les femmes ne soient plus dépendantes des hommes, etc.
J’entends ta remarque… Peut-être que j’aurais dû écrire « petit-bourgeois » plutôt que « réformiste ». On revient en fait ici à la question de la composition sociale des organisations qui constituent les courants dominants du féminisme. Les femmes des classes populaires, celles issues de l’histoire de l’immigration et de la colonisation savent pertinemment, et souvent intimement, que le système pénal nuit aux pauvres et aux personnes racisées.
Les différentes paroles féministes qui s’expriment actuellement arrivent, pour un certain nombre, à faire tenir ensemble la dénonciation de la sur-représentation des précaires ainsi que des noirs et des arabes dans les condamnations judiciaires et à demander plus de répression pour les « violeurs » blancs, comme si le problème de la justice pénale était seulement son racisme ou son iniquité…
L’idée que la justice (ou la police) pourrait être juste, qu’on pourrait corriger son racisme ou son sexisme, est en effet fait assez répandue. C’est d’ailleurs ce qui explique que certains mouvements pensent pouvoir mettre le droit au service de l’avancement de leurs causes et se lancent dans des batailles légales. Contre l’idée d’un système pénal dont il faudrait corriger les « défauts », qui « fonctionnerait mal », les analyses abolitionnistes disent : le système pénal fonctionne très bien si on comprend qu’il fait intégralement partie du système capitaliste et qu’il est donc foncièrement un outil de répression – ou de « discipline » si on reprend les analyses de Foucault – des classes populaires et des minorités ethniques. C’est même l’illusion de la possibilité d’une police non raciste, d’une police qui n’abuserait pas de l’usage de la force, qui est aussi répandue, et elle est bien évidemment dénoncée par l’abolitionnisme pénal.
On peut plus largement observer dans le féminisme français un certain désir de police, étatique ou non. Par exemple, quand, plutôt que de chercher à développer une attention aux uns et aux autres et à se mettre en jeu par les rencontres, on tend à vouloir réguler à tout prix les comportements par des jeux de règlements intérieurs dans les lieux d’organisation, quand on met en place des services d’ordre visant à imposer les normes et les codes d’un petit milieu dans des safe spaces, où l’on distinguera les personnes « safes » de celles étiquetées comme « problématiques ». Cette volonté de recréer toujours plus de normes, et le fait que quelques personnes se chargent de les faire respecter de manière coercitive, n’est-elle pas directement inspirée par les fonctionnements policier et judiciaire, et/ou n’en n’est-elle pas une reproduction ?
Je sais qu’il est courant, dans les milieux libertaires, d’aspirer à moins de règles ou de normes. Mais il faut s’entendre… En tant que sociologue, je sais que tous les espaces et tous les groupes humains ont des normes et des manières de les faire respecter, parfois de manière subtile. Un bon exemple de cela est le rire, qui peut signaler un écart à une norme ou un jeu avec celle-ci. Une fois qu’on a dit cela, que penser des safe spaces ? Qu’ils sont censés répondre aux besoins de certains groupes d’un entre-soi et d’une gestion collective de certains types d’agression. Mais on sait que les safe spaces ne sont pas toujours « safe » et qu’ils peuvent être des lieux où les personnes subissent des formes graves de victimation car elles se croient justement protégées. On peut reprocher aux safe spaces d’être pensés comme justement des « espaces », alors que la sécurité est surtout une question d’interactions entre des « personnes » et des « ressources » de chacun.e. On peut aussi critiquer la tendance à qualifier certaines personnes de « safe » ou de « pas safe » : Louk Hulsman, qui a beaucoup contribué à l’abolitionnisme pénal à partir des années 1970, soutenait qu’on ne pouvait pas parler de « personnes problématiques », mais seulement de « situations problématiques ». Manière de souligner que nous sommes toujours parties prenantes de ces situations, en particulier si on considère des rapports de domination structurels comme le patriarcat ou le racisme. Mais on doit reconnaître que la mise en place de ces espaces safe et les discussions qui les entoure ont permis, dans certains milieux militants, de rendre visible des actes sexistes, racistes, homophobes, validistes, etc.
Quant aux pratiques coercitives que tu évoques, je ne sais pas bien. Car en une vingtaine d’années dans ces milieux, la pratique coercitive que j’ai le plus souvent vu employée est l’exclusion (d’un lieu ou d’une organisation). C’est une mesure qui peut être sévère pour un individu ayant peu d’autres espaces de sociabilités et qui généralement ne s’accompagne pas d’autres mesures. Ce qui n’est pas très satisfaisant puisqu’on ne s’assure pas que cet individu ne reproduira pas les mêmes comportements plus tard et ailleurs. Pour autant, je pense qu’il faut mener la critique de ces pratiques de manière constructive : force est de constater que l’énergie souvent dépensée contre ces pratiques est souvent sans commune mesure avec l’effort qui est fait pour proposer d’autres manières de faire, pour s’investir auprès des personnes ayant causé du tort, etc. En clair, j’ai souvent vu des hommes passer davantage de temps à insulter des femmes qui avaient exclu un agresseur sexuel et à les comparer à des policiers et à des matons qu’à proposer de se former à la justice transformative et à s’investir dans la prévention des violences sexuelles.
Et que penses-tu du fait que ces derniers temps, dans le cadre de la lutte contre les féminicides, de nombreuses organisations féministes ont revendiqué la mise en place d’un « bracelet anti rapprochement », en insistant sur le fait que nombre d’hommes tuant leur ex-conjointe avaient auparavant été l’objet d’une plainte, voire déjà condamnés ?
Les « bracelets anti-rapprochement » entraînent certainement une diminution des violences contre les femmes qui les portent. On observerait une diminution similaire si ces femmes étaient protégées en permanence d’un policier ou si leur agresseur était en prison. De la même manière si, à mon domicile, j’ai une porte blindée plutôt qu’une simple porte, que je ferme ma porte plutôt que de la laisser ouverte, je diminue le risque d’être cambriolée. Personnellement, je trouverai un peu déraisonnable, là où j’habite, de laisser ma porte ouverte. Pour autant, quand je ferme ma porte, je sais bien que je ne change rien aux inégalités sociales qui font que des gens pourraient vouloir me cambrioler. Je fais cette comparaison, certes un peu facile, car il est important de souligner que la question n’est pas ici celle des femmes qui bénéficient d’un « bracelet anti-rapprochement ». L’abolitionnisme ne consiste pas à dénigrer le besoin de sécurité des individus.
Mais la mise en place de « bracelets anti-rapprochement » soulève quelques questions. Quels sont les effets du recours à ce type de peine ? Il faut d’abord noter que les « bracelets anti-rapprochement » peuvent donner aux femmes qui le portent un faux sentiment de sécurité. Ensuite, on peut questionner de faire dépendre la sécurité des femmes de la technologie plutôt que de réponses sociales. D’ailleurs, les recherches sur les mesures de surveillance électronique (comme le placement sous « bracelet électronique ») sont très réservées sur les effets de celles-ci sur la récidive. Plus généralement, le développement des techniques de surveillance électronique, décrit notamment par Jackie Wang dans Le Capitalisme carcéral, parce qu’elles sont faciles à faire accepter socialement, contribue à une extension de la sphère pénale.
En prenant l’exemple des États-Unis, tu écris que le durcissement des lois réprimant les violences conjugales a même aggravé la situation de certaines femmes…
En effet, à partir des années 1980 et 1990, de plus en plus d’États ont mis en place des politiques d’arrestations systématiques des auteurs en cas de violences domestiques. Mais ces politiques se sont traduites par l’augmentation des poursuites à l’encontre de femmes dans des situations de violences conjugales dans lesquelles elles se défendaient ou défendaient leurs enfants. Ce sont en particulier les femmes des milieux populaires et les femmes racisées qui se sont retrouvées à être davantage criminalisées encore que par le passé. Par ailleurs, certaines femmes osent encore moins appeler la police car l’auteur des violences ou elles-mêmes sont en situation irrégulière ou engagées dans des activités illicites. Le durcissement des politiques pénales et migratoires leur fait courir des risques accrus ou elles craignent des effets disproportionnés de l’intervention de la police sur l’auteur des faits (par exemple son expulsion s’il est sans titre de séjour valide). Le travail de Beth Richie, et notamment son livre Arrested Justice : Black Women, Violence, and America’s Prison Nation, a été très important dans la dénonciation des effets sur les femmes noires de ces politiques censées protéger les femmes.
Face au constat de plus en plus largement partagé que les femmes ne bénéficient pas du durcissement des politiques pénales en matière de violences domestiques, il y a des appels a les décriminaliser, comme le recommande de Leigh Goodmark dans Decriminalizing Domestic Violence. Celle-ci soutient que la criminalisation des auteurs et la précarité sociale qui en résulte met davantage les femmes en danger qu’elle ne les protège.
Tu écris que « la figure du pédophile a servi de prétexte à de nombreuses innovations pénales en Occident, à commencer par le fichage d’un nombre croissant de personnes », fichage qui s’est ensuite étendu à une part de plus en plus importante de la population. Tu mentionnes aussi la création d’infractions liées non pas à des actes mais à la simple connexion sur des sites internet, qui a d’abord concerné les sites pédopornographiques, avant de s’étendre à tout un ensemble de sites dans le cadre de la lutte antiterroriste … En plus de pointer ce que la figure du pédophile a permis en termes d’innovations pénales, tu critiques aussi la panique morale, les réflexes punitifs, et le peu d’élaboration sur le sujet. À propos des fantasmes sexuels concernant des enfants (dont tu nous apprends que des études montrent qu’ils concerneraient jusqu’à 2,4% de la population adulte), tu notes que « beaucoup de personnes ayant des fantasmes pédophiles ne passent jamais à l’acte et ont même conscience de la nature problématique de ces fantasmes. La rareté des ressources offertes aux personnes qui souhaitent être aidées est en grande partie imputable au caractère punitif de l’approche de ce sujet qui a été choisie ». Tu notes cependant que « des évolutions positives sont à souligner dans certains pays européens ». Peux-tu nous renseigner sur ces évolutions positives, et donner des exemples d’accompagnement de ces personnes ?
Il y a eu, ces dernières années, quelques brèches, y compris dans l’espace public, pour faire entendre qu’il était important de proposer des ressources aux personnes ayant des attirances sexuelles pour les enfants et que toutes les personnes ayant ce type d’attirance ne commettent pas de violences sexuelles sur les enfants. Je pense aux documentaires I, Paedophile ou The Paedophile Next Door. Il existe plusieurs initiatives, comme Troubled Desire ou Virtuous Pedophiles, qui travaillent à aider les personnes ayant ce type d’attirance. En France, il existe cette plateforme et il y a un numéro vert qui a été mis en place.
Tu écris que l’abolitionnisme pénal refuse de réifier les catégories de « victimes » et d’« agresseurs ». Malheureusement, il nous semble qu’en pratique il n’y a pas toujours une adéquation entre l’opposition au système pénal et le refus des catégories qu’il produit. On peut, par exemple, régulièrement entendre des militants pourtant opposés en théorie au système pénal, reprendre une définition de l’agresseur issue de l’anthropologie négative qui légitime le recours à la punition comme dissuasion, celle d’un agresseur conscient de ses actes, souhaitant nuire volontairement et attendant le moment opportun pour cela, évaluant ses intérêts, calculant les risques et les bénéfices… On pourrait aussi parler de la popularité des discours sur les « pervers narcissique » jusque dans des milieux libertaires, pseudo-concept pourtant issu de la criminologie la plus réactionnaire…
La critique des catégories de « victimes » et d’« agresseurs » est un aspect important de l’abolitionnisme pénal, car ces catégories affectent nos manières de penser le tort commis, mais aussi la façon dont nous y répondons. Comme Louk Hulsman l’a abondamment rappelé, ces catégories reposent sur le préjugé de la responsabilité individuelle et elles assignent les individus à un acte qu’ils ont commis ou subi. Cette critique qu’on peut faire de ces catégories est d’ailleurs la raison pour laquelle, notamment dans le champ militant, le terme « survivante » est de plus en plus souvent préféré à celui de « victime » en matière de préjudices sexuels. Je pense néanmoins que les termes d’« auteurs », d’« agresseurs » ou « victimes » ont encore un intérêt dans des contextes de violences interpersonnelles, notamment commises dans l’intimité, afin de répondre au besoin de victimes que soient reconnues les violences qu’elles ont subies.
Abandonner les catégories pénales et les manières de penser qui y sont associées n’est pas une mince affaire. Il ne s’agit d’une simple question de vocabulaire. L’enjeu est celui de la mise en œuvre d’une responsabilité collective dans la prise en charge des violences et d’autres types de préjudices.
Le terme « survivante » ne vient-il pas à son tour recréer des catégories similaires en individualisant celle qui a vécu l’agression ? Évidemment que chaque agression est singulière, et qu’un préalable à toute réparation est déjà la reconnaissance des actes qui ont été commis, mais le terme n’est-il pas contradictoire avec l’idée d’une responsabilité collective ? Et est-ce qu’il ne vient pas réaffirmer l’idée d’irréparable ?
Même si je ne suis pas à l’aise personnellement avec ce terme de « survivante » en raison de certaines connotations que tu suggères, je pense que chacun.e se pense comme il/elle le souhaite et tant mieux si le terme de « survivante » donne à certaines du sens à ce qu’elles vivent et de la force pour l’affronter.
Tu écris aussi que la majorité des féministes sont indifférentes au sort des femmes détenues ou celles qui ont des proches incarcérés…
Oui, il y a aujourd’hui très peu d’expressions politiques d’une solidarité avec ces femmes de la part des mouvements féministes dominants, par exemple dans les revendications de celles-ci. La mobilisation du collectif Georgette Sand contre la précarité menstruelle en prison est un rare contre-exemple. Ce n’était pas le cas dans les années 1970 et 1980 où les discussions critiques sur la prison étaient fréquentes dans les mouvements féministes. Mais aujourd’hui les collectifs de femmes détenues et proches de détenus ont plus de soutien des mouvements « autour » des prisons que des mouvements féministes.
Ces dernières années, les principaux mouvements féministes ont eu, avec la mobilisation pour Jacqueline Sauvage, une occasion qu’ils n’ont pas saisie de s’intéresser aux femmes détenues. Le nombre des femmes criminalisées pour s’être défendues de violences masculines (comme Jacqueline Sauvage) est sans commune mesure avec celui des femmes détenues qui ont été victimes de violences masculines. Des femmes qui sont incarcérées non pas pour s’être défendues de violences, mais dont le parcours social et émotionnel est façonné par des violences subies. C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques les plus fréquentes des femmes incarcérées : avoir été victimes de violences masculines. Les femmes criminalisées dans des cas d’autodéfense méritent bien sûr toute notre solidarité, mais cette solidarité doit s’étendre à toutes les femmes détenues.
Dans le contexte actuel de l’épidémie, il est frappant qu’aucun mouvement féministe majeur ne semble se soucier des femmes qui sont incarcérées ou de celles qui ont des proches détenus et qui vivent aujourd’hui dans une angoisse sans nom. Dans les prisons – comme dans les centres de rétention –, la « distanciation sociale » est impossible à pratiquer et l’accès aux produits d’hygiène est souvent limité, voire interdit (par exemple les masques et le gel hydroalcoolique). La tribune publiée mi-mars en faveur de la libération de la chanteuse franco-malienne Rokia Traoré est l’une des rares mentions, dans l’espace médiatiques français, de l’épidémie comme une circonstance préoccupante pour les femmes incarcérées.
À propos des femmes incarcérées pour s’être défendues face à leur conjoint violent … En France, pour être reconnue comme telle, la légitime défense doit être nécessaire, simultanée et proportionnée à l’agression. Au moment de l’incarcération de Jacqueline Sauvage, condamnée pour avoir abattu son mari qui la violentait depuis des années, des organisations féministes appelaient à faire évoluer la loi sur la légitime défense. Valérie Royer, députée Les Républicains, avait déposé une proposition en ce sens. Il nous semble évident qu’un groupe dominé, ou des personnes sous emprise, doivent pouvoir se défendre sans risquer d’être inquiétées ou réprimées pour cela. Cela dit, au vu des discours publics à ce sujet, on sait qu’aux prochaines évolutions de la définition légale de la légitime défense, on risque de devoir faire face à des changements qui auront surtout pour but de protéger ceux qui tirent sur des voleurs, des délinquants ou des personnes perçues comme telles … Comment revendiquer une évolution de la définition légale de la légitime défense sans que cela ne soit instrumentalisé et qu’il ne s’agisse in fine de protéger la capacité du corps légitime de la nation à se défendre face à ceux qu’il perçoit comme une menace ?
La proposition de loi de la députée Valérie Boyer visait la reconnaissance du « syndrome de la femme battue » qui se serait accompagnée d’une atténuation de la responsabilité pénale des femmes poursuivies pour meurtre dans une situation de violences conjugales. Il me semble que les systèmes judiciaires les plus progressistes sont ceux qui, comme celui du Canada et, dans une moindre mesure, celui de la Suisse, reconnaissent la notion de « légitime défense différée », c’est-à-dire l’exercice de la légitime défense en dehors d’un danger immédiat. Cela permet de prendre en compte les circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les femmes qui subissent des violences dans le cadre familial ou intime.
Ceci étant dit, je suis très sceptique à l’égard des luttes sur le terrain du droit. Quand bien même le droit serait « juste », je doute que, dans une société foncièrement inégalitaire, on puisse avoir une application « juste » du droit. Je pense qu’il faut surtout œuvrer à ce que des femmes n’aient pas à recourir à l’autodéfense et à ce que leur liberté ne dépende pas du droit et de son application.
Au-delà du fait que des femmes sont incarcérées, même si leur nombre est plus faible que celui des hommes, la prison concerne aussi les femmes, car ce sont souvent elles qui soutiennent et prennent soin des hommes détenus, dans un monde où le fait de prendre soin des autres est souvent une injonction faite aux femmes plus qu’aux hommes … C’est le sujet du quatrième chapitre de ton livre. Comme tu l’écris, on observe parfois la même chose dans les milieux militants, lorsqu’un manifestant va être arrêté et incarcéré, ce sont souvent des femmes qui vont se coltiner la majorité des tâches de soutien … As-tu déjà observé la mise en place de processus permettant de mieux répartir cette charge ?
J’ai discuté avec de nombreuses militantes du problème de la division sexuelle des tâches liées à la solidarité matérielle et émotionnelle avec les prisonnier.e.s. Je sais aussi que ce problème est pris très au sérieux par certains collectifs. Par contre, je ne sais pas bien comment ils s’y attaquent. Il y a, à mon sens, un préalable à une meilleure répartition des tâches : le partage des savoirs pratiques qui permettent de soutenir, moralement et matériellement, les personnes incarcérées. Il existe des ressources, comme par exemple le Guide à l’usage des proches de personnes incarcérées (qui a été écrit par des proches) ou la brochure Comment survivre et résister dans les QHS qui explique comment soutenir les personnes placées à l’isolement – et plus généralement toutes celles qui sont incarcérées.
Le fait que, dans les milieux militants comme dans le reste de la société, la solidarité matérielle et émotionnelle avec les prisonnier.e.s soit davantage attendue des femmes que des hommes n’épuise pas toutes les critiques que l’on peut faire de la division sexuelle du travail politique dans les luttes abolitionnistes, anti-carcérales ou contre la police. Il est à mon sens important de réfléchir à la place qui est faite aux « proches » (de prisonniers, de victimes de crimes d’État) et qui sont souvent des femmes. Je me permets ici de renvoyer au texte que j’ai écrit, Pas de mouvement abolitionniste sans nous, dans lequel je critique à la fois l’assignation à la position de « témoin » souvent faite aux proches et les formes de fétichisation qui peuvent entourer les proches – ce qui révèle comment les proches ne sont pas toujours pensées comme des sujets politiques des luttes abolitionnistes.
La dernière partie de ton livre traite des manières de régler les conflits, d’obtenir protection et réparation, et de faire changer les auteurs de violences en dehors du système pénal. Tu parles notamment de la justice réparatrice, où l’exposition publique de la faute et la honte peuvent être « réintégratrices ». Peux-tu développer ? Puisque les formes de stigmatisation des déviances qu’on connaît dans notre société ont en général plutôt pour but d’exclure…
Tu fais là référence au concept d’« humiliation réintégratrice » (reintegrative shaming) qui a été développée par le criminologue australien John Braithwaite dans Crime, Shame and Reintegration en 1989 et qui a été une importante source d’inspiration pour la justice réparatrice et toutes les alternatives au pénal qui se sont développées depuis. John Braithwaite critique le système pénal qui procède à la stigmatisation et à l’exclusion des auteurs d’infraction. S’inspirant de cultures dans lesquelles le traitement des déviances ne repose pas sur l’exclusion des individus, il prône plutôt l’« humiliation réintégratrice », c’est-à-dire la dénonciation d’un acte, sa « condamnation », tout en maintenant (ou renforçant) les liens sociaux autour de son auteur. En fait, on a assez naturellement ce type d’approches avec les enfants et les parents peuvent très bien exprimer à la fois leur désapprobation et leur amour à leurs enfants lorsque ceux-ci se conduisent mal.
Tu mentionnes dans ton livre, et on a furtivement abordé le sujet tout à l’heure, dans des milieux militants, l’exclusion d’hommes accusés d’agressions. Tu qualifies cela d’insatisfaisant, dans la mesure où l’exclusion laisse inchangé celui qui est exclu. Tu ajoutes aussitôt que se borner à la critique de l’exclusion est au moins autant insatisfaisant, sinon plus, si l’on ne s’engage pas aux côtés de ces hommes dans des processus de justice transformative, qui visent à leur faire reconnaître leurs torts et à les faire changer. Nous menons des réflexions et des recherches sur ces sujets depuis quelque temps. Peux-tu nous citer des exemples de tels processus ?
Les processus de justice transformative ont été formalisées pour l’essentiel en Amérique du Nord (et en anglais) à partir des années 2010, en particulier avec l’ouvrage The Revolution Starts at Home qui regroupe les témoignages d’individus et de groupes engagés dans de tels processus. Plusieurs guides existent, comme celui de Creative Interventions. Les processus dépendent des faits et des personnes impliquées, notamment parce qu’un des principes fondateurs de la justice transformative est la « responsabilité communautaire ». Celle-ci implique l’engagement de l’entourage des personnes impliquées, mais aussi de leurs réseaux de sociabilité (de leurs « communautés »).
Elle peut se rapprocher des processus de justice restaurative : la recherche, collectivement, de la réparation du tort commis – un processus qui peut être long et laborieux. Elle prend souvent la forme de réunions qui, avec le temps, permettent à l’auteur de comprendre le tort qu’il a causé et de créer autour de lui un réseau qui l’accompagnera dans son évolution et dans le suivi de ses résolutions. Les personnes impliquées dans ce processus répondent aussi aux besoins de la victime, mais se mobilisent également pour changer les conditions qui ont rendu possible les faits. Par exemple, dans le cas des violences domestiques, il peut s’agir de lutter contre l’isolement de certaines femmes en créant des réseaux d’échanges et d’entraide. L’accompagnement des auteurs peut prendre des formes diverses : il part du principe que l’intégration dans un réseau social soucieux de prévenir des violences est plus efficace que l’exclusion sociale. Un exemple assez avancé de ce type d’engagement est celui des cercles de soutien et de responsabilité qui existent par exemple au Canada.
Est-ce qu’on sait si ça fonctionne à terme ? Est-ce que dans ces processus, on retrouve la division sexuelle du travail où ce sont essentiellement des femmes qui s’y impliquent ? Quelle est la place pour les hommes dans ces processus ? Quelle est celle laissée aux femmes qui ont subi les violences sexuelles dans le processus de réparation / restauration ? Quelle est l’échelle communautaire de ces processus ?
La question de l’efficacité de ces processus est l’objet de débats scientifiques. Certains travaux soutiennent qu’ils sont plus efficaces que les peines de prison, d’autres contestent leur efficacité, mais on a aussi beaucoup de travaux qui montrent que les peines de prison, en matière de violences sexuelles notamment, préviennent mal la récidive. D’un point de vue scientifique, ces travaux sont compliquées à mener pour un tas de raisons : d’abord, lorsqu’on parle de récidive ou de réitération, on parle de faits qui sont connus, donc l’évaluation de ce type de programme se heurte toujours à notre ignorance possible de faits ; ensuite, il peut y avoir un biais important : si les personnes qui bénéficient des programmes « alternatifs » sont celles qui avaient le moins de risques de récidiver (par exemple, car elles bénéficient de bonnes ressources sociales), on obtiendra automatiquement de meilleurs résultats pour ce genre de programmes. Reconnaître qu’on ne dispose pas de solides preuves scientifiques et qu’il est nécessaire d’avoir davantage de recherches en la matière ne me semble pas être un obstacle pour s’engager fermement dans cette voie. Puisque les coûts sociaux de l’existence de la prison sont énormes et prouvés depuis longtemps, nous devons chercher une autre voie. Nous ne sommes sans doute qu’au début d’un long apprentissage, d’expérimentations de manières non punitives de prévenir et traiter les préjudices sexuels.
Est-ce qu’on observe aujourd’hui une division sexuelle du travail dans ces procédures ? C’est effectivement un débat récurrent dans les groupes qui pratiquent la justice transformative : le nombre important de femmes, mais aussi de personnes LGBT, qui y sont impliquées.
Pour ce qui est de la place des victimes, quelles qu’elles soient, le principe est toujours que leurs besoins soient la priorité du groupe mis en place. C’est l’occasion pour moi de préciser quelque chose qui est parfois mal compris : le but de la justice transformative n’est pas que la victime pardonne à son agresseur. Comme beaucoup, je crois que le pardon, dans un processus de deuil ou de guérison, c’est d’abord un cadeau que l’on se fait à soi. Une procédure de justice transformative a surtout pour but de répondre aux besoins d’une victime, et, pour reprendre la typologie de Ruth Morris, ces besoins sont : 1) obtenir des réponses à ses questions, parfois triviales, sur les faits ; 2) voir son préjudice être reconnu ; 3) être en sécurité ; 4) obtenir réparation ; 5) pouvoir donner un sens à ce qu’elle a subi.
Quant à l’échelle à laquelle s’organisent ces procédures, ça dépend des situations. On peut mettre en place ce type d’approches dans une institution, par exemple une école, comme c’est le cas à Oakland. Certains groupes s’organisent localement pour répondre aux besoins de victimes – je pense a ce groupe de Berlin récemment dissout ; ce type d’organisation peut aussi venir répondre aux besoins d’une communauté en particulier, comme TGI Justice Project qui propose des processus de justice transformative pour les personnes trans. Enfin, il existe des coalitions plus larges, comme Generation5 qui lutte contre les violences faites aux enfants.
On aimerait finir en parlant de l’actualité particulière que nous vivons. Tu fais à deux endroits de ton livre le parallèle entre la prison et la maladie. La première fois pour observer que les femmes quittées par leur conjoint lors d’une incarcération sont bien plus nombreuses que les hommes quittés par leur conjointe en pareille situation, et que cette différence entre les réactions des hommes et des femmes vis-à-vis de leur partenaire s’observe dans les mêmes proportions lorsqu’une personne est atteinte d’un cancer. Le second endroit du livre où tu fais le parallèle est celui où tu parles des difficultés dans le lien avec son entourage que peut entretenir une personne détenue ou malade, avec des décalages de perceptions liées aux différences de conditions de vie, et des conversations devenant de plus en plus superficielles. Puisqu’on est dans une période où nous sommes nombreux à être repliés sur l’espace domestique, où la garde des enfants ne peut plus être déléguée, où les questions du risque, de la maladie et du soin sont posées … Peux-tu apporter des pistes de réflexion, sur la manière dont on peut lire la crise du coronavirus, et la période de confinement, en prenant en compte la question du genre ?
Mon évocation de la maladie n’est pas anecdotique. D’un point de vue sociologique, les « épreuves » (comme la maladie, le deuil, ou l’incarcération) ont beaucoup de points communs dans leurs effets, notamment sous l’angle du genre. Et puis, il y a une longue histoire de luttes communes des abolitionnistes et des personnes handicapées autour de l’institutionnalisation. Par exemple, les travaux de Liat Ben-Moshe et notamment le livre qu’elle a codirigé Disability Incarcerated, montrent l’importance de penser ensemble le système pénal et le validisme. C’est un aspect que je n’ai pas développé dans mon livre car j’ai assez peu de compétences sur le sujet, mais j’espère que davantage de travail politique sera fait en ce sens en France dans le futur.
Pour ce qui est du confinement et de l’analyse qu’on peut en faire sous l’angle du genre, je n’ai rien de très original à dire. Parmi tout ce que j’ai lu, je recommande particulièrement « Le virus et la famille » de Sophie Lewis et « Le coronavirus est un désastre pour le féminisme » d’Helen Lewis
et traduit par Expansive. On sait qu’il y a, avec le confinement, une augmentation des violences domestiques. On sait aussi que les inégalités dans la division sexuelle du travail domestique (prise en charge des enfants, soutien émotionnel aux proches, etc.) pèsent aujourd’hui beaucoup sur les femmes en couple hétérosexuel. La citation de Simone de Beauvoir (« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. ») s’avère d’une terrible actualité. En effet, les droits des femmes font les frais de la gestion sanitaire de l’épidémie : il a été rapporté que des policiers ont verbalisé des personnes sorties se procurer des tests de grossesse ou des protections hygiéniques, certains États des États-Unis ont autorisé la suspension des avortements et en France le droit à l’avortement doit encore être défendu dans une tribune… Mais il faut aussi se rappeler que les conditions sociales des femmes sont diverses et que toutes les femmes ne peuvent pas être confinées. À travers les témoignages de femmes des quartiers populaires que le collectif Femmes en lutte 93 diffuse actuellement, il rappelle bien que « les femmes, les migrant.e.s, les ouvrier.e.s et prolétaires, les quartiers populaires […] sont les sacrifié.e.s et sont en premières lignes de l’épidémie et des attaques sociales en cours. »
Il y a d’ailleurs ces derniers jours des mutineries dans plusieurs pays, dont la France. Face au risque, les détenus demandent le désengorgement des prisons, et le respect des mesures sanitaires. Sais-tu si des mutineries ont aussi eu lieu dans des prisons pour femmes ? On a cherché l’information, sans rien trouver…
Depuis le début de l’épidémie, je suis d’aussi près que possible ce qui se passe dans les prisons et les centres de rétention aux États-Unis, en France et ailleurs. Les textes et les vidéos de prisonniers, les témoignages de proches de personnes incarcérées, et même les reportages journalistiques sont nombreux. Mais, à ma connaissance, il n’y a pas eu de textes (individuels ou collectifs) de femmes détenues – à part cette interview de Stacey Dyer, une femme incarcérée en Californie – ou de mobilisations rapportées dans des prisons pour femmes – hormis une grève de la faim au Northwest Detention Center dans l’État de Washington. Cela ne veut pas dire que cela se passe « mieux » dans les prisons pour femmes que dans les prisons pour hommes. Qu’on n’entende pas parler de protestations menées par des femmes détenues ne veut pas dire qu’il n’en existe pas. On sait aussi que les mobilisations des femmes suscitent souvent moins d’intérêt que celles des hommes. Par ailleurs, l’histoire des femmes nous apprend que les modes de protestation des femmes sont souvent différents de ceux des hommes et c’est en particulier le cas en prison. Or les mutineries et les actions collectives violentes constituent souvent l’étalon de mesure des protestations dans les prisons – un étalon de mesure bien masculin, car les formes de résistance sont diverses, notamment dans les prisons pour femmes.
Alors, quelles sont les formes de révolte ou de résistance des femmes détenues ?
Pour répondre à cette question, il faut avoir à l’esprit que les hommes et les femmes ne sont pas traitées en prison exactement de la même manière, notamment en raison des préjugés qui entourent les femmes détenues. En particulier l’idée qu’elles seraient un peu moins responsables de leurs actes que les hommes, qu’elles auraient davantage besoin d’être aidées que punies. Cela se traduit par une normalisation plus importante dans les prisons pour femmes que dans les prisons pour hommes de l’usage de psychotropes et des rapports de maternage qui peuvent exister entre surveillantes et prisonnières, très éloignés des rapports entre surveillants et prisonniers. De plus, les femmes ont beaucoup moins de soutiens de leurs proches que les hommes, mais, pour beaucoup d’entre elles, leur principale préoccupation est de pouvoir maintenir leur lien avec leur(s) enfant(s) et d’en récupérer la garde à leur sortie. En raison de tout cela, les formes de résistance peuvent prendre, chez les femmes détenues, la forme d’automutilations, de suicides et de tentatives de suicide, de refus des plateaux-repas et de grève de la faim, etc. – des actes dont la portée contestataire est rarement reconnue. Mais les femmes partagent aussi avec les hommes tout un répertoire d’actions (lettres individuelles et collectives, pétitions, refus d’obéissance, etc.).
Merci beaucoup pour tes réponses, et ta disponibilité. Souhaites-tu ajouter une dernière chose ?
Oui, juste quelques mots à propos des défis posés aujourd’hui à l’abolitionnisme. Il est fort possible que l’abolition de la prison ne soit pas obtenue par les luttes anti-carcérales : en effet, de nombreuses techniques de surveillance électronique sont économiquement plus rentables que la prison. Il est donc important de ne pas réduire la cible de l’abolitionnisme pénal à la prison et de souligner que le projet abolitionniste est l’abolition de toutes les institutions pénales – donc aussi de la police.
Quelques mots encore sur la mise à l’épreuve des positions abolitionnistes par l’épidémie. Les appels à réduire le nombre de prisonniers ou à « vider les prisons » sont nombreux et beaucoup de pays (Iran, États-Unis, France, Canada, etc.) ont pris des mesures, souvent minimalistes, en ce sens. Il ne faudrait pas croire que les libérations de prisonnier.e.s sont des avancées abolitionnistes. Elles sont prises sur une base humanitaire et peut-être plus pour protéger l’ensemble de la population de foyers épidémiques que pourraient constituer les prisons que pour protéger les prisonnier.e.s. Par ailleurs, elles risquent de reproduire la distinction entre prisonnier.e.s « dangereux-ses » et « non-dangereux-ses », entre ceux et celles qui « méritent » d’être libérés et les autres. Enfin, les libérations de prisonnier.e.s s’accompagnent d’une extension des pratiques de l’isolement en prison et elles peuvent être une manière – et c’est notamment le cas dans certains États des États-Unis – pour les administrations de se dégager de leur obligation de soins envers des populations vulnérables. Même si, prises individuellement, ces libérations sont des victoires, d’un point de vue de l’avancée des idées abolitionnistes, les mesures de police qui sont prises constituent une régression majeure : à quoi bon libérer les prisonnier.e.s si nous faisons de notre société une vaste prison ?
Lundi matin, #238, 13 avril 2020.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte