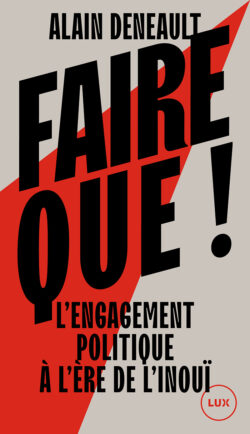Sous-total: $

«Faire que!», Alain Deneault veut changer le climat
Fonte des glaciers, multiplication des ouragans et des crues dévastatrices, canicules et incendies de forêt à répétition : les perturbations climatiques sont en cours. Une fenêtre ouverte sur ce qui peut-être nous attend demain : famines, guerres civiles, migrations, épidémies.
Partout, le climat est devenu hostile, imprévisible, en ébullition. Du jamais vu, des phénomènes inédits de mémoire de femmes et d’hommes, de l’inouï en cascade. Les politiciens détournent le regard, les scientifiques s’arrachent les cheveux face à l’inaction collective. Et nombreux, aujourd’hui, sont les citoyens que l’écoanxiété étouffe.
Que faire ? Faire que ! répond à sa manière le philosophe et essayiste Alain Deneault dans Faire que ! L’engagement politique à l’ère de l’inouï. Combattre la médiocratie, penser de manière collective, prendre la parole, essayer de faire quelque chose. Sortir de la sidération et transcender l’état de crise.
« Il s’agit tellement d’une question à la fois inévitable et grave que le mot “crise” est devenu faible, nous dit Alain Deneault en entrevue. On l’utilise pour toutes sortes de choses. Tout est en crise aujourd’hui. Mais le mot “crise” suppose qu’on puisse en sortir. » Or, nous dit l’essayiste, sans chercher à jouer les prophètes de malheur, il est peu probable que l’après nous réserve des lendemains qui chantent.
« À cela s’ajoute, poursuit-il, une perturbation grave par rapport à notre mode d’organisation, qui est le capitalisme, qu’on peut critiquer ou pas, mais il s’agit de voir qu’il est avantageux seulement pour une portion de l’humanité. » Une portion qui risque de se restreindre toujours davantage. Et une question qui concerne en particulier la classe moyenne occidentale, qui éprouve aujourd’hui face à elle une sorte d’angoisse. « C’est ce désarroi que j’ai voulu expliquer et que j’ai voulu penser. »
Convertir l’angoisse
Car nous sommes angoissés, plutôt qu’anxieux, souligne Alain Deneault, rappelant que l’angoisse est un affect sans objet. « L’une des conséquences de l’angoisse, lorsqu’on n’est pas psychanalyste dans l’âme, c’est de chercher des objets de substitution. Et le désarroi lié à l’enjeu écologique explique, je pense, l’appétence de l’Occident pour les idées d’extrême droite. Parce qu’elles offrent des boucs émissaires, des recettes, des mirages. Et ça peut être réconfortant un temps. »
Une recherche de « dérivatifs » qui n’épargne pas non plus les tenants de la gauche politique, observe l’auteur de Moeurs. De la gauche cannibale à la droite vandale (Lux, 2022), qui y constate « un surinvestissement d’objets sociologiques qui sont pertinents en eux-mêmes, mais qui, érigés en vérités et montés en épingle, deviennent délirants ». Ensemble, ces deux phénomènes lui semblent le symptôme d’un désarroi et d’un sentiment d’angoisse partagés collectivement.
À propos d’écologie, l’auteur de Noir Canada (Écosociété, 2008), de La médiocratie et de Bande de colons (Lux, 2015 et 2020) fait remarquer que nous sommes depuis quelques années en plein « règne de l’oxymore », citant le sociologue suisse Gilbert Rist, tous un peu engourdis par des expressions comme « développement durable » ou « capitalisme vert ».
Car, pour Alain Deneault, comme pour d’autres penseurs contemporains, le développement durable est un « problème travesti en solution ». Un leurre qui masque la réalité de l’urgence qui est aujourd’hui la nôtre.
Quand dire, c’est faire
« Il y a eu tout un premier temps, fait remarquer Alain Deneault, où j’ai travaillé sur des objets que je n’aimais pas : les paradis fiscaux, les multinationales, les régimes autocrates. Et ensuite, des concepts qui m’apparaissaient malheureux, comme la gouvernance, des phénomènes tristes, comme la médiocratie. »
« Face aux questions larmoyantes ou pathétiques que je recevais de façon récurrente, même si je voulais galvaniser, j’ai constaté que j’étais déprimant. À partir de là, j’ai décidé de travailler en fonction d’objets que je trouvais structurants, comme l’économie. Ça a été un chantier, que je poursuis à mon rythme. » La biorégion est un autre de ces chantiers, d’un point de vue moins théorique, qui animent l’essayiste. « L’idée maintenant est de travailler des objets qui nous tirent vers l’avant, qui nous sortent de la mouise. Qui sont roboratifs et structurants. »
Il y a 25 ans, se rappelle Alain Deneault, il était présent à Seattle lors des manifestations contre la conférence de l’Organisation mondiale du commerce. Ça a été en quelque sorte son baptême. Pour la lutte contre les paradis fiscaux, contre le libre-échange mondialisé, les banques et les paradis fiscaux. Contre la symbolique de l’enrichissement à tous crins. C’était nécessaire, estime-t-il, et ce l’a été pendant longtemps. « Mais là, la cour est pleine, on est saturés. Ce n’est pas une compagnie de plus, un exemple de plus, un scandale de plus qui vont faire bouger les choses. L’heure était venue de se demander : qu’est-ce qu’on fait ? »
Que faire ? Nombreux sont les penseurs qui se sont posé la question, hier et aujourd’hui, de Tchernychevski à Bruno Latour, en passant par Marx, Bernanos et, bien sûr, Lénine en 1902. Et se demander que faire, note l’essayiste, c’est déjà aussi penser ce qui vient.
Mais « la solution ne se présentera pas comme une offre dans la carte du restaurant électoral, mais elle s’imposera comme un souhait politique vital le jour où il deviendra impérieux de penser autrement la politique », soutient-il dans Faire que !, un essai qui a germé à la suite de la demande du documentariste français Yannick Kergoat (Les nouveaux chiens de garde, La (très) grande évasion), qui avait invité Alain Deneault à écrire son prochain film.
Christian Desmeules, Le Devoir, 21 octobre 2024.
Photo: Faustine Lefranc
 Mon compte
Mon compte