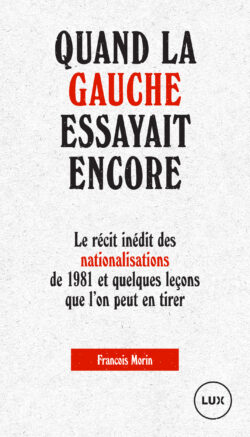Sous-total: $

Et si la gauche essayait à nouveau?
Bernard Marx a lu pour vous le dernier livre de l’économiste François Morin sur les nationalisations de 1981 et les leçons qu’il en tire pour maintenant. Les choses lues de Monsieur Marx, saison 2 épisode 14, c’est maintenant !
François Morin, professeur d’économie émérite à l’Université de Toulouse, a été en 1981-1982 membre du cabinet de Jean Le Garrec et secrétaire d’Etat chargé de l’extension du secteur public. Il publie aux éditions LUX Quand la gauche essayait encore. [1] Le livre instructif et stimulant est divisé en deux parties. D’abord le récit de la bataille des nationalisations, telle qu’elle s’est déroulée en 1981 au sein du gouvernement de Pierre Mauroy et entre les ministres concernés, puis un essai sur des enseignements que l’on peut en tirer pour aujourd’hui.
Il est assez impressionnant de penser que François Morin nous parle d’un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Ce qui fait quand même 60% de la population française. La différence est frappante avec les autres fois où « la gauche a essayé », en 1936 ou en 1945. Trente ans après, ces dates avaient été transmises comme des œuvres à poursuivre, comme des sources d’inspiration pour essayer à nouveau. Pas seulement pour le meilleur, il est vrai. Car, à situation différente, il aurait fallu s’ouvrir davantage à des idées nouvelles.
Mais, en tout cas, rien de tel avec les nationalisations de 1981 et les autres grandes réformes menées en même temps. [2] Partout la marche arrière a été plus ou moins vite enclenchée. Et plus rien de cela ou presque ne fait aujourd’hui référence.
Rupture ou petits pas
François Morin livre le récit « de l’intérieur » de la bataille des nationalisations. Selon sa grille de lecture, elle a opposé au sein même du gouvernement les tenants de la rupture et les tenants des petits pas. Le camp de la politique des petits pas (Jacques Delors, Michel Rocard, Robert Badinter, le ministre de l’industrie Pierre Dreyfus, appuyés par la technocratie du ministère de l’Économie) était plus puissant que celui de la rupture (le secrétaire d’État à l’extension du secteur public Jean Le Garrec, les quatre ministres communistes, Jean Pierre Chevènement de façon intermittente). Pierre Mauroy qui soutenait assez fortement le camp de la rupture et François Mitterrand rendaient les arbitrages. Mais rupture vers quoi ? Et petits pas vers où ? Face à la mondialisation qui s’affirmait alors dans le monde capitaliste, les partisans des petits pas, explique François Morin, prétendaient promouvoir un changement social « compatible avec l’économie de marché, sans rupture brutale avec elle, pour aller à la limite vers une économie sociale de marché à l’Allemande ». L’orientation politique de la rupture défendait au contraire « l’idée qu’un changement profond ne pouvait venir que par une transformation radicale de l’économie de marché qui impliquait une rupture de logique au sein du système économique. Cette ligne croyait qu’un changement majeur pouvait encore s’opérer à l’intérieur du pays sans tenir compte réellement de l’influence du contexte international. »
Le récit des batailles sur chaque point telles qu’elles se sont déroulées au sein de l’appareil gouvernemental apporte des informations précieuses. Le bilan semble avoir penché du côté du camp de la rupture qui s’est imposé sur « trois points considérés comme cruciaux : le seuil de nationalisation des banques […] l’appropriation à 100% des capitaux et le dossier des rétrocessions industrielles ». Le camp des petits pas ayant obtenu l’abandon de la nationalisation des assurances et des Compagnies des eaux et la non-nationalisation de fait de Dassault et de Matra. Mais au total, les lois de nationalisations ont intégré simultanément dans le secteur public les cinq premiers groupes industriels français (Compagnie générale d’électricité, Péchiney, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain et Thomson), c’est-à-dire des segments clés de l’appareil productif et l’essentiel du secteur financier (trente-neuf banques et deux compagnies financières).
Le programme de rupture avait semblé marqué des points. Cela fut éphémère et s’est vite transformé, à partir de 1983, en échec et en amertume puis en contre-réformes des privatisations par vagues successives de droite et de gauche. Le « tournant de la rigueur », est pris en 1983. Jacques Delors proclame l’autonomie de gestion des entreprises publiques, dont les directions en profitent pour revenir à une gestion classique. Les « contrats de plan » entre les entreprises et l’État sont vidés de l’essentiel de leur contenu puis oubliés. De leur côté, les nationalisations dans le secteur bancaire ne génèrent pas une nouvelle politique du crédit et de l’épargne qui aurait été possible compte tenu de la large maîtrise publique des banques. Au contraire, la réforme bancaire mise en œuvre à partir de 1984 aligne progressivement son fonctionnement sur celle de la finance anglo-saxonne. L’idée qui l’a emporté a finalement été que les nationalisations étaient un programme politique dépassé et que la seule voie possible était celle de l’adaptation au « nouveau monde » du capitalisme mondialisé et financiarisé.
Des tentatives novatrices refoulées
Dans son récit, François Morin n’évoque pas les tentatives des économistes communistes et de certains courants de la CGT pour une conception renouvelée des nationalisations et plus généralement de la politique économique de la gauche. [3] Une stratégie politique originale fut esquissée par le Section économique du PCF à partir des années 1970, reposant sur l’idée d’une « démocratie poussée jusqu’au bout », notamment dans l’entreprise. Elle prétendait « utiliser les armes des nationalisations pour introduire une nouvelle logique économique dans une économie capitaliste mixte mais évolutive, utiliser la nouvelle révolution technologique pour économiser massivement le capital matériel et financier, grâce à de nouveaux critères de gestion ». [4]
« Nous avons cherché, a expliqué l’économiste Paul Boccara à l’initiative de ces tentatives, à déborder les visions traditionnelles, notamment dans la CGT, le PCF, ou la gauche du PS insistant sur les propositions industrielles et techniques. Nous demandions d’articuler les propositions sur le « produire français » ou sur la reconquête du marché intérieur, aux questions du financement, aux critères de gestion d’efficacité sociale, à l’avancée de coopérations internationales. » Ces idées novatrices ont été vite refoulées. « Leur déploiement, analyse Jean Lojkine, impliquait une prise de conscience politique dans le salariat qu’il était réellement possible d’intervenir concrètement dans la gestion des entreprises et de la cité pour contrer la logique libérale dominante ».
Cette expérience est une dimension importante de l’histoire des nationalisations de 1981 et des leçons qu’il faut en tirer pour ici et maintenant. Je regrette que François Morin l’ait laissée de côté. Ceci d’autant plus, qu’il soutient lui aussi que l’ambition d’une démocratie économique constituait bien le cœur du projet politique des nationalisations ; que cela vaut plus que jamais face aux enjeux essentiels de notre pays et de notre monde ; et qu’il faut d’urgence refaire vivre le projet politique d’une « démocratie économique radicale » sous des formes renouvelées.
Pour une « démocratie économique radicale »
Deux propositions principales devraient, selon François Morin, en constituer les piliers : « Un contrôle citoyen de la monnaie et du crédit, d’une part, et le partage du pouvoir dans les entreprises, d’autre part ».
Le projet de nationalisations bancaires reposait sur l’idée que le pouvoir de création monétaire devait relever de l’intérêt général. C’est, explique-t-il, encore plus vrai aujourd’hui alors que les choses se sont considérablement dégradées depuis le débat des années 1980 et que le pouvoir de créer de la monnaie et de faire crédit est entièrement dominé par les puissances financières privées. [5] En même temps, explique-t-il, bien qu’au fait de sa puissance, ce pouvoir est à bout de souffle : le temps long des activités humaines et celui plus long encore de notre planète ne sont pas compatibles avec les exigences de rentabilité à court terme qu’exigent les marchés et l’oligopole bancaire qui domine, en particulier sur les marchés des changes, les marchés obligataires et les produits financiers les plus spéculatifs. [6]
Il y a donc urgence à « refaire de la monnaie un bien public ». Une nationalisation-démocratisation du crédit est plus que jamais nécessaire : « L’émission de la monnaie doit revenir à des pouvoirs citoyens ». L’enjeu est le contrôle démocratique de la distribution du crédit, autrement dit la souveraineté économique, sans laquelle il n’y a pas de véritable démocratie. Tenant compte de l’expérience passée, l’idée centrale de cette nouvelle nationalisation-démocratisation est que des pouvoirs élus soient au cœur de la décision de crédit, et par là, de l’émission de monnaie nouvelle. « À chaque niveau, des assemblées élues doivent définir les critères d’attribution des prêts, la nature des attributaires et les montants allouées, non pas de façon individuelle, mais par grande catégorie d’activité ». Le but étant notamment de promouvoir le financement des investissements nouveaux nécessaires à la transition écologique et le retour des services publics. Cette nouvelle nationalisation-démocratisation du crédit ne saurait donc être seulement nationale. François Morin assume explicitement sa dimension européenne : les statuts de la BCE devraient être modifiés. « Dans l’urgence actuelle, écrit-il, il conviendrait que le Parlement européen se saisisse de ce pouvoir essentiel en faisant de la Banque centrale européenne un outil privilégié dans le financement d’investissements collectifs, notamment en faveur de la transition écologique. » Ce qui est tout à fait compatible avec la mission de préserver la valeur de la monnaie. Mais ce qui exige parallèlement l’existence d’un budget européen et la conjugaison démocratique du pouvoir budgétaire et du pouvoir monétaire. Quant aux grandes banques privatisées et devenues systémiques, on pourra les nationaliser pour pas cher en cas de crise financière, et sans attendre cette échéance très vraisemblable, il faudrait en modifier profondément la gouvernance au même titre que pour les grandes entreprises des autres secteurs.
Le repartage du pouvoir dans les entreprises est en effet le deuxième piler permettant d’instituer une démocratie économique. François Morin préconise une codétermination des décisions au sein des entreprises entre les actionnaires et les salariés. Il n’est pas le seul. D’autres, comme Thomas Piketty ou Michel Aglietta [7], la prônent. Et, comme on le sait, c’est une des institutions du capitalisme rhénan dont François Morin souligne les limites. Il s’agirait d’aller beaucoup plus loin. Une véritable parité serait instituée entre les actionnaires et les salariés. La codétermination devrait concerner les décisions de gestion aussi bien que les décisions stratégiques de l’entreprise. Elle devrait s’appliquer aux organes de délibérations qu’aux organes de directions. Aux entreprises privées comme aux entreprises publiques ou aux entreprises privées qui gèrent par délégations les services publics. Pour François Morin, « avec un tel système de parité dans la gouvernance, nul besoin de nationaliser des entreprises ou de renationaliser des entreprises qui gèrent les services publics ». La démocratie économique par la codétermination, selon François Morin, « ouvrirait la voie à un modèle progressiste des relations sociales dans l’activité productive face aux enjeux planétaires qui nous attendent ». Elle constituerait « une vraie révolution ». Cela mérite débat. Thomas Piketty pour sa part qui mise beaucoup sur la codétermination et ne préconise pas les nationalisations, n’enterre pas cependant l’enjeu de la propriété et mise sur la fiscalité pour le traiter. Et les enjeux soulevés par les économistes communistes il y a 40 ans, au moment des nationalisations, sont toujours incontournables pour prétendre « essayer à nouveau ». Pour l’emporter, cette fois-ci durablement, la démocratie économique doit se construire sur un vaste mouvement social d’intervention dans les gestions des entreprises et des cités, et pas seulement sur une démocratie d’élections de représentants dans les instances de gouvernance des entreprises ou de contrôle de la création monétaire. Et elle doit pouvoir s’appuyer sur des critères directement opposables à la rentabilité financière.
Notes
[1] François Morin : Quand la gauche essayait encore. Le récit inédit des nationalisations de 1981 et quelques leçons que l’on peut en tirer. Éditions Lux, sortie le 6 février 2020.
[2] La cinquième semaine de congés payés ; la retraite à 60 ans ; les lois Auroux sur le droit du travail ; le premier acte de la décentralisation ; la loi Savary sur le grand service public de l’éducation nationale ; la réforme Lepors du statut de la fonction publique intérieurs ; la loi d’Orientation sur les transports intérieurs (LOTI) qui donna naissance à une nouvelle SNCF ayant pour objet d’exploiter, d’aménager et de développer le réseau ferré national selon les principes du service public.
[3] Actes du colloque de la Fondation Gabriel Péri : Les politiques économiques de la gauche en France (1936-2002) (20-21 mai 2011). Éditions de la Fondation Gabriel Péri, juin 2012. L’intervention de Paul Boccara et celle de Philippe Herzog sont disponibles ici et là.
[4] Jean Lojkine : La construction du Programme Commun de la Gauche et le mouvement de Mai-1968.
[5] Voir un livre précédent de François Morin : L’hydre mondiale – l’oligopole bancaire. Les Belles lettres, 2015.
[6] Thomas Piketty : Capital et idéologie. Seuil, septembre 2019.
 Mon compte
Mon compte