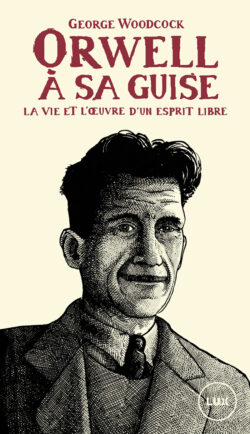Sous-total: $

Entrée d’Orwell dans La Pléiade: l’oeuvre d’un homme « presque génial »
L’entrée des écrits de George Orwell dans « la bibliothèque de La Pléiade » de Gallimard est une bonne occasion de se pencher à nouveau sur son œuvre.
Pour Orwell, seul le temps détermine qui est ou n’est pas un grand écrivain. L’entrée dans la prestigieuse « Pléiade » de Gallimard, 70 ans après sa mort, était peut-être la dernière preuve qu’il manquait aux plus sceptiques pour accepter l’Anglais dans la cour des grands. L’ouvrage dirigé par Philippe Jaworsk semble, par ailleurs, avoir décuplé l’intérêt porté pour George Orwell, au point qu’il fait l’objet de nouvelles traductions (L’empêchement de la littérature (voir encadré) ou 1984 en bande dessinée) et des plusieurs ouvrages sur lui sont réédités. L’occasion de se pencher à nouveau sur cet « homme presque génial », comme le qualifiait son principal biographe Bernard Crick.
Difficile d’analyser l’œuvre d’Orwell sans se pencher sur sa vie, comme le souligne George Woodcock, écrivain anarchiste canadien qui a été proche de lui dans les dernières années de sa vie. Dans Orwell à sa guise : la vie et l’œuvre d’un esprit libre (Lux), enfin traduit en français, le Canadien nous donne les clés afin de pouvoir comprendre les quatre facettes de l’Anglais : « Celle de l’homme tel [qu’il l’a] connu (…), celle de l’écrivain dont les œuvres majeures tournent autour d’un mythe singulier et tenace propre au XXe siècle, celle d’un homme aux idées contradictoires bien qu’étrangement cohérentes et celle du critique littéraire à l’esprit pénétrant dont le regard se portait sur lui-même comme sur autrui et qui, ce faisant, est devenu, de façon presque volontaire, un des prosateurs anglais les plus raffinés de tous les temps. » Woodcock n’a néanmoins pas souhaité écrire une biographie « parce qu’Orwell ne souhaitait pas qu’un pareil ouvrage voie le jour ».
Une volonté que n’a pas respecté Bernard Crick, dont l’indispensable livre vient d’être réédité par Flammarion. En choisissant « simplement [d’]écrire une vie, aussi directement et factuellement que possible », l’universitaire anglais a voulu rendre hommage à « l’écrivain politique britannique le plus subtil depuis Swift ». « Il était écrivain, un écrivain que tout intéressait, auteur de romans, d’ouvrages réalistes que je nommerai “reportages”, d’essais, de poèmes, et d’un nombre incalculable de critiques littéraires et d’articles de presse », décrit-il. Selon Woodcock, « s’il était un être d’exception (…), c’est parce qu’il tentait de mettre ses théories en action et de traduire ses actions en œuvre littéraire. Cette triade pensée-action-création a marqué toute sa vie d’écrivain (…) si bien qu’on peut difficilement imaginer un avenir où la critique littéraire envisagerait l’œuvre la vie d’Orwell séparément. »
Avant d’être une œuvre, Orwell c’est donc une vie. Né le 25 juin 1903, aux Indes, alors colonie anglaise, Eric Arthur Blair est le cadet d’une fratrie de trois enfants. Son père est fonctionnaire de l’administration des Indes chargé de la Régie de l’opium. Alors qu’il est âgé de huit ans, sa famille retourne s’installer en Angleterre. Il devient pensionnaire de l’une des meilleures et des plus chères preparatory school du pays, St. Cyprian, une expérience qu’il raconte dans un court récit en 1947 (Tels, tels étaient les joies). Bien qu’il y obtînt de bons résultats, il décrit cette expérience comme un « épouvantable cauchemar », qui fait naître en lui un sentiment de révolte et lui a fait découvrir le mépris de classe. Il est par la suite boursier au collège Eton, la plus réputée des public schools (école privée au Royaume-Uni). Il s’y passionne cependant pour la littérature et la poésie – être écrivain a toujours été son rêve – et pour la politique, même s’il admet par la suite que son engagement relevait plus de la posture.
Son engagement au service de l’Empire britannique en Birmanie – qui lui inspire Une histoire birmane (1937) –, quelques années plus tard, le dégoûte à jamais du colonialisme et de l’oppression. Par la suite, ses excursions dans les bas-fonds de la société auprès des vagabonds – qu’il raconte dans Dans la dèche à Paris et à Londres (1933) – et ses rencontres avec le prolétariat – dont il parle dans Le Quai de Wigan (1937) – le convertissent au socialisme et le transforment en avocat des « gens ordinaires ». Pour finir, la guerre d’Espagne – sujet de son Hommage à la Catalogne (1938) – lui prouve que le socialisme est bien une réalité et pas une utopie, mais surtout lui fait prendre conscience de l’horreur du totalitarisme. Des expériences qui forgent plus ses idées singulières que n’importe quelle lecture théorique. Un peu plus tard, en 1946, il écrira : « Tout ce que j’ai écrit de sérieux depuis 1936 a été écrit, directement ou indirectement, et jusque dans la moindre ligne, contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique » (Pourquoi j’écris).
Socialiste, démocrate, révolutionnaire, patriote et conservateur
Woodcock se souvient d’un homme qui « déplorait l’évanouissement d’un monde révolu qui, malgré tous ses défauts, lui semblait plus généreux et plus coloré que le présent. Il défendait des causes impopulaires avec passions et par principe. Souvent au mépris de la raison, il dénonçait tout phénomène contraire à sa conception du bien, de la justice ou de la morale, mais, comme le savaient beaucoup de gens avec qui il croisait le fer, il pouvait être un adversaire très chevaleresque, mû par un sens du fair-play qui l’amenait parfois à retirer publiquement ses propos s’il en venait à considérer ceux-ci comme injustifiés. » Un socialiste démocratique et révolutionnaire bien particulier. « Il serait difficile d’inscrire les positions d’Orwell dans un système éthique bien défini, et lui-même n’a certainement jamais tenté de le faire. (…) Il n’a jamais situé sa pensée dans un cadre théorique complexe. »
Pour le Canadien, Orwell est avant tout un moraliste, c’est-à-dire qu’il conçoit le socialisme comme « l’aspect social d’une position morale générale », ce qui fait qu’il est « plus proche d’anarchistes comme William Godwin et Pierre-Joseph Proudhon » que des marxistes. « Si les socialistes orthodoxes sont outrés par certains aspects de la vision du monde d’Orwell (…), explique l’écrivain, c’est parce que ceux-ci reposent sur la morale personnelle plutôt que sur un programme d’un parti. L’écrivain craint le progrès matériel, qui ramollit la morale, et rejette l’instruction excessive pour la même raison. À ses yeux, la famille est une institution qui régénère la morale. »
Certes, il n’est pas réactionnaire et a conscience, d’après Woodcock, que « la machine est là pour de bon, et on continuera à l’utiliser ». Il estime néanmoins que « le progrès technologique » nuit « au courage et à la robustesse » et que « toutes les activités humaines sont menacées par la machine. » Orwell écrit à ce propos dans Le Quai de Wigan qu’il craint que « la finalité ultime du progrès mécanique [soit] (…) d’aboutir à un monde entièrement automatisé – c’est-à-dire, peut-être, un monde peuplé d’automates » et « de réduire l’être humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un bocal. »
L’écrivain ne rejette cependant toute forme de progrès, mais, comme l’explique Woodcock, « un des principaux reproches qu’il adresse aux socialistes est d’avoir adhéré sans réfléchir à une conception du progrès qui rebute la plupart des gens sensibles. » Autre blasphème pour la plupart des socialistes, Orwell estimait que « le patriotisme est une vertu sous-estimée. L’internationalisme est une panacée surestimée », souligne Woodcock. C’est en raison de ces spécificités que certains auteurs, comme Simon Leys et Jean-Claude Michéa, l’ont qualifié amusés d’ »anarchiste conservateur » (ou anarchiste tory), boutade qu’il a utilisée jeune pour se décrire. La double réédition d’Orwell éducateur et Orwell, anarchiste tory chez Flammarion (collection « Climats ») de Michéa nous rappelle cela.
Orwell, anarchiste conservateur contre les intellectuels progressistes
« L’adoption déculpabilisée d’un certain degré de conservatisme critique définit désormais l’un des fondements indispensables de toute critique radicale de la modernité capitaliste et des formes de vie synthétique qu’elle prétend nous imposer. Tel était, en tout cas, le message d’Orwell. À nous de rendre à son idée d’un “anarchisme tory” la place philosophique qui lui revient dans les différents combats de la nouvelle Résistance », nous enseigne le philosophe montpelliérain dans ce qui constitue « sans doute le meilleur essai » sur l’écrivain avec Orwell ou L’horreur de la politique de Simon Leys, selon les mots du traducteur et éditeur Frédéric Joly. Michéa accompagne son Orwell, anarchiste tory d’une postface inédite de 144 pages intitulée « Orwell, la gauche et la double pensée ». Pour lui l’écrivain britannique permet de défendre un socialisme original en double rupture avec le marxisme-léninisme et ses dérives autoritaires, ainsi qu’avec la gauche libérale qui dans les années 1980, dans le sillage de Foucault, BHL, Glucksmann et les « nouveaux philosophes », a jeté la révolution dans l’eau du bain totalitaire.
Dans son texte Michéa insiste particulièrement sur les critiques qu’Orwell adressait à l’intelligentsia de gauche (ou progressiste). Le philosophe nous affaire qu’elles sont de deux ordres. D’un côté, « la figure de l’intellectuel traditionnel a peu à peu cédé la place à celle de l’idéologue (ou, si l’on préfère le langage de l’époque stalinienne à celle de “l’’intellectuel de type nouveau”) ; et, de l’autre, le fait que derrière la prétention historiquement inédite de ces nouveaux “idéologues” à définir de manière désormais “scientifique” la ligne juste de l’Organisation située en “avant-garde” du combat humain (…) se dissimule toujours (…) le désire d’utiliser les différents mouvements politiques issus du socialisme originel, comme un tremplin idéal pour satisfaire leur désir de “s’emparer à leur tour du fouet” (James Burnham and the Managerial Revolution 1946) et assouvir ainsi cette soif de pouvoir absolu qui (…) les définit, à l’image d’O’Brien dans 1984, au plus profond d’eux-mêmes. » Orwell, lui, écrit à Jack Common le 12 octobre 1938 : « Ce qui me dégoûte le plus chez les gens de gauche, particulièrement chez les intellectuels, c’est leur ignorance crasse de la façon dont les choses se passent dans la réalité. » Dans sa postface en forme de pamphlet, Michéa s’en prend à deux types d’intellectuels de gauche.
Le premier type est composé de ceux qu’il nomme « les idéologues ordinaires », « autrement dit (…) ceux qui ont consciemment choisi de se mettre au service d’une oligarchie en place – ou de tout autre lobby suffisamment rémunérateur et influent – tout en ne revendiquant pour eux-mêmes que les privilèges, somme toute assez classiques du courtisan ». Il y range des éditorialistes, philosophes médiatiques et « les “économistes” à gage qui se succèdent en boucle sur tous les écrans du Spectacle contemporain ». Pour Michéa, leur cynisme « leur interdit par définition toute probité intellectuelle ». Il note néanmoins que ces « idéologues ordinaires » demeurent immunisés « contre les formes les plus aiguës du délire idéologique ». Leur but n’est pas de « régenter la vie des autres dans ses moindres détails », contrairement aux idéologues du deuxième type.
D’après Michéa, cette nouvelle « avant-garde », composée de la gauche postmoderne-déconstructionniste (héritiers de Foucault, Derrida et Deleuze, dont les principaux traits de caractère sont un ultra-relativisme et une volonté de déconstruire toutes les normes), intersectionnelle ou indigéno-décoloniale, rêve d’« imposer à [ses] semblables la seule manière “politiquement correcte” de se nourrir d’éduquer ses enfants, d’accorder grammaticalement le féminin et le masculin ou dans des cercles privés » à coups de « pétitions, intimidations physiques et menaces de procès ». Moins présents sur les plateaux télévisés, ces idéologues sont surreprésentés dans « les universités dont l’État capitaliste leur a confié la garde », ils ont abandonné la « lutte des classes » et ne voient plus « le privilège de classe (…), dans le meilleur des cas, que comme un privilège parmi d’autres » Cela lui permet, selon le philosophe « d’assumer et de vivre son “privilège de classe”, pour la première fois dans l’histoire de la gauche, d’une façon entièrement déculpabilisée ». Enfin, derrière des idéaux en apparence se cacherait une passion « à dénoncer, exclure, surveiller, proscrire, punir, imposer et censurer ». Ainsi, trente ans après l’effondrement du bloc soviétique, relire Orwell pourrait permettre à la gauche de tirer enfin les leçons du totalitarisme et peut-être reconquérir des classes populaires en grande partie abandonnées à l’extrême droite ou l’abstention.
Orwell et la littérature
Si Orwell est surtout connu en France pour 1984 et La ferme des animaux, rares sont ses textes exclusivement dévolus à la liberté d’expression. La petite mais exigeante maison R&N nous livre un superbe essai qui vient combler ce vide : L’empêchement de la littérature.
La poésie peut se maintenir en terrain totalitaire ; sous la forme collective, elle peut même s’épanouir et devenir œuvre anonyme ou symbole du génie collectif, elle peut porter la voix d’un régime qui exalte l’individu esseulé et malléable ou la foule unie et disciplinée. L’écriture en prose, le roman comme fruit de la Renaissance européenne, est un art fragile qui disparaît en même temps que la liberté. La littérature a parfois prospéré sous des régimes despotiques, mais les despotismes du passé n’étaient pas totalitaires. Leur appareil répressif était inefficace, leurs classes dirigeantes corrompues ou apathiques et les doctrines religieuses embrassaient l’imperfection du genre humain. Le totalitarisme repose sur des doctrines irréfutables, ficelées et mouvantes, comme Orwell l’illustre avec le communisme complaisant avec le nazisme jusqu’en 1941. Pour être corrompu par le totalitarisme, il n’est pas nécessaire de vivre en terre totalitaire ; la simple prévalence de certaines idées peut propager un poison qui rend impossible l’observation et le traitement de certains sujets ; dans ce cas, l’écrivain casse son moteur et devient un tâcheron de la rédaction ou, dans le meilleur des cas, une précieuse ridicule.
* George Orwell, L’Empêchement de la littérature : Sur la liberté d’expression et de pensée, R&N, 56 p., 10 euros
* George Woodcock, Orwell à sa guise : La vie et l’œuvre d’un esprit libre, Lux, 424 p., 20 euros
* Bernard Crick, George Orwell, Flammarion, 720 p., 29 euros
* Jean-Claude Michéa, Orwell anarchiste tory, Flammarion, coll. « Climats », 336 p., 21 euros
* Jean-Claude Michéa, Orwell éducateur, Flammarion, coll. « Climats », 224 p., 17 euros
Marion Messina, Marianne, 27 novembre 2011
Photo: © PHOTOSHOT/MAXPPP
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte