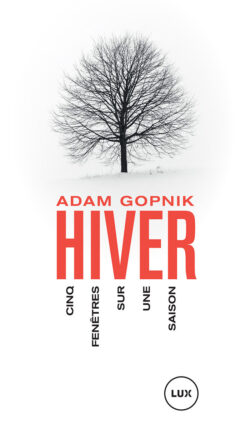Sous-total: $
Écologie de l’hiver
Chroniqueur pour The New Yorker depuis une trentaine d’années, Adam Gopnik est familier de l’assertion plaisamment érudite, au format court et enlevé. Si Hiver n’a pas été rédigé dans un cadre journalistique mais pour cinq conférences en 2010, l’auteur souligne en introduction les avoir « improvisées dans [s]on salon […] avec le soutien enthousiaste du vin et de la caféine ».
Cela renforce encore le style de la chronique dans cet essai auquel la présence de Gopnik — son savoir, son expérience, son sens de l’absurde et son ironie, en somme sa personne et sa personnalité – imprime une marque décisive. Résolument subjective dans son contenu, la démarche d’Adam Gopnik, qu’il appelle « adamique », désigne néanmoins un geste reconnaissable, à même d’être approprié. En traversant l’hiver comme un kaléidoscope miroitant des représentations poétiques, picturales, musicales, sportives, gastronomiques, architecturales, il donne à la saison un sens et court au secours de sa mémoire, mémoire dont l’hiver est lui-même un symbole alors que l’été se fait amnésie.
Ce faisant, Adam Gopnik accomplit une démarche écologique, et même ontologique. « Y a-t-il un bruit dans la forêt en l’absence de quelqu’un pour l’entendre ? Peut-être. Y a-t-il un été et un hiver sur Mars en l’absence de quelqu’un pour les nommer ? Je suis sûr que non ». C’est parce qu’il inspire l’humain que l’hiver existe, et, en le perdant, c’est une capacité à représenter le monde que l’on perd en même temps. La digression d’Hiver passe par plusieurs étapes, « cartographies affectives » et modernes du rapport que nous avons créé avec lui. Puisque c’est cet acte humaniste qu’il nous importe de restituer, on peut, par inclination, insister davantage sur l’apparition de la saison comme objet d’inspiration « romantique » puis « radical » de l’esprit moderne que sur ses derniers aspects — « spirituel » et « récréatif ».
Pendant longtemps, l’hiver a été synonyme d’abandon, de morne retrait et de période de désolation, moment où la déesse grecque Déméter, de chagrin, rend la terre stérile lorsque sa fille part pour les Enfers. Il faut attendre le romantisme pour qu’une attitude nouvelle, libérée du dénuement propre à la saison hivernale, advienne. Moment coïncidant avec un bouleversement en apparence trivial qui révoque pourtant de manière irrémédiable la crainte des frimas : l’invention du chauffage central. Nous avons tendance à assimiler ce changement à une notion philosophique que les historiens se plaisent à appeler « le pittoresque » : d’objet qui suscite la crainte ou inspire un réconfort religieux, la nature devient une source de plaisir, une réalité dont on peut simplement profiter, qui nous réjouit. « Je vous aime, aussi déplaisant puissiez-vous paraître ». Désormais, les poètes se divisent entre ceux qui pratiquent le confort de l’observation derrière une fenêtre givrée et ceux qui se jettent dans le blizzard, s’imprégnant de l’immensité immaculée comme d’un sentiment de sublime.

Greffé à un élan nationaliste dans les pays du nord de l’Europe, l’hiver devient un modèle alternatif aux Lumières. Le peintre allemand Caspar David Friedrich illustre cette idée avec Le chasseur dans la forêt, où la neige de la forêt nordique menace d’écraser un petit soldat français. Sous l’impulsion du mouvement romantique, l’hiver convoque une imagination grandiose : « Si, comme l’a dit Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres, le sommeil de la nature engendre… Eh bien, il engendre l’engendrement, un espace imaginaire dans lequel des banquises se changent en navires fantômes, des congères en cathédrales et le coucher du soleil en partage de la mer Rouge ». Peintres, compositeurs, écrivains et poètes se jettent dans le tourbillon de cette inspiration nouvelle. Entre Pouchkine, Goethe et Schubert, la plume cultivée et facétieuse d’Adam Gopnik rend hommage à l’œuvre de noms plus confidentiels, tels Anna Brownell Jameson, poète et féministe irlandaise immigrée au Canada en 1836. Russie, Canada, Japon… les pays de l’hémisphère Nord ont tous bientôt leurs chantres de la saison hivernale.
L’hiver romantique fait appel à deux images qui représentent la psyché humaine. La première est celle de l’iceberg, qui, sous l’impulsion de la psychanalyse, symbolise la lourde et sombre partie inconsciente immergée qui porte la pointe visible et lumineuse de la raison consciente. La seconde est celle du flocon de neige. Wilson Bentley, surnommé « Snowflake », photographe installé dans le Vermont, en a réalisé 5 321 photographies, à l’origine de cette « magnifique forme étoilée et symétrique, la fleur des neiges », qui orne aujourd’hui les cartes postales et les décorations de Noël. Qu’elle soit parfaitement harmonieuse ou accidentée, la forme des cristaux de neige symbolise l’individualité humaine, « parce que chacun, au niveau microscopique, est distinct, différent de tous ceux qui sont tombés avant lui ». À l’abri ou en danger, agréable ou effrayant, immense ou minuscule… l’art du romantisme a donné à l’hiver ses lettres de noblesse : « Les romantiques ont vu les flocons, ils ont embrassé les glaciers et, en transformant notre esprit, ils ont refait notre monde. Un horrible désert est devenu une nouvelle province de l’imagination ».
Après le romantisme hivernal, qui entérine la vision pleine d’une saison permise par un confort nouveau, vient l’embrassement physique et radical de l’hiver. Cette seconde étape achève d’installer notre perception moderne. Il s’agit, davantage que d’une période, d’un lieu à conquérir via un de ses pôles où règnent les neiges éternelles : « pôle prométhéen, pôle de Frankenstein, des pôles en tant qu’ultime mise à l’épreuve de l’hubris humaine ». Fictions de l’horreur et journaux intimes composent ces nouveaux récits de l’affrontement du froid, qu’on cite l’ouvrage de Mary Shelley ou l’Arthur Pym de Poe. L’envers de l’épopée magnifique se traduit dans la déconvenue et le ridicule. « À bord des navires polaires, on finit toujours par dénombrer cinquante Madame Bovary qui ne supportent plus l’aspect des oreilles de leur amant ». L’hiver souligne désormais une fuite en avant loin de la tranquillité et de l’indolence de la civilisation dans laquelle on la retrouve, paradoxalement, sous forme de piteuse caricature. The Idea of the North, documentaire sonore composé par Glenn Gould lors d’une expédition en Arctique, exprime que « le vrai son du Nord n’est pas celui de l’individu courageux – c’est au contraire celui de toutes ces histoires réunies, juxtaposées ». Le lieu hivernal imprime aux actions des hommes une dynamique à la fois courageuse, grandiose et comique, burlesque.
Les « fenêtres » suivantes de cette digression sur l’hiver rapprochent davantage la saison de notre environnement contemporain, selon des aspects favorisés par la sensibilité de son auteur. La troisième d’entre elles démystifie le rituel de Noël : « fête qui concilie non seulement de nombreuses célébrations païennes, mais aussi les deux principaux types de fêtes qu’on retrouve dans le monde : celles du renversement et celles du renouveau ». Moment qui à notre époque oscille entre capitalisme et charité dans une tension schizophrène. La quatrième s’attarde sur le mouvement des sports d’hiver. Adam Gopnik s’attarde sur le potentiel social de certains d’entre eux, comme le patinage artistique et la place centrale qu’il occupait hier dans les villes. Il ne cache pas la note préalable à cet avant-dernier chapitre : « Occasion rêvée de parler du hockey ! », faisant de ce sport une histoire culturelle et sociale.
L’auteur achève le fil de sa propre remémoration de l’hiver par une extension de celle-ci à la saison elle-même. Penser à l’hiver, c’est se souvenir : « L’hiver est notre moment de nostalgie, et la nostalgie n’est jamais que la langue vernaculaire de l’histoire, le démiotique de la mémoire, l’argot du temps ». Préserver cette saison menacée tient d’un acte mémoriel, d’un engagement qui conserverait le patrimoine de notre humanité en même temps qu’une partie de la nature.
Eugénie Bourlet, En attendant Nadeau, 17 décembre 2019.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte