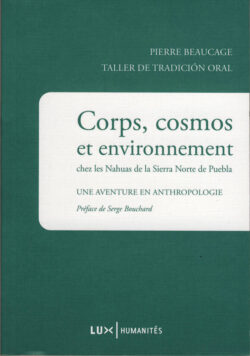Sous-total: $
Décolonisation, autonomie et autochtonie I
Dans la foulée de la création toute récente de la revue multidisciplinaire radicale Decolonization. Indigeneity, Education and Society (www.decolonization.org), je désire ici amorcer une réflexion en plusieurs volets sur la place de l’anthropologie et de d’autres choses aussi dans les cheminements de décolonisation qui tentent de se mettre en place au Québec.
Après cette grève et une infinité de réflexions libertaires sur le territoire, les ambitions économiques renouvelées du monde corporatif sur les espaces nordiques sont à questionner/dévisser de toutes parts.
On verra où tout cela nous mène. Dans la tombe moisie du Plan Nord, on l’espère.
Mais d’abord, qu’est-ce que cette chose que la décolonisation ? D’emblée, on comprend par l’ordre du mot que c’est un concept qui réfère à un processus visant à enlever la colonisation. Mais pour ça, il faut dans un premier temps analyser, reconnaître et comprendre la façon dont le colonialisme fonctionne dans l’oppression historique et présente des sociétés autochtones. Dans un deuxième temps, le retrait des colonialismes de toutes sortes est à faire dans toutes les directions : dans, par, avec, en alliance avec les sociétés autochtones, et dans un rapport au monde plus large.
La logique coloniale est celle-là même du capitalisme, qui s’est construit et continue de le faire par et dans le colonialisme : pillage de ressources, génocides, destructions, profits, conquêtes, guerres, armées, viols, saccages, temporalité immédiate, machisme, assassinats, ethnocides et destruction matérielle et symbolique de la diversité ethnoculturelle. Un rouleau compresseur de feu et d’acier fondu sur les forêts boréales et les renards.
À l’orée de la revue toute fraîche, il est écrit :
« Une chose est sûre : les effets désirés de la décolonisation sont divers, situés simultanément dans plusieurs lieux et s’incarnant dans plusieurs formes, et seront d’abord représentés ou reflétés par la réalisation de la souveraineté autochtone sur la terre et l’eau, mais également au niveau des idées et des épistémologies » (Sium et al., 2012 : 3).
Ce n’était qu’une amorce dans une réflexion sur la décolonisation. Cet article est plutôt un prétexte pour faire le compte-rendu d’un livre nommé Corps, cosmos et environnement, publié chez Lux en 2009.
Car ce livre est justement le fruit d’une collaboration et d’une co-construction de savoirs sur plusieurs décennies entre Pierre Beaucage (Université de Montréal), ses assistant.e.s et le Taller de Tradicion Oral, chez les Nahuas de la Sierre Norte de Puebla (Mexique). Le Taller est un organisme composé d’autochtones et de quelques non-autochtones mexicains qui est voué à la revitalisation de la culture locale nahua (langue, agriculture, cosmologie et légendes). Le livre nous donne justement accès à ce que Beaucage nomme « une manière toute particulière de conduire les rapports avec les humains et les êtres de la nature », en somme l’ « être-au-monde » des Nahuas, co-construit et distillé dans une écriture collaborative. Le processus de création de ce livre est donc aussi important que l’oeuvre elle-même.
Car dans cette lutte de décolonisation, comme le titre de la revue l’indique, éducation, savoirs et société sont indissociables.
L’ouvrage semble, à première vue, n’être qu’une monographie académique plate comme une autre dans l’étrange littérature anthropologique, hormis sa magnifique couverture minimaliste comme seule Lux peut les faire. Mais il en est tout autrement : la densité de Corps, cosmos et environnement est telle qu’on peut presque y voir une nouvelle forme d’écriture, et surtout, de pratique anthropologique.
Densité temporelle, d’abord, en raison des décennies de travail entre l’anthropologue et les Nahuas de la Sierre Norte de Puebla. Densité humaine, ensuite, car derrière la présentation des conceptions autochtones sur le corps, l’environnement et le cosmos, le lecteur trouvera des êtres de chair et d’os, des amitiés et de profonds liens d’humanité, mais aussi des relations aux non-humains, aux mystères de la forêt et de l’univers.
On est bien loin de Malinowski et de ses ethnographies colonialistes, alors que le chercheur ne s’investissait pas humainement, politiquement et scientifiquement dans le terrain, dans le projet d’une construction de l’autonomie et d’une résistance presque métaphysique des communautés autochtones en lutte contre leur propre destruction, parce qu’il travaillait dans et par une logique coloniale. Sans s’en être totalement distanciée dans les derniers temps, l’anthropologie parvient parfois à vraiment créer des relations d’égalité, comme en témoigne ce travail de Beaucage.
Devenir le sujet de son histoire
D’entrée de jeu, dans un exercice d’humilité qui vaut la peine d’être souligné, Beaucage nous informe sur son parcours d’anthropologue : à peine diplômé, il quitte le Québec pour des terrains éloignés tels que la Miskitia au Honduras, passionné qu’il était d’anthropologie économique et de luttes paysannes. Il travaille ensuite dans l’État de Puebla, au Mexique, où il prend conscience des difficultés historiques des paysans autochtones à s’organiser et à survivre. L’évolution des cours du café, les accords économiques néolibéraux et le racisme institutionnel ont eu et ont toujours des effets très importants dans le rapport des communautés autochtones avec la société mexicaine, tensions à travers lesquelles l’anthropologue doit se positionner. Beaucage arrive à San Miguel Tzinacanpan, Puebla, à un moment où les Nahuas « veulent devenir les sujets de leur propre histoire autant que de leur propre politique ». C’est donc dans une recherche participative, entre les Nahuas et l’ethnologue, que s’insère son anthropologie, très inspirée des recherches en ethnoscience (ethnobotanique et ethnogéographie, notamment).
Beaucage approche ici sa recherche en prenant comme matériaux de réflexion des éléments de linguistique et les catégories taxinomiques des autochtones eux-mêmes. Comment pourrait-il même en être autrement ? Nous apprenons, en suivant cette approche, l’existence et le nom des plantes, parties du corps, maladies, éléments géographiques, animaux et bêtes surnaturelles nahuas. Car les Nahuas, ici, ne sont pas l’objet d’une monographie, mais bien les sujets et les auteurs. Toute ethnographie devrait être ainsi faite…
Beaucage et le Taller orientent le lecteur tout au long de l’ouvrage dans une trame historique, qui est celle d’une histoire ethnographique populaire qui s’écrit en se faisant. Nous sommes amenés à connaître les conséquences du travail agricole latifundiste et de l’effondrement des cours du café sur la vie des gens, tout autant que pris à témoins du développement d’une agriculture intensive moins dépendante des cultures d’exportation. Suite au retrait relatif de l’État et à la crise du café des années 1990, les Nahuas ont progressivement développé la polyculture de substistance. Ils diversifient alors l’écosystème des caféières pour y planter des dizaines d’espèces médicinales ou alimentaires, fruits d’un savoir ancestral qui avait néanmoins été mis de côté au profit de la monoculture d’exportation, Révolution verte oblige. Le travail de classification du Taller et de Beaucage seront indissociables de cette réappropriation matérielle et symbolique du rapport à la production.
Réappropriation et autonomie
À travers cette trame historique, Beaucage et le Taller nous renseignent en profondeur sur les catégories taxinomiques nahuas, qui ont comme caractéristique de mélanger les identités conceptuelles. Exemple notoire de cette « autre » épistémologie : la langue nahua regroupe les végétaux à la fois en fonction de leurs traits morphologiques et de leur utilité. À ce sujet, Beaucage cite Bourdieu en faisant un parallèle entre la pensée nahua et son concept de logique pratique qui traduit « le sacrifice de la rigueur au profit de la simplicité et de la généralité ».
La cosmologie nahua obéit sensiblement au même principe et l’on y retrouve donc trois systèmes de classification simultanés : taxinomique, analogique et pratique. La nature et l’univers sont perçus du point de vue de l’homme, sans pour autant que ce dernier occupe une position centrale dans cette métaphysique. Le corps et le cosmos sont mis en analogie, en lien cosmique, traversés par les mêmes divisions fondamentales (essentiellement, le « froid » et le « chaud »). La médecine nahua cherche, dans cet espace, à « rétablir l’ordre menacé entre la personne et le cosmos ». Dans cette cosmologie autochtone, le monde est complexe et l’homme n’est pas le maître absolu, chose qu’il fait bon se souvenir.
Corps, cosmos et environnement s’inscrit dans le projet plus vaste d’une « récupération des connaissances autochtones [qui] soit le fait des organisations autochtones elles-mêmes et [qui] serve, de façon matérielle et symbolique, à la réappropriation de leurs conditions matérielles d’existence, dimension essentielle du processus actuel d’autonomie ». Ces projets d’autonomie ne peuvent être que renforcés par une telle œuvre, manifestement réalisée dans le respect et la fraternité, du moins c’est ce qu’on perçoit dans l’écriture. L’ethnologie, comme dit David Graeber, peut être un outil puissant de rencontre et d’apprentissage mutuel pour créer un monde libre d’exploitation, centré sur l’autonomie collective et l’auto-gestion.
D’où la nécessité de tels projets de co-construction de savoirs au Québec, surtout en anthropologie. Or, comment faire pour déconstruire le rapport colonial de l’anthropologie québécoise aux mondes autochtones ? Le parcours de Beaucage montre bien comment un académicien blanc du Nord peut arriver à mettre ses privilèges (capital symbolique, économique, culturel, matériel) au profit de luttes sociales inductives, bottom-up, dans une position d’allié des luttes sociales.
Et puis, Serge Bouchard le redit chaque jour, comment se fait-il qu’on ne connaisse pas le nom des plantes québécoises en abénaki ou en mohawk ? Pourquoi la marche des femmes innues a-t-elle été passée sous silence ?
Nous vivons tous et toutes sur Turtle Island, occupée depuis 500 ans par les forces de la mort et de l’asphalte.
Beaucage, P. et le Taller de Tradicion Oral. (2009). Corps, cosmos et environnement chez les Nahuas de la Sierra Norte de Puebla, Lux éditeur : Montréal.
Sium, A., C. Desai et E. Ritskes. (2012). « Towards the ‘tangible unknown’: Decolonization and the Indigenous future », Decolonization : Indigeneity, Education and Society, 1(1) : 1-13.
Julien Simard
Voir, 22 septembre 2012
Voir l’original ici.
 Mon compte
Mon compte