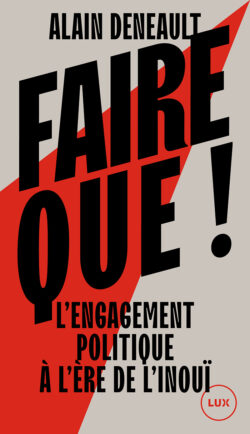Sous-total: $

Dans un climat hostile
À cheval entre la baie des Chaleurs et le golfe du Saint-Laurent, le campus de Shippagan de l’université de Moncton (Nouveau-Brunswick) jouxte l’océan. Ville portuaire de la péninsule acadienne, Shippagan s’affiche comme un lieu où il fait bon vivre : nature sans pareil, coût de la vie abordable, vie culturelle enrichissante, foultitude d’activités de loisirs, sentiers aménagés pour la marche et le vélo, plages à perte de vue [1]. C’est dans ce lieu paradisiaque qu’Alain Deneault, philosophe et universitaire québécois reconnu, dispense son savoir à des étudiants qu’on présume heureux de se former dans un tel environnement. Heureux malgré tout, car on ose les imaginer sensibles aux roboratives percussions philosophiques de leur professeur qui, après avoir attaqué les multinationales et paradis fiscaux, le colonialisme canadien, le management totalitaire, la médiocratie, les politiques de l’extrême centre, la « gauche cannibale » et la « droite vandale », remet le couvert avec cette puissante réflexion sur « l’engagement politique à l’ère de l’inouï » qui, disons-le tout net, mérite lecture, même sur les plages de Shippagan.
Car oui, Alain Deneault est un agitateur de concepts. Pour le cas, il s’est mis en tête de se pencher sur l’état du monde, notre monde, en cette basse époque, notre époque, où les catastrophes que génère en série et sans répit le capitalisme extractiviste, pourraient conduire, palier par palier mais sur un court temps historique, à un effondrement généralisé de nos milieux de vie, et plus largement du vivant. Les ravages que provoque ce mode de production sans limites sont tels, nous dit Deneault, que la sensation d’ « inouï » où ils nous plongent n’a d’égale que l’impensée qu’elle provoque. Car comment penser ce qui n’est comparable à rien et ne semble produire rien d’autre qu’une mal-nommée « éco-anxiété » – que l’auteur, partant de l’idée juste que l’anxiété procède toujours d’un sujet ou d’un objet, préfère appeler « éco-angoisse », qualification plus apte à dire le sentiment de vide face à l’impensable. Or, c’est bien ce vide que l’on sent monter dans une partie des consciences, un vide parfaitement en phase avec un contexte politique culturellement navrant qui favorise une montée en puissance de notions aussi délirantes que celle du « grand remplacement » portées par une extrême droite négationniste dont le principal atout est d’encourager la paresse en laissant penser qu’il suffirait de purger le monde de son extérieur, de son altérité, pour que tout aille mieux. Pensée aussi faible que triste, aussi stupide qu’odieuse, mais qui séduit bien des pauvres gens que la misère tenaille. Elle sert à cela l’extrême droite, et depuis longtemps, à faire contre-feu aux colères logiques en les orientant vers l’ignoble. C’est sa raison d’être, et c’est même pourquoi le capital s’en accommode si facilement quand nécessité fait loi. Pour continuer à piller la planète et à détruire le vivant sans qu’on l’emmerde, par exemple.
Si ce livre vaut le détour, c’est que, même si l’on se pense informé sur la question, l’ « hécatombe biodiversitaire » qu’il décrit d’entrée, complétée des incidences qu’elle aura (qu’elle a déjà), a de quoi nouer l’estomac. Qu’on ne se méprenne pas, cela dit. Deneault n’est pas du genre à cultiver le catastrophisme collapsologue, et encore moins les impasses où il mène. C’est que le bonhomme, pour conscient et érudit qu’il soit, a l’intelligence d’avoir compris qu’aucun combat pour l’écologie politique ne saurait prendre sur la base de la désespérance. D’où cette étrange sensation positive qu’on peut, par moments, ressentir à la lecture de ce catalogue de mauvaises nouvelles. C’est dû au fait que l’auteur a non seulement le sens des limites (de son lectorat), mais qu’il sait assez bien y faire pour désamorcer le catastrophisme quand il sent que ses effets pourraient être contreproductifs. Et puis il y a sa verve polémiste et cette manière, finalement assez british) – mille excuses au Québécois ! – de faire du nonsense d’un monde marchant vers l’abîme une machine à cibler un système capitaliste qui n’a jamais existé que pour 20 % de bénéficiaires très relatifs de la population mondiale, mais dont les effets ravageurs concernent la planète entière. Car comme l’accumulation coloniale ou néocoloniale ou le nuage de Tchernobyl, le capitalisme ignore les frontières et les limites qui, pour lui, ne sont que des entraves à sa dynamique expansive. D’où la nécessité où il se trouve de faire cause commune avec la « pulsion oxymorique », comme dit Deneault, de l’expertise scientifique new wave qui, depuis trois grosses décennies, emploie l’essentiel de son temps à inventer, comme autant de chimères sémantiques, des oxymores à la pelle : « développement durable », « capitalisme vert », « croissance verte », « économie circulaire », « Green New Deal ».
Dans Une société à refaire, Murray Bookchin, penseur libertaire de l’écologie sociale, pointait déjà la différence majeure qu’il existe entre un passé mû par « des croyances, des espoirs solides, des valeurs » et un présent ambigu, vide, béant, non intelligible – et par conséquent incapable de produire autre chose que des angoisses ou des oxymores. C’est sans doute le principal écueil auquel se heurte l’écologie politique. Son « incapacité, nous dit Deneault, à produire un “objet” pour la pensée publique », soit un rapport au réel, au monde, susceptible de structurer un imaginaire, un désir de se projeter dans l’impensable en le pensant. La « raison » fut l’objet, la manière d’objectiver, du XVIIIe, le socialisme celui du XIXe et pour partie du XXe. Le concept d’ « effondrement » ou de « catastrophe », eux, ne peuvent pas en être. Ils dépolitisent, ils n’articulent rien, sauf, dans l’anxiété, la dérive objective vers des « objets substitutifs » habilement manipulables. Par des médias notamment qui s’y entendent à merveille pour exploiter, attiser et orienter le désarroi psychopathologique de masse vers leurs propres paniques morales et les cibles qu’ils se choisissent comme autant de boucs émissaires d’un temps éreintant de bêtise : la femme voilée, le citoyen venu d’ailleurs, le militant des Soulèvements de la terre et tant d’autres.
Alors « que faire ? », se demande Deneault, reprenant la question politique par excellence qui, depuis Tchernychevski, en 1863, et surtout Lénine, en 1902, taraude toutes les avant-gardes auto-proclamées. Sur ce point, le léninisme a fait des émules un bon gros siècle durant avec les succès qu’on connaît. On rappellera, en passant, que Vladimir Oulianov sut bien que faire pour que la révolution verse très rapidement dans la terreur : éliminer, sous son règne et avec l’aval de Trotski, tous ses adversaires politiques (socialistes révolutionnaires, mencheviks et anarchistes). Les rappels historiques sont toujours utiles. Cela dit, cette référence au Que faire ? de Lénine n’est, pour Deneault, qu’une manière, plutôt habile d’ailleurs, de digresser, d’Apollinaire à Badiou, de Bernanos à Ellul et de Derrida à Latour, vers l’idée que cette question, « incorrigiblement léniniste », dit-il, est « contraire à la pensée » parce qu’elle suppose un penser déjà-là. D’où sa proposition : cesser de se demander « que faire » pour « faire que », quitte à « mal faire ». Cette mutation suppose, dans le cas qui nous intéresse – les bouleversements écologiques –, d’être d’abord convaincus que ni les États ni le Capital ne sont en situation d’y remédier et qu’aucune « programmatique serrée » émergeant de notre camp ne pourra nous servir, en elle-même et par elle-même, de boussole. Car le caractère « inouï » de ce que nous vivons nous oblige à nous réinventer, et par là-même à libérer nos imaginaires et nos révoltes de la gangue qui les bride pour en finir avec les médiations, cultiver nos spontanéités, accepter nos pluralités, éprouver nos amitiés et fertiliser nos communs et nos luttes, en sachant, comme le pointe justement Deneault, que « le caractère irrévérencieux et indompté de toute révolte est ce qui fait le plus scandale ».
Pourtant, la seule direction que pointe le philosophe en fin d’ouvrage – celle de la « biorégion », qu’il définit ainsi : « L’ensemble qui naîtra de la nécessité, dans un moment où il faudra réapprendre à s’organiser à une échelle sensible » – pourra paraître imprécise. À quel moment, cette « biorégion » ? Tout de suite, bientôt, après l’effondrement ? Ça reste vague. Ce qu’on sent, chez Deneault, c’est une influence notable du communalisme. Il ne s’en cache pas d’ailleurs. « L’élan qui porte le biorégionalisme provient, écrit-il, du municipalisme libertaire à la Murray Bookchin et de l’autonomisme politique de type sécessionniste », mais « sans s’y laisser réduire », ajoute-t-il, c’est-à-dire sans se priver d’explorer d’autres méthodes, d’arpenter d’autres sentes, de penser d’autres possibles, de s’adonner à d’autres expériences susceptibles de nourrir l’imaginaire de résistance et de reconstruction. Car Deneault se veut polyglotte en politique, c’est-à-dire toujours ouvert à l’hybridation.
Bien sûr, s’arrêtant à cette seule hypothèse du municipalisme biorégional, on sait par avance qu’il s’attirera les foudres ou le mépris des militants de la seule cause qui vaille : celle de la Théorie, de la Révolution, de l’Émancipation et autres concepts à majuscule. Là n’est évidemment pas notre intention. Ce qui caractérise cette basse époque, c’est à la fois un profond sentiment d’impuissance devant le réel accablant des ravages que produit le monde capitalisé et la conviction que, partout, déjà, prolifèrent des formes multiples de résistance portées par un même refus antiautoritaire du vieil avant-gardisme. C’est cela même qui nous fait penser que Deneault, qui se situe dans ce camp, ait cru devoir céder, par obligation propositionnelle et en s’y forçant un peu, à cette perspective du municipalisme biorégional qui agite déjà nombre de têtes alternatives et qui, de surcroît, opère déjà dans le vécu de nombre de résistances à la marche forcée destructrice du Marché conquérant et ravageur.
« L’anarchisme, écrit-il en presque conclusion d’ouvrage, ne saurait désigner quoi que ce soit d’autre que le clin d’œil d’une panne institutionnelle, le moment événementiel d’où sourd une organisation nouvelle. Un événement politique est l’art de défaire les liens convenus – temps d’anarchie – pour les recomposer. » C’est dans ce cadre que la biorégion, comme il l’entend, se présente comme une « forme d’organisation » que « le plus grand nombre devra imposer pour faire valoir des principes éminents et impérieux en ces temps de débâcle politique et idéologique. Dans un temps événementiel qui sera celui de la politique active ». Forme d’organisation donc, mais aussi « objet de désir » d’un après enfin désirable.
Cette part d’utopie réalisable que cultive Alain Deneault rend la lecture de ce livre nécessaire. Parce qu’il terrasse quelques idées reçues et autant de mensonges colportés. Parce qu’il ouvre des pistes argumentaires et méthodologiques pour penser ce monde en le transformant radicalement et parce que, un peu à la manière de Bernard Friot et de son « déjà-là » communiste, il sait faire lien entre l’hier, l’aujourd’hui et le demain dans une perspective toujours renouvelée d’émancipation et de solidarité humaines.
Freddy Gomez, À contretemps, 13 janvier 2025.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte