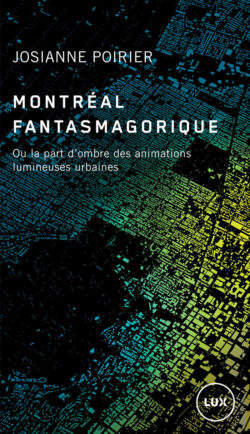Sous-total: $

Comme elle scintille!
Montréal fantasmagorique. Ou la part d’ombre des animations lumineuses urbaines
JOSIANNE POIRIER
Lux Éditeur, 2022, 200 p.
Finaliste – Prix Spirale Eva-Le-Grand
2021-2022
En 2017, on inaugurait l’installation lumineuse Connexions vivantes, qui, depuis, orne la structure du pont Jacques-Cartier. Fruit d’un financement public de 39,5 millions de dollars, cette chorégraphie scintillante de la firme Moment Factory entend faire d’un agencement d’ampoules de couleurs obéissant à un dispositif algorithmique le reflet de l’humeur des Montréalais·es. Or, si Connexions vivantes pouvait capter l’humeur du milieu artistique à son endroit, elle nous offrirait sans doute une chorégraphie plus sombre. La perspective souvent critique des artistes à l’égard de la fascination pour le design techno-lumineux pourrait passer pour une ombre jalouse : on a déjà souligné que les subventions accordées à la « culture numérique » nourrissaient davantage les firmes de design et les technicien·ne·s que les artistes. L’essai de Josianne Poirier traduit cependant en mots (et parfois en chiffres) un malaise à l’égard des politiques de mise en lumière des villes dont les causes sont bien plus complexes. Faudrait-il les trouver dans la tendance des décideur·euse·s politiques à diluer l’art dans le terme fourre-tout de « créativité » ? Dans le déplacement opéré par ces politiques dites « culturelles » – qu’on aurait pu croire destinées à soutenir l’art – vers des projets divertissants et photogéniques ? Dans leur tendance à instrumentaliser la culture à des fins économiques, sociosanitaires et politiquement anesthésiantes ? Dans un phénomène connexe de restriction des usages de la rue à un éventail policé d’activités, et à une frange choisie de la population ? Ou, comme le propose l’autrice de l’essai, dans tout cela à la fois ?
Historienne de l’art et commissaire, Poirier a abondamment travaillé sur les enjeux qui entourent les usages de l’espace public, notamment artistiques et culturels. Au sujet des animations lumineuses urbaines, elle n’emploie jamais les mots « art » ou « oeuvre ». Ces objets sont autres. Ils témoignent plutôt d’un envahissement de la sphère artistique par des opérations politiques et commerciales qui relèvent du branding municipal et de la « revitalisation » urbaine. En trois chapitres condensés mais efficaces, l’essai explore l’histoire des illuminations urbaines depuis le XVIIe siècle et celle des discours qui ont accompagné leur essor, l’imaginaire de la vitalité urbaine qu’elles activent aujourd’hui et leurs effets réels sur celle-ci, et la fonction de pacification (et d’« assainissement ») qu’elles assument. C’est à partir des politiques d’éclairage de la ville de Montréal que Poirier mène son analyse, en s’appuyant sur divers projets récents (2000-2020), en particulier : l’illumination du pont Jacques-Cartier réalisée par Moment Factory (Connexions vivantes, 2017) ; le parcours de projections Cité Mémoire (2016), signé Michel Lemieux et Victor Pilon ; et le Quartier des spectacles (Q.D.S.).
Et la lumière fut
Dans l’imaginaire occidental auquel s’intéresse Poirier, la lumière est chargée d’une valence positive au moins depuis l’Antiquité grecque (pensons à l’allégorie de la caverne de Platon). Comme le rappelle l’autrice, les premières paroles de Dieu, dans le Livre de la Genèse, donnent le ton sous la forme d’un « Fiat lux » : que la lumière soit. Néanmoins, Poirier ajoute que si la lumière peut éclairer, elle peut également nous aveugler. Dès les premiers développements de l’éclairage public, « les lumières urbaines oscillent entre une fonction répressive et une fonction festive ». Elles visent à la fois à célébrer (et notamment à célébrer la Nation et l’État) et à lutter contre le crime. S’appuyant sur une rhétorique qui veut que la lumière repousse la délinquance, la mise en place de système d’éclairage public est étroitement liée à l’essor de l’État policier. Il n’est pas anodin qu’en 1818, lorsque la Ville de Montréal embauche 24 hommes pour veiller à l’entretien et à l’allumage des premiers réverbères à l’huile, rue Saint-Paul, ces employés formeront la base du premier corps policier de la municipalité.
De ses balbutiements jusqu’à ses formes actuelles, l’éclairage public est également indissociable des développements du capitalisme et de sa logique productiviste et compétitive. L’autrice nous rappelle ainsi que l’éclairage au gaz, qui a permis d’intensifier la chasse à l’ombre dès la fin du XVIIIe siècle, fut d’abord implanté pour améliorer le rendement des manufactures d’une Angleterre en pleine industrialisation. Deux siècles plus tard, lorsqu’à travers le monde les administrations municipales de petite ou de grande taille s’emballent pour les vertus du design de lumière, c’est encore au nom de la vitalité économique. Dès lors, ce n’est plus seulement l’espace public qui se voit colonisé par l’armée des lumens, mais le champ toujours au bord de la sécheresse des politiques culturelles. Comme cela se produit souvent – les projets de mise en lumière ne sont malheureusement pas les seuls à user de cette pratique –, les politiques culturelles deviennent des stratégies de distinction et d’attraction par la culture, plutôt que de soutien à la culture. La « ville créative » de Charles Landry et Franco Bianchini1, puis de Richard Florida2, trace la voie à un idéal de revitalisation urbaine par la créativité numérique, grâce à des politiques dans lesquelles la « créativité » devient une carte de visite dont n’importe qui peut se prévaloir. Or, avertit Poirier, « [s]i l’on considère que la créativité n’est pas spécifiquement artistique ou culturelle et qu’elle se trouve dans toutes les sphères de la société et dans toutes les industries, le passage de la culture à la créativité dans l’élaboration des politiques culturelles […] signale un détournement possible de leur fonction initiale ». Un détournement que sert une certaine fétichisation de l’innovation technologique, laquelle fait parfois de l’élément de nouveauté le seul critère de pertinence.
Fantasmer la ville
Une des forces de l’essai réside dans la complémentarité des méthodes d’analyse employées. Les critiques de Poirier, à l’occasion acérées, mais toujours nuancées, sont en partie étayées par des statistiques (sur les déplacements de populations, la criminalisation des personnes en situation d’itinérance ou l’absence de logements sociaux dans les récents développements immobiliers du Q.D.S.), mais ce n’est pas sur elles qu’insiste l’autrice. C’est davantage aux discours qui sous-tendent les développements de la ville lumineuse que Poirier nous invite à réfléchir. En se basant sur une analyse critique de projets récents et emblématiques de Montréal, elle examine les apories et les obscurcissements à l’oeuvre dans leur rhétorique. S’agit-il bien, par ces animations, de travailler à l’élaboration d’une utopie urbanistique, ou s’agit-il simplement de maintenir des politiques aux effets excluants en mobilisant des images divertissantes, mais trompeuses ?
C’est sur le concept de fantasmagorie, tel que l’a pensé le philosophe allemand Walter Benjamin, que Poirier appuie sa réponse. La fantasmagorie, au sens où l’entend Benjamin, est l’état distrayant et déceptif dans lequel nous plongent les développements techniques du capitalisme depuis le XIXe siècle : vitrines animées, passages et autres éléments d’architecture en verre, mais aussi diorama, cinéma et photographie. Outre leurs effets individualisants, ces dispositifs architecturaux et technologiques – et leurs déclinaisons contemporaines – assument aussi une fonction de dissimulation. Il faut s’inquiéter, affirme Poirier, de la manière dont l’« apparence féérique » des animations lumineuses urbaines masque la réalité des problèmes sociaux. Les dissimulant, elle contribue aussi, indirectement, à les produire. C’est également l’« aplatissement » de l’histoire produit par ces interventions qui retient son attention. Tout à leur féérie, des projets de grande envergure comme Cité Mémoire (un parcours de projections vidéo célébrant l’histoire de Montréal) et Rallumons le Red Light (événement performatif soulignant la mise en lumière de l’édifice 2-22, dans le Q.D.S.) proposent une version épurée de l’histoire de la ville ou d’un quartier. Ainsi, Cité Mémoire renvoie le problème du racisme à la période de l’esclavage et oblitère la violence de la colonisation sous le récit coussiné de la Grande Paix de Montréal, tandis que Rallumons le Red Light récupère l’érotisme et la marginalité associés à l’histoire du Q.D.S., prétendant réanimer un travail du sexe que ses promoteurs ont voulu effacer sans y parvenir entièrement.
Privatiser l’espace public
Ce ne sont pas seulement les travailleur·euse·s du sexe qui n’ont plus droit de cité dans les aménagements tout en joie du Quartier des spectacles (les artistes qui avaient leur atelier dans ce secteur en ont d’ailleurs été massivement évincé·e·s quelques années avant la mise en chantier du Q.D.S.). La pauvreté en est également chassée, par les ressorts « naturels » de l’embourgeoisement et par une criminalisation de l’itinérance. L’autrice souligne l’absurdité d’un « imaginaire écosanitaire3 » qui, dans un renversement discursif, fait des personnes subissant les violences de l’embourgeoisement un obstacle à (et non les victimes de) la revitalisation du quartier. J’ajouterais que, dans un renversement peut-être plus absurde encore, elles deviennent la violence, et donc la raison pour laquelle il faut revitaliser le quartier. Un discours bien présent dans les toutes récentes discussions sur l’augmentation de l’itinérance visible dans le Quartier latin et dans le Village gai, à la frontière est du Q.D.S., phénomène qui, dit-on, ruinerait le commerce et le tourisme.
En poursuivant la réflexion de Poirier, j’ajoute qu’il existe une correspondance entre l’embourgeoisement du quartier ; la sécrétion active, par des objets lumineux, d’un imaginaire de jouissance homogène ; et la production d’une masse organisée qui se reconnaît dans cette homogénéité. Autrement dit, l’esthétique mobilisée par le Q.D.S. est pensée pour les membres des classes moyennes ou aisées qui, en tant que touristes ou résident·e·s, consomment les espaces du quartier et contribuent de cette manière à majorer leur prix au pied carré et à en évacuer celleux qui contredisent l’image d’harmonieuse cohérence dont iels s’abreuvent, laquelle devient ainsi de plus en plus réelle. Cette impression d’harmonie est encore renforcée par la privatisation de l’espace public qui accompagne souvent les politiques de revitalisation.
Foules sans agentivité
Dans la privation de l’espace public et la restriction de ses usages, ce ne sont pas seulement les possibilités esthétiques qui se trouvent accaparées par des projets de design clignotant, mais notre puissance collective d’agir. La dimension faiblement « interactive » de certains projets – l’activation physique des balançoires à bascules d’Impulsion (CS Design, 2015) ou la relation abstraite et algorithmique de Connexions vivantes – masque mal cette capture. La « connexion » demeure essentiellement pulsionnelle ou sensorielle, médiée par une technologie dont on ne comprend pas les codes, et l’utilisation de mots empruntés au lexique du vivant recouvre en fait une relation morte entre les habitant·e·s de la ville et cette dernière. Comme dans la fantasmagorie benjaminienne, il y a « confusion entre les outils de l’agir et la puissance d’agir ». On se rappellera les propos fameux de Benjamin au sujet de l’esthétisation de la politique : le fascisme, affirme-t-il, procède en détournant le pouvoir politique des masses vers des formes d’expression dans lesquelles les masses, fascinées, contemplent leur propre mouvement4. Nul besoin de vivre sous un régime fasciste pour constater une semblable réduction de l’agentivité populaire à des formes d’agitation joyeuse, reproduites sur grands écrans ou dans des rangées de lumières colorées.
Poirier conclut sa réflexion en s’élevant contre le défaitisme politique de ces pratiques. Une puissance d’agir persiste, signale-t-elle, et elle se manifeste dans des oeuvres délinquantes, à contre-courant des lisses animations lumineuses standards. On la retrouve dans L’ampleur de nos luttes (2019) de Jenny Cartwright et du collectif Le Sémaphore, une projection – pirate, semble-t-il – sur la façade du Monument-National, en hommage à des femmes qui, en 1969, ont défendu le droit de manifester. On la retrouve aussi dans l’oeuvre Sortir (2010) d’Aude Moreau, une intervention sur la tour de la Bourse pendant laquelle l’artiste utilisait l’éclairage des bureaux de l’édifice pour inscrire dans le ciel noir les lettres formant le mot « SORTIR » ; un projet pour lequel « rien de spécialement innovant n’[était] requis ».
Contre l’obsession du développement et la fétichisation des technologies numériques, c’est donc à une réflexion sur le droit à la ville que nous invite l’essai de Poirier. S’il s’attarde moins aux dynamiques politiques et économiques qui rendent possibles les récents développements de l’esthétique urbaine nocturne ou qui en tirent parti, il nous offre en revanche une perspective critique fort bienvenue sur les discours produits par les objets qu’ils génèrent (les animations lumineuses) et leurs répercussions sur les usages de l’espace public. En-deçà des fonctions signalétiques et commerciales que l’on attribue à ce dernier, il est bon de se rappeler, surtout en ces temps de crise du logement, qu’avant d’être un lieu qui scintille, la ville est d’abord un lieu que l’on habite.
- Charles Landry et Franco Bianchini, The Creative City, Londres, Demos, 1995.
- Richard Florida, The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York, Basic Books, 2002.
- Michel Parazelli et Charles Robitaille, «La rue radieuse : imaginaires collectifs et gestion de l’urbanité en marge«, dans Mario Bédard, Jean-Pierre Augustin et Richard Desnoilles (dir.), L’imaginaire géographique. Perspectives, pratiques et devenirs, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 292.
- Walter Benjamin, «L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique» (dernière version, 1939), dans Œuvres III, Paris, Gallimard, 2002, p. 269-316.
Edith Brunette, Spirale, no 285, hiver 2024.
 Mon compte
Mon compte