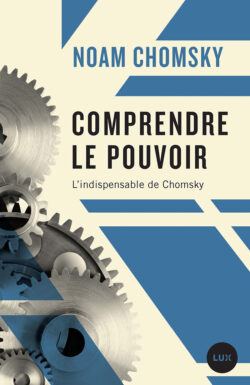Sous-total: $
Chomsky, les mots du pouvoir
Père de la linguistique moderne, inlassable activiste et pourfendeur du néolibéralisme, le penseur américain réunit trente ans d’écrits politiques et prises de position contre l’endoctrinement étatique.

On peut admettre que le déterminisme familial existe, peu ou prou, et que, parfois, il fait assez bien les choses. William (Zev) Chomsky, pour éviter d’être enrôlé dans les armées tsaristes, fuit la Russie en 1913 et émigre aux Etats-Unis. C’est un homme de culture et de science, un pédagogue, qui consacre ses recherches à l’hébraïsme et à la langue hébraïque médiévale. Elsie Simonofsky est née en 1903 à Bobruisk, près de Minsk, aujourd’hui capitale de la République de Biélorussie. Elle a juste 1 an lorsqu’elle arrive avec sa famille à New York. Elle est professeure au Gratz College de Melrose Park, Pennsylvanie, l’institution d’éducation juive la plus prestigieuse, dont, chargée de la formation des maîtres, elle est l’une des figures majeures.
Mariés, William et Elsie travaillent ensemble à l’école Mikveh Israel puis au Gratz College. William écrit beaucoup, publie de nombreux ouvrages, dont Hebrew, the Eternal Language (1957), et acquiert une telle notoriété intellectuelle qu’à sa mort, en 1977, le New York Times le salue comme «l’un des tout premiers grammairiens de l’hébreu du monde». Elsie préfère rester dans l’ombre, y compris celle de son mari : elle est plus austère que lui, mais beaucoup plus engagée dans l’activité militante et les luttes sociales.
Avram Noam Chomsky naît à Philadelphie le 7 décembre 1928. Les voies qui s’ouvrent devant lui sont déjà tracées : il sera linguiste, sous l’influence de son père, activiste politique sous celle de sa mère. Pas n’importe quel linguiste : l’un des pères de la linguistique moderne. Pas n’importe quel militant : l’homme de tous les combats, intellectuels, sociaux, éthiques, économiques, écologiques, qui inlassablement analyse les mécanismes par lesquels l’Etat et ses appareils idéologiques «persuadent» le peuple dans le sens qui leur sied et contournent le droit national et international. Comprendre le pouvoir est une sorte de somme dans laquelle Noam Chomsky a regroupé ses textes, interventions, conférences, discussions, interviews, séminaires, s’étendant sur près d’une trentaine d’années et couvrant un très large «éventail de sujets», du fonctionnement des organes de presse modernes jusqu’à la globalisation, les systèmes d’éducation, les crises environnementales, la fonction des complexes militaro-industriels, les stratégies militantes sur le terrain et dans le cyberespace, le marxisme, le fanatisme religieux, la question animale, le colonialisme culturel américain, les droits civils, la pauvreté, le charlatanisme intellectuel ou les théories du complot.
«Travail coopératif»
C’est en 1945 qu’il entre à l’université de Pennsylvanie, pour faire des études de philosophie et de mathématiques. Ce qu’il y vit ne le satisfait guère. Il retrouve dans l’enseignement universitaire le même académisme qu’il avait détesté dans le secondaire. Il est tenté de tout laisser tomber et de partir en Palestine, travailler dans un kibboutz. Avant que naisse l’Etat d’Israël (mai 1948), il n’était pas favorable à la division de la Palestine en un Etat juif et un Etat arabe, craignant que le partage des territoires n’ait pour conséquence de marginaliser, sur la base de la religion, la partie de la population la plus opprimée et la plus pauvre. Il estimait souhaitable d’unir les populations en vertu de principes socialistes, dont le «travail coopératif», et selon le modèle de société décrit par George Orwell dans Hommage à la Catalogne. Il restera toujours fidèle à cette idée, aux principes libertaires qui «animaient la Barcelone révolutionnaire de la fin des années 30». Cependant, à l’université, il rencontre d’une part Carol Doris Schatz, linguiste, pédagogue, spécialiste de l’acquisition du langage chez l’enfant, qui deviendra sa femme, et le professeur d’origine ukrainienne Zellig S. Harris, qui venait de créer le premier département de linguistique dans une université américaine : c’est lui qui le convainc de persévérer dans l’étude des langues. Ainsi il obtient son doctorat et commence en 1955 à enseigner au MIT, le célèbre Massachusetts Institute of Technology, où, onze ans plus tard, il obtient la chaire de linguistique et langues modernes.
On sait qu’en tant que théoricien, Chomsky, à partir des Structures syntaxiques publiées en 1957 (traduites en français en 1969), a élaboré une «grammaire générative transformationnelle» qui, par l’explication des lois régissant la production du langage, a bouleversé totalement la linguistique du XXe siècle – on parle de «révolution chomskyenne» – et par cet apport a fécondé la philosophie, la logique, les mathématiques, la psychologie, la neurobiologie, les théories de l’information, les sciences cognitives. On pourrait légitimement penser que c’est par le prestige acquis grâce à son travail sur les sciences du langage que son activité politique a été popularisée et qu’il est devenu, depuis la guerre du Vietnam jusqu’à «Occupy Wall Street», le héraut de la gauche radicale américaine et internationale.
Brouillage des faits
Comprendre le pouvoir fait apparaître une autre hypothèse : Chomsky a sans doute inventé une nouvelle figure de l’«intellectuel engagé» qui se distingue de celles qu’ont incarnées Sartre, Bertrand Russell, Pasolini, Foucault, Bourdieu ou Eric Hobsbawm : l’«intellectuel informateur», pourrait-on hasarder. D’un point de vue général, le Chomsky politique focalise sa critique sur le néolibéralisme, responsable des plus grands désastres sociaux, de la perte du «contrôle populaire des institutions de la société», de la soumission des Etats aux puissances financières, et de l’accroissement considérable de l’inégalité entre riches et pauvres. A la base de sa philosophie politique, il y a l’idée que tous les êtres humains sont animés par une commune aspiration à la liberté, à l’égalité, au respect, étouffée par un système de pouvoir séculaire qui emprunte les formes de production capitaliste non pour le bien de la communauté mais pour se reproduire lui-même et préserver sa domination.
Pour combattre ce système, le professeur émérite ne se contente pas de rester au niveau des principes philosophiques ou de la morale (indignation), mais amasse le maximum d’informations factuelles, économiques, techniques, militaires, culturelles, qui, synthétisées de façon rationnelle, mettent à nu la «grammaire» du pouvoir, et en révèlent les forfaitures. Dès lors, cela devient l’«affaire des gens» que d’«échapper à l’endoctrinement», que de vouloir ou non changer les choses, devenir promoteurs de leur propre histoire et gouverner leurs destins. «On ne peut pas commencer en disant : « Bon, on va renverser les multinationales. » Parce que là, tout de suite, c’est simplement hors de notre portée. Alors il faut commencer par se dire : « Bon, voilà où en est le monde, qu’est-ce qu’on peut faire pour commencer ? » Eh bien on peut commencer par des choses qui vont faire mieux comprendre aux gens ce qu’est la véritable source de pouvoir et ce qu’ils peuvent réaliser s’ils se lancent dans l’activisme politique. Une fois qu’on a démêlé le vrai du faux, on monte des organisations. On travaille aux choses qui en valent la peine. S’il s’agit de prendre en main votre communauté, faites-le. Si cela signifie gagner plus d’autonomie dans votre travail, faites-le. S’il s’agit d’organiser la solidarité, faites-le. S’il s’agit de s’occuper des sans-abri, faites-le.»
Etant donné la large période considérée, on trouvera dans Comprendre le pouvoir nombre d’analyses, sur la guerre du Vietnam, «les Etats-Unis et Pol Pot», le Watergate, la guerre froide, les accords d’Oslo ou «Ronald Reagan et le futur de la démocratie», qui peuvent sembler datées ou relever désormais du travail des historiens. De même, ce qu’on y lit à propos des institutions académiques ou de la fonction des universités, de la collusion entre les intellectuels, les hommes politiques et la presse pour masquer les stratégies de protection de leur pouvoir (afin de maintenir les «gens» hors jeu), apparaît un peu simple aujourd’hui, à l’heure de la «post-vérité» et des fake news. Certaines réflexions sont même irritantes, qui malignement intègrent aux procédures de brouillage des faits le prétendu «charlatanisme» de philosophies que Chomsky juge insuffisamment «scientifiques» ou indécidables : «Quand j’entends des mots comme « dialectique » ou « herméneutique » et toutes sortes de choses prétendument profondes, alors, comme Goering, « je sors mon revolver » […] Mais si, par exemple, je lis Russell ou la philosophie analytique, ou encore Wittgenstein, il me semble que je peux comprendre ce qu’ils disent et pourquoi cela me paraît faux, comme c’est souvent le cas. Par contre quand je lis Derrida, Lacan, Althusser ou l’un de ceux-là, je ne comprends pas. C’est comme si les mots défilaient sous mes yeux : je ne suis pas leurs argumentations, je ne vois pas d’arguments, tout ce qui ressemble à une description de faits me semble faux. Alors peut-être qu’il me manque un gène ou je ne sais quoi, c’est possible. Mais ce que je crois vraiment, c’est qu’il s’agit de charlatanisme.»
«Organiser la mobilisation»
Ce que le linguiste américain dit du contrôle social, en prenant acte de la progressive disparition des modes de «représentation» traditionnels, syndicaux ou politiques, semble au contraire d’une grande actualité. Il critique en effet le socialisme autoritaire, les types de gouvernements «éclairés» et les autres organisations constituées qui croient pouvoir dicter aux citoyens les modes de vie pour lesquels ils devraient opter et, de fait, les privent de toute initiative. Et se demande comment cette initiative pourrait être reprise collectivement, autrement dit comment «organiser la mobilisation» et coaguler les forces qui veulent non seulement comprendre les mécanismes de pouvoir mais les retourner pour qu’ils servent leur liberté au lieu de conforter leur aliénation. Mais comment faire, dans les pays où «les gens sont désillusionnés, effrayés, sceptiques, en colère» et «ne font plus confiance à rien, veulent quelque chose de mieux, savent que tout est pourri» ? Tout dépend, dit Noam Chomsky, de la «décision d’agir ou pas», d’une difficile décision, que toute son œuvre politique vise à «informer» et rendre possible. En ajoutant toujours : «Nous ne pouvons pas perdre espoir.» Parole d’un homme qui aura 89 ans à la fin de l’année.
, Libération, 10 mai 20017
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte