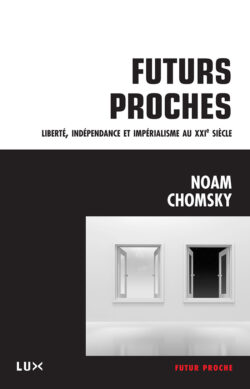Sous-total: $
Chomsky continue le combat
Depuis un demi-siècle, le linguiste et philosophe américain pourfend l’impérialisme occidental. Selon lui, l’arrivée au pouvoir de Barak Obama n’a fondamentalement rien changé…
Sa crinière poivre et sel sent le soufre. Et la poudre à canon… Noam Chomsky, « l’intellectuel contemporain le plus cité au monde », était à Bruxelles, mercredi et jeudi, à l’invitation de Bruxelles Laïque, des éditions Aden et EPO, du Comac et du Centre d’histoire des gauches de l’Université libre de Bruxelles.
Le Soir l’a rencontré avant la conférence qu’il donnait, jeudi soir, au Théâtre National. Jeans fatigué, pull à grosses cotes, baskets noires… A 82 ans, l’ancien professeur du Massachusetts Institute of Technology a la dégaine d’un « geek » et la force de conviction du militant des justes causes.
L’homme – anti-guerre, mais guère pacifiste –, est de tous les combats, depuis près d’un demi-siècle. Linguiste et philosophe, c’est sur le théâtre politique des opérations qu’il s’épanouit, ferraillant ferme contre « les élites » et « la pensée dominante ». Personnage controversé, socialiste libertaire, sympathisant des anarcho-syndicalistes, il oppose son rationalisme implacable, héritier des Lumières, aux détenteurs de pouvoir de tous ordres.
De la guerre du Vietnam à l’invasion du Bahreïn, rien n’échappe à ses dissections. Chomsky met à nu le pouvoir, quitte à attiser les flammes de la discorde.
Juif américain, il est plus souvent qu’à son tour accusé d’antisémitisme. Ses contradicteurs lui opposent ses prétendues sympathies avec le Hezbollah. Le vieux philosophe réplique qu’il n’y a rien d’antisémite à dénoncer la politique d’Israël, cette « base américaine offshore ». Dans le camp palestinien, certains ne lui ont toujours pas pardonné son appui à l’Initiative de Genève, en 2003.
En France, il a laissé le souvenir douloureux de son soutien au négationniste Robert Faurisson. Sur la défensive, Chomsky avait invoqué l’aphorisme prêté à Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ».
Sans célébrer le terrorisme, il estime que les Etats occidentaux abusent de cette étiquette, tout en niant la dimension terroriste de… leurs propres politiques.
Chomsky réprouve autant le capitalisme – « Structurellement,, l’équivalent politique de l’entreprise est l’Etat totalitaire » – que le socialisme étatique – Lénine et Trotsky sont « les pires ennemis du socialisme ». Les anars orthodoxes ne l’apprécient pas plus, l’accusant de se complaire dans le « réformisme ». Mais ses pires ennemis restent les néoconservateurs. Qui, à défaut de contre-arguments, l’assimilent à « un malade mental ».
Chomsky encaisse. Il en a vu d’autres, convaincu que « la propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature »
Les révolutions arabes sont-elles déjà mortes ?
Vous vous êtes montré très enthousiaste, ces dernières semaines, face aux révoltes arabes. L’actualité en Libye ne vous incite-t-elle pas à plus de pessimisme ?
Non, c’est la situation en Arabie saoudite, au Koweït et au Bahreïn qui force le pessimisme. Trois États producteurs de pétrole, des États « loyaux » à l’Occident. L’Arabie saoudite, qui est le centre mondial de l’islam radical, et qui finance le Djihadisme international avec la complicité des Etats-Unis et du Royaume-Uni, a envahi le Bahreïn. Ses forces répressives y ont décimé les manifestations populaires, arrêté les leaders de la révolte… Et on n’a guère entendu les Occidentaux s’en émouvoir.
Pourquoi ce silence, selon vous ?
Deux facteurs essentiels déterminent la réponse des Occidentaux aux révoltes arabes : les réserves de pétrole des États concernés et leur « loyauté » aux Etats-Unis et au Royaume-Uni… L’Arabie saoudite, le Koweït et le Bahreïn produisent beaucoup de pétrole et sont « loyaux » : nous tolérons, dans ce cas, la répression du peuple en révolte. En revanche, notre attitude est toute autre quand un État a du pétrole, mais n’est pas considéré comme « loyal », ce qui est le cas de la Libye. Nous avons longtemps soutenu Kadhafi, qui est un dictateur abominable, mais il est désormais trop indépendant, hors contrôle. Et là, nous sommes plutôt enclins à soutenir les révoltés. Mais pas pour des raisons humanitaires, comme on nous le fait croire !
Et en Egypte ?
C’est de loin l’État le plus important, dans la région. L’Occident y a suivi le scénario habituel : soutien inconditionnel des dictatures en place confrontées à des opposants, jusqu’à ce que cette position ne soit plus tenable. Contrairement au Premier ministre turc Erdogan, qui est devenu la figure politique la plus populaire dans la région, les Etats-Unis ont soutenu le dictateur égyptien Hosni Moubarack jusqu’à la dernière seconde. Tout comme Marcos au Philippines, Duvalier en Haïti, Ceaucescu en Roumanie, Suharto en Indonésie… Quand la situation bascule, souvent quand l’armée lâche le tyran, les Américains opèrent un virage à 180 degrés en prétendant qu’ils ont toujours été du côté du peuple. Ils effacent le passé, tout en manœuvrant afin de restaurer l’ancien système sous un nouveau nom.
Un tel scénario de restauration de régimes forts est-il vraiment possible en Egypte, en Tunisie ?…
Ce qui se passe dans la région est impressionnant. Je salue le courage et la détermination des révoltés. Mais ceci n’arrive pas par hasard. Ces peuples ont vécu pendant des années sous le joug de dictatures militaires largement soutenues par l’Occident. Leur renversement abouti à des mutations qui sont probablement permanentes. Désormais, la presse est libre, ce qui est un changement fondamental. La répression policière n’est plus possible. Des syndicats libres s’organisent. Un esprit de liberté s’est imposé.
Ce n’est pas l’essor d’un islam radical, dites-vous, qui inquiète les Etats-Unis, mais l’indépendance de ces États…
L’islam radical est soutenu par les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans les États islamiques les plus extrêmes et radicaux : l’Arabie saoudite et le Pakistan. En soutenant le radicalisme islamique, l’Occident entend empêcher l’essor d’un nationalisme arabe laïque, qui est leur véritable crainte…
En quoi l’Occident craindrait-il le nationalisme arabe ?
Ce type de régime serait davantage enclin à utiliser les ressources régionales, à commencer par celles tirées du pétrole, afin de répondre aux besoins de leur population, plutôt qu’à l’avantage de l’Occident et de quelques familles arabes fortunées. Il faut se souvenir d’un événement historique très symbolique de cette tension… Au début des années 60, le président égyptien Gamal Abdel Nasser incarnait ce nationalisme arabe, quand il est entré en conflit avec l’Arabie saoudite, sur le sol du Yémen. Nasser avait annoncé son intention de redistribuer les richesses au peuple, ce qui ne convenait évidemment pas à la monarchie yéménite en place, soutenue par les voisins saoudiens, tenants d’un islam radical. Les Egyptiens ne quitteront le Yémen qu’après leur défaite face à Israël, au terme de la Guerre des Six jours, en 1967.
Vous y voyez l’origine de l’alliance des Etats-Unis avec les régimes arabes qui défendent un islam radical ?
Israël a clairement contribué à l’essor de l’islamisme radical, dans le monde arabe, aux dépens du nationalisme arabe laïque que prônait Nasser. Et je suis convaincu, effectivement, que ce sont ces événements qui ont fondé la relation actuelle entre Israël, les Etats-Unis et l’Occident. Israël est perçu, dans la région, comme l’allié stratégique des intérêts occidentaux face au risque que constituerait le nationalisme arabe laïque.
WikiLeaks a-t-il tout révélé ?
Les réactions aux révélations de WikiLeaks prouvent, selon vous, « la haine profonde de la démocratie » qui caractériserait la diplomatie américaine…
C’est très frappant : la plupart des commentaires, dans la presse, se sont focalisés sur le constat que ces câbles diplomatiques révélaient que les Etats arabes soutenaient la politique américaine à l’égard de l’Iran. Les commentateurs oubliaient de préciser que ce sont des dictateurs arabes qui appuient telle politique. La position des tyrans, qui est connue, n’est pas tout. Il y a aussi une opinion publique arabe, qu’on n’évoque pas, et qui est particulièrement hostile à la politique américaine. Précisément parce qu’elle empêche l’essor de la démocratie et qu’elle soutient les dictatures.
Et que pensent les peuples arabes ?
Le Brookings Institute a publié, en août dernier, un sondage édifiant : interrogés sur les Etats qu’ils ressentent comme une menace, 10 % désignent l’Iran, certes… Mais 77 % pointent les Etats-Unis et 88 % citent Israël. L’opinion arabe est à ce point hostile à Washington que 57 % des personnes interrogées estiment que la sécurité, dans la région, serait mieux assurée si l’Iran disposait de la bombe atomique… Je n’appelle pas ça un soutien franc et massif à la politique américaine. En fait, l’attitude occidentale traduit une telle haine de la démocratie qu’il n’y a rien d’étonnant à relever de tels niveaux de réprobation populaire, dans le monde arabe. Mais qui s’en soucie vraiment, chez nous ?
Quoi de neuf en Amérique depuis Obama ?
En novembre 2008, des quatre coins du monde, on a salué l’arrivée à la Maison Blanche d’un jeune homme qui semblait intelligent, ouvert et qui incarnait l’espoir d’une autre approche de la politique internationale. Partagiez-vous cet enthousiasme ? Et quelle est votre appréciation sur son bilan, deux ans et demi plus tard ?
Je préférais Obama à McCain parce que ce dernier était encore bien pire, mais pas parce que je m’attendais à quoi que ce soit de la part d’Obama. Aux Etats-Unis, les élections sont l’affaire de l’industrie des relations publiques, qui sonde l’opinion, qui détermine quelles sont les attentes et les frustrations de la population. Donc, tout candidat qui a l’ambition d’être élu parle d’espoir et de changement. Cette rhétorique de l’espoir et du changement, elle était également présente chez McCain ; simplement, Obama l’a déclinée avec le plus de talent.
Obama avait, par ailleurs, avec lui une bonne partie du monde économique et les institutions financières, ce qui a été crucial, singulièrement dans la dernière ligne droite. Naturellement, ceux qui l’ont soutenu l’ont fait dans l’espoir d’en toucher des dividendes. Et c’est ce qui s’est passé : cela s’est marqué dans son programme économique ou dans la gestion de la crise économique et financière, où de tout autres choix auraient pu être faits. Le résultat, c’est que les responsables de cette crise, les grandes banques, les fonds d’investissements, etc., sont toujours aussi puissantes, qu’ils continuent à distribuer les bonus, alors que 20 % de la population américaine vit dans une situation comparable à celle de la Grande Dépression. Mais cette situation était prévisible dès la campagne électorale. En 2008, Obama a remporté la compétition parce qu’il a fait la meilleure campagne de marketing, exactement comme Ronald Reagan l’avait fait avant lui (en 1979).
D’autres éléments ont joué, bien sûr. Ainsi, L’arrivée d’une famille noire à la Maison Blanche ne fut pas sans incidence. Il y a aussi le fait qu’habituellement, sous les présidences démocrates, l’intérêt général est légèrement mieux pris en compte – et c’est sans doute vrai avec Obama par rapport à McCain. Mais fondamentalement, les différences sont minces. La majorité des politiques d’Obama s’inscrivent dans la continuité de celles de la seconde administration Bush (2004-2008). Simplement, Obama est plus policé – et il parle aux dirigeants européens comme ceux-ci apprécient qu’on leur parle.
Les thèses nationalistes et populistes du Tea Party de Sarah Palin pourraient-elles influencer durablement la politique américaine ou n’est-ce qu’un phénomène passager ?
A proprement parler, ce n’est pas un phénomène nouveau. C’est quelque chose qui vient de loin. Une certaine mentalité blanche, anti-immigrés, « petit-bourgeois » (en français dans la conversation), enracinée dans les petites villes… Ce qui a changé, c’est qu’en raison des changements démographiques aux Etats-Unis, la population blanche est en train de devenir une minorité. Et il est clair que les blancs qui ont cette mentalité vivent cela très mal. Par ailleurs, depuis une trentaine d’années, le niveau de vie de cette population ne cesse de se détériorer, ce qui ne fait qu’aviver leur frustration. Les conditions sont donc réunies pour qu’un parti ultranationaliste, avec tout ce que cela charrie, rencontre le succès. Et que ce succès se révèle durable.
Ricardo Guttierez et William Bourton, Le Soir, 18 mars 2011
Voir l’original ici.
 Mon compte
Mon compte