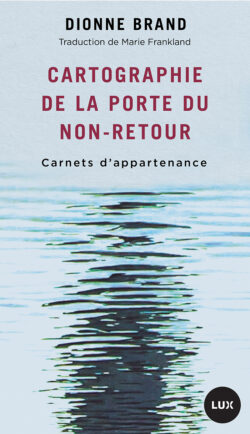Sous-total: $

«Cartographie de la porte du non-retour», la forteresse du passé
C’est une porte symbolique, un seuil qu’on ne peut plus traverser. « La Porte du non-retour existe pourtant pour vrai », rappelle Dionne Brand, dont le livre, Cartographie de la Porte du non-retour, vient d’être traduit en français chez Lux. Il s’agit notamment d’un arc, érigé à la mémoire des esclaves, à Ouidah, au Bénin. Mais dans l’esprit de Dionne Brand, cette porte est un endroit vidé de tout commencement, qu’elle ne rêve plus de franchir.
L’entrevue se fait au téléphone depuis Tobago, l’île des Caraïbes où elle a grandi. Mais, aujourd’hui, Dionne Brand vit à Toronto, et est reconnue comme une voix majeure de la poésie canadienne. Qu’importe sa biographie, la poète, qui a été décorée de l’Ordre du Canada, réclame que l’on sorte de la narration pour définir les individus. La Porte du non-retour, dit-elle, est à la fois un lieu d’appartenance et de non-appartenance.
« Mon grand-père disait qu’il ne savait pas de quel peuple nous venions, écrit-elle. Yoruba ? Igbo ? Ashanti ? Malinké ? Il disait non à chacun, ajoutant qu’il reconnaîtrait le nom s’il l’entendait. J’avais treize ans. J’avais très hâte qu’il se le rappelle. »
En fait, son grand-père ne s’est jamais souvenu de ses origines africaines. Et Dionne Brand ne cherche plus à les retrouver.
Les origines, l’histoire, hantent les corps sans les déterminer. « On pénètre dans une pièce et l’histoire suit, écrit-elle. On pénètre dans une pièce et l’histoire précède. L’histoire est déjà assise dans le fauteuil de la pièce vide où on pénètre. »
La pièce où elle est arrivée, c’est l’île de Tobago, avec la mer tout autour. C’est aussi là où une éducation d’influence britannique lui a été dispensée, a déterminé les costumes qu’elle a portés, les livres qu’elle a lus, ceux de la romancière britannique Enid Blyton, ou de l’autrice américaine Louisa May Alcott, et l’écoute de la radio sacrée de la BBC.
« Notre origine semblait se trouver dans la mer, écrit-elle. La mer avait mené ici tous les habitants de Guayaguayare aux origines inconnues, venus de lieux inconnus. »
Échapper au narratif
Par cette histoire d’esclavage et de colonisation, elle devient une femme qui échappe au narratif.
« En imaginant nos ancêtres franchir ces portails, on voit des gens sortir dans le néant ; on perçoit un espace surréel, un espace inexplicable. On imagine des gens sidérés par les circonstances, anéantis au point d’en nier la réalité. Notre héritage à nous, membres de la diaspora, est de vivre dans cet espace inexplicable. »
En franchissant cette porte, les hommes et les femmes réduits à l’esclavage ont changé de nom, ont oublié leurs racines, ont été contraints de se créer une autre vie, une autre histoire. À cet égard, elle propose un regard nouveau sur l’immigration, sur les origines métissées, tellement présentes dans la ville de Toronto où elle vit. « Une ville n’est pas un lieu d’origines, mais de transmigrations et de transformations. Les villes rassemblent des gens, errants et perdus ou arrivés délibérément. Un bourreau chilien devient chauffeur de taxi, un cambrioleur anglais devient colporteur d’actions, un seigneur de guerre érythréen devient coursier à vélo. Un homme d’affaires indien devient gardien de sécurité, un policier de Hong Kong, serveur, une fille ukrainienne de sixième génération, meurtrière, une enseignante des Caraïbes, femme de chambre, un fermier des Açores, ouvrier de la construction. » Et elle-même est devenue poète.
« Je ne suis pas vraiment intéressée par les origines, de façon sociologique ou anthropologique. Ça n’est pas ce que je cherche. Ce que j’essaye d’identifier, c’est ce sentiment d’être déplacé et de n’être de nulle part. Et je pense que c’est tout à fait acceptable d’avoir ce sentiment, dit-elle en entrevue. Je m’intéresse au transport d’esclaves en Amérique et à ce qu’il est advenu de nous. C’est tout ce qui m’intéresse. Ça n’est jamais une enquête sur mes origines personnelles. »
La construction de l’Amérique
En se déplaçant vers Toronto, c’était en Amérique qu’elle se rendait, beaucoup plus qu’au Canada spécifiquement.
« Je m’intéresse au colonialisme britannique, au colonialisme français, au colonialisme espagnol, au colonialisme néerlandais, à l’esclavage transatlantique. C’est une histoire que nous devons connaître. […] Je parle de la construction de l’Amérique », ajoute-t-elle en entrevue.
Peut-être faut-il rappeler que l’île de Tobago a été « découverte » par Christophe Colomb, occupée par les Espagnols, par les Hollandais et les Français avant d’être cédée aux Anglais au début du XIXe siècle.
« La Porte de non-retour n’est pas un lieu en tant que tel, évidemment, mais la métaphore d’un lieu, écrit-elle. Paradoxalement, ou peut-être précisément, ça n’est pas un lieu, mais un ensemble de lieux. Lieux de débarquement en Afrique où ont été bâtis un château, une esclaverie, une “maison des esclaves”. »
Aujourd’hui, on appelle « maison des esclaves » un lieu de l’île de Gorée, où les Français se sont installés au XVIIe siècle. « Celle-ci est devenue une importante station d’esclavage, écrit-elle. Aux étages supérieurs de la “maison des esclaves” se trouvaient les appartements des marchands. Les esclaves étaient enfermés dans des cellules plus bas. Il n’y avait aucune installation sanitaire. Les marchands les entassaient dans des cellules surpeuplées. Enchaînés, à l’étroit dans la crasse et les excréments, nombre d’entre eux sont morts dans des conditions inhumaines. »
La structure héritée de l’esclavage, c’est celle, entre autres, à laquelle se sont opposés tous les mouvements de droits civiques.
« Toutes les guerres anticoloniales et tous les mouvements de droits civils, tous les mouvements pour l’égalité des femmes, tous les modèles qui en ont émergé, se sont opposés à cette structure », dit-elle.
Elle le concède, « nous vivons dans une époque d’obscurantisme ». Mais elle préfère se concentrer sur les acquis. « Une bonne partie de ce que nous appelons aujourd’hui la liberté provient de l’opposition au colonialisme. »
Caroline Montpetit, Le Devoir, 10 février 2025.
Photo: Saul Loeb / Agence France-Presse
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte