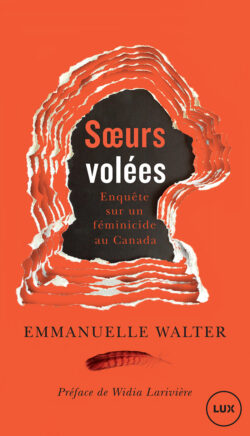Sous-total: $

«Au cours de la colonisation du Canada, il y a eu des épisodes génocidaires»
La journaliste Emmanuelle Walter salue la publication d’un rapport qui alerte sur le « génocide » des femmes autochtones au Canada et rappelle que ce « féminicide » est toujours en cours.
Les femmes autochtones du Canada sont-elles victimes d’un « génocide » ? Dans un rapport rendu public lundi 3 juin, une commission d’enquête publique l’affirme sans détour. L’équipe de quatre commissaires devait « examiner les causes sociales, économiques, culturelles, institutionnelles et historiques sous-jacentes qui contribuent à perpétuer la violence envers les femmes et les filles autochtones au Canada ». Après plus de deux mille témoignages et deux ans et demi d’enquête, c’est chose faite.
Les femmes autochtones « sont douze fois plus susceptibles d’être victimes de violence que les femmes non autochtones », selon l’une des commissaires. Le mot « génocide » est mentionné cent vingt-deux fois dans le rapport. Mardi, le premier ministre, Justin Trudeau, a dit « accepter » les conclusions du rapport, y compris l’utilisation du terme « génocide ». Il avait promis lundi de lancer un « plan d’action national » pour apporter des réponses « concrètes et cohérentes » aux conclusions du rapport.
Ce phénomène, presque inconnu des Canadiens jusqu’à très récemment, est dû, selon le rapport, à des décisions de l’Etat « qui trouvent leurs racines dans le colonialisme et les idéologies connexes ». Pour la journaliste française Emmanuelle Walter, autrice de Sœurs volées : enquête sur un féminicide au Canada (Lux, 2014), ce rapport a le mérite de placer ce phénomène dans « l’histoire officielle ».
Qu’est-ce que cet état des lieux apporte de nouveau ?
Le simple fait qu’il existe, c’est énorme. Il y a quelques années encore, ce phénomène d’assassinats et de disparitions des femmes autochtones, qui est en cours, était inconnu du grand public. Quand j’ai commencé à enquêter, vers 2012, il n’y avait pas eu de livre global sur la question. Donc, le rapport a le mérite de dire les choses, de les placer dans l’histoire officielle.
Deux aspects me frappent : la dimension très militante, très politique du texte. C’est d’abord un manifeste. L’autre aspect, c’est son effet thérapeutique pour le monde autochtone. La commission s’est déplacée partout. A Montréal, j’ai assisté à des audiences bouleversantes des familles, qui se sont déroulées en respectant des principes autochtones : en cercle, avec des guérisseuses pour soutenir celles et ceux qui s’effondraient, avec des moments de spiritualité…

Le rapport conclut à un « génocide » subi par des femmes autochtones durant les dernières décennies. Ce terme est-il approprié ?
C’est très délicat. Ce que l’on peut dire, c’est qu’au cours de la colonisation du Canada il y a eu des épisodes génocidaires. Par exemple, les pensionnats autochtones, conçus pour détruire les communautés, les familles, l’identité, la culture… et où de nombreux enfants autochtones sont morts faute de soins.
Les assassinats et disparitions des femmes autochtones, que je nomme féminicide, sont directement corrélés à tous ces épisodes. Je suis réservée sur le fait de qualifier ce phénomène de génocide, bien que je comprenne la volonté de marquer les esprits, de souligner la dimension systémique. J’ai retenu de mon enquête que ce féminicide est le fruit de la pauvreté, et que cette pauvreté découle directement d’un colonialisme qui est toujours vivant.
Comment cette commission indépendante a-t-elle vu le jour ?
Pendant la campagne de 2015, le candidat Justin Trudeau avait beaucoup mis en valeur la question autochtone, après le long mandat [9 ans] d’un premier ministre conservateur, Stephen Harper, qui n’y voyait aucun intérêt. M. Trudeau avait dit qu’il lancerait une enquête sur les assassinats. Elle s’est mise en place, mais pas dans les conditions idéales, avec des financements qui paraissaient énormes [53 millions de dollars canadiens (33 millions d’euros)], mais qui se sont révélés insuffisants.
Il y a eu beaucoup de tensions internes, de tâtonnements méthodologiques, de démissions depuis sa création ; de nombreux groupes autochtones ont remis en cause le fonctionnement de la commission. L’objectif était la compréhension systémique du féminicide, mais cela impliquait de déconstruire toute la question coloniale, et peut-être de passer à côté d’une investigation plus concrète. J’aurais trouvé ça intéressant de se concentrer sur les failles policières, par exemple. Mais le rapport a voulu tout embrasser – ce que je peux comprendre.
Quel a été le rôle du premier ministre, Justin Trudeau ?
Justin Trudeau a été très décevant sur les politiques autochtones. Il a fait beaucoup de promesses, mais le travail de son gouvernement n’est pas à la hauteur des besoins, criants en termes de santé, d’éducation ou d’autonomie politique et économique des communautés. Le gouvernement fédéral a été condamné par le Tribunal canadien des droits de la personne à sept reprises depuis 2016 pour discrimination envers les enfants autochtones. C’est fou ! Trudeau est un très bon communicant, mais il n’a pas cette capacité à mettre les actes à la hauteur des paroles.
Le rapport comporte tout de même 231 recommandations…
Oui, et je pense que c’est sa richesse. Le féminicide est tellement relié à la structure coloniale canadienne qu’on ne voit pas comment en venir à bout ; mais les rédactrices du texte ont choisi de pointer ce qui, dans la structure même de l’Etat et des services publics, pourrait améliorer le sort des femmes autochtones. C’est un guide pour le prochain gouvernement fédéral. Les communautés elles-mêmes savent très bien ce dont elles ont besoin. Et ce peut être très concret. Par exemple, en Colombie-Britannique (Ouest), une route est surnommée « l’autoroute des larmes », à cause du grand nombre de femmes autochtones disparues en faisant du stop. Pourquoi font-elles du stop ? Parce qu’il n’y a pas assez de transports en commun. C’est déprimant à quel point, parfois, ça ne tient à pas grand-chose.
Propos recueillis par Ulysse Bellier, Le Monde, 5 juin 2019
Photo du haut: Au Canada, les femmes autochtones « sont douze fois plus susceptibles d’être victimes de violence que les femmes non autochtones », selon le rapport rendu public le 3 juin, au cours d’une cérémonie. © CHRIS WATTIE / REUTERS
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte