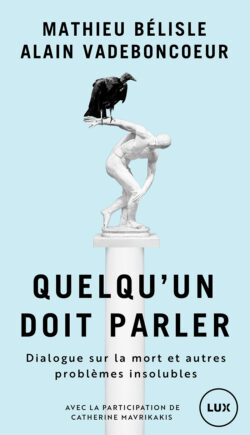Sous-total: $

Apprendre à vivre… et à mourir
Dans Quelqu’un doit parler, l’essayiste et professeur de littérature Mathieu Bélisle et l’urgentologue et écrivain Alain Vadeboncœur proposent un échange riche et pas morbide pour deux sous sur la mort. Notre chroniqueuse s’est entretenue avec les deux auteurs. Extraits choisis d’une longue conversation.
Nathalie Collard : Qu’est-ce qui vous intéressait dans l’idée de la mort, qui stimulait votre réflexion ?
Alain Vadeboncœur : D’abord, on va tous mourir un jour… On peut décider d’être dans le déni, mais de mon point de vue, c’est plus difficile. La mort, c’est quand même assez fréquent dans ma réalité [de médecin urgentologue]. C’est un évènement profondément humain qui m’a interpellé à travers mon métier. On est tous légitimés d’en faire un sujet d’importance. C’est rare les sujets où on est universellement concernés.
Mathieu Bélisle : Il y a une grande partie de la littérature qui est habitée par cette question-là, du besoin de donner un sens à la mort. D’un point de vue personnel, c’est une conscience qui m’habite depuis toujours. Je ne sais pas comment l’expliquer, ce n’est pas quelque chose de macabre, c’est une conscience que les choses vont finir. Je ne pense pas être le seul comme ça. Plus concrètement, je dois dire que la pandémie a été un immense révélateur. Je trouve qu’on a de la difficulté à parler de la mort. Et notre titre va un peu dans ce sens-là : quelqu’un doit parler de ce qui entoure cette expérience-là.
NC : Mathieu, vous écrivez qu’on a perdu les rituels entourant la mort. Or, il me semble que les gens réinventent de plus en plus des rituels laïques, et non religieux.
MB : Je voulais parler de cette nécessité du rituel. M’assurer, dans le fond, que le service minimum soit donné à tout le monde. Parce que de belles funérailles, il y en a, tout comme il y a des funérailles décevantes. Je voulais surtout parler de ce moment, durant la pandémie, où de nombreuses personnes ont été privées de toute forme de rituel. J’ai trouvé ça très grave. Comme s’il restait quelque chose d’inachevé.
AV : On a beaucoup ritualisé tous les évènements importants de la vie, mais les rituels de la mort viennent APRÈS la mort. Et donc, ils concernent les vivants, et très peu la personne qui n’est plus là. Que la personne meure de façon imprévue ou au terme d’une longue maladie – et alors elle s’éloigne graduellement et n’est plus en contact avec son entourage –, il n’y a pas d’échange, de dialogue à propos de la mort. L’arrivée de l’aide médicale à mourir a changé cela. Je n’en pratique pas, mais j’ai des amis qui m’en ont parlé. Il y a une ritualisation qui inclut la personne. Et ça, c’est nouveau, dans l’histoire humaine. Il faudra en parler davantage dans notre tome 2 [rires].
NC : Faudrait-il se préparer à la mort comme on se prépare au mariage ou à la naissance ?
MB : Philosopher, c’est apprendre à mourir, disait Montaigne. Si on vivait mieux avec les limites, si on vivait mieux avec l’idée de notre propre fin ? Au sens qu’on ne peut pas être partout, qu’on ne peut pas vivre toutes les vies, qu’on ne peut pas être performant tout le temps, productif tout le temps ? Que des fois, il faut que ça s’arrête, qu’il y a en nous quelque chose de mortel ? Ce n’est pas évident parce qu’on est dans un régime économique et social qui est assez allergique à ça. La vie telle qu’on la mène aujourd’hui, la manière de se valoriser socialement, c’est de dire qu’on travaille trop, qu’on en a beaucoup, que ça n’arrête pas. Accepter les limites des autres, c’est une manière de se reconnecter avec la part mortelle en soi.
NC : Est-ce qu’on peut apprendre de la mort des autres ? Je pose la question au Dr Vadeboncœur, qui y est confronté dans son quotidien.
AV : J’ai appris énormément dans le moment qui vient tout de suite après la mort, avec la famille et les gens de l’entourage. C’est un moment rempli d’humanité. Ce qui m’a le plus frappé, c’est qu’on parle toujours des cultures, chacune avec leur rituel. Or, au moment de perdre quelqu’un, la plupart des gens se ressemblent. Ça devient extrêmement simple. C’est un évènement difficile, évidemment, et bouleversant pour ceux qui l’ont vécu. Mais la culture ne compte pas tant que ça. C’est un évènement humain, profond, qui déstabilise et fragmente les gens, les pousse à leurs propres limites. Et ça, c’est universel. Ensuite, dans les jours et les semaines qui suivent, la culture et la religion vont récupérer tout ça, et tenter de lui donner un sens.
NC : Que pensez-vous de notre rapport au deuil ? J’ai l’impression qu’on ne s’accorde pas le temps et l’espace pour le vivre pleinement.
AV : Je pense que ça fait partie des éléments qui sont encore tabous. On ne peut pas faire grand-chose avec le deuil, c’est la partie un peu longue et laborieuse associée à la mort. Il y a un instinct de vie en nous qui nous amène à fuir ça, mais la beauté des sociétés humaines, c’est qu’elles se sont bâties souvent contre les instincts. Et je pense que c’est un mauvais instinct qu’on a de vouloir fuir le deuil. Quand on entend le mot « mort », on s’en va de l’autre bord, mais en réalité, ça fait l’effet inverse, ça nous rend plus anxieux, plus craintifs encore…
NC : Ce dialogue vous a-t-il fait cheminer ? Vos idées ont-elles changé ou évolué au fil de vos échanges ?
MB : Un vrai dialogue, c’est courir le risque d’être dérangé par l’autre, dans le bon sens du mot. Si on n’est pas atteint par l’autre, c’est que dans le fond, on va moins dialoguer et on va se contenter de défendre notre point de vue. Il y a quelque chose de très beau dans ce que raconte Alain, quelque chose de précieux qui doit être raconté.
J’ajouterais que peu importe le sujet, les divergences de vues ou les cultures, quand deux personnes se parlent ou essaient de se parler, elles ont toujours plus de points communs que de points de divergence. Les gens sont beaucoup plus près les uns des autres qu’ils ne le pensent.
Nathalie Collard, La Presse, 11 juillet 2024.
Photo: Alain Roberge / La Presse
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte