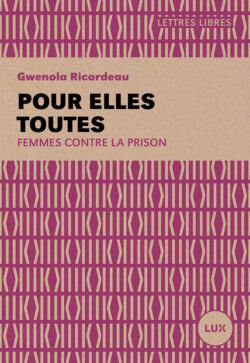Sous-total: $

Abolir les prisons? Réponse avec la militante féministe Gwenola Ricordeau
« Mettre fin à l’impunité » : voilà une revendication féministe largement partagée en réaction au faible taux de poursuites et de condamnations des auteurs de violences faites aux femmes. Il peut alors paraître provocateur de suggérer de « mettre fin aux prisons », et plus encore de le faire avec un point de vue féministe. C’est pourtant la thèse défendue par la chercheuse et militante féministe et abolitionniste Gwenola Ricordeau, dans un livre à paraître en novembre.
On connaît l’état lamentable de nos prisons : surpopulation, manque d’hygiène et d’activités, peu de moyens consacrés à la réinsertion… Et à la sortie, un taux de récidive élevé. Mais le point de vue abolitionniste va bien plus loin : il ne s’agit pas « d’améliorer » la prison, mais de remettre en question le système pénal dans son ensemble.
Du point de vue des femmes, ce système serait triplement nocif : comme détenues, elles doivent vivre dans des conditions indignes, encore plus dures pour elles (en termes d’hygiène notamment) ; proches d’hommes incarcérés, elles voient peser sur leurs épaules toute la responsabilité de la famille, les visites et l’aide au détenu, en devant supporter en plus d’éventuelles pertes de revenus ; enfin, comme victimes de violences, elles ne trouvent pas toujours, dans l’enfermement des agresseurs, de réponses à leurs besoins.
Au cours d’une conférence qu’elle a donnée en mai dernier à l’ULB, Gwenola Ricordeau, professeure assistante en justice criminelle à la California State University, avait été très convaincante dans sa critique du système actuel, mais avait laissé les questions grandes ouvertes quant aux alternatives possibles. D’où l’envie de discuter davantage avec elle.
Y a-t-il une approche spécifiquement féministe de l’abolitionnisme en matière de prison ?
« Les abolitionnistes féministes ont exprimé des solutions
spécifiques dans deux domaines : d’une part, sortir les femmes des
prisons, étant donné la nature des faits commis (réaction à des
violences subies, complicité sous l’emprise d’un homme, souvent dans des
faits liés à la drogue…) comme de leurs besoins spécifiques. D’autre
part, à partir des années 1970-80, une approche non punitive d’auteurs
de torts sexuels [la chercheuse choisit le terme de « tort sexuel » pour éviter d’utiliser les catégories pénales, NDLR].
Cette position part d’un constat : l’incarcération ne fonctionne pas.
Plutôt que d’isoler l’agresseur, les abolitionnistes proposaient au
contraire de l’entourer par un contrôle social fort.
Cette proposition se retrouve dans la mise en place dans plusieurs pays
de « cercles de responsabilité », composés de volontaires, de personnes
de la communauté, amis, famille, qui peuvent aider une personne à éviter
le passage à l’acte, par exemple en connaissant les éléments
déclencheurs. La société n’offre pas de réponse à ces demandes d’aide. »
Cela suppose que les auteurs demandent de l’aide et que leur entourage condamne leur comportement. Ce qui n’est pas toujours le cas, notamment en matière de violences faites aux femmes…
« Ce n’est qu’un exemple de ce qui peut se faire et qui s’expérimente dans certaines communautés. Je remarque seulement que toutes les femmes n’ont pas le privilège de pouvoir porter plainte : celles qui n’ont pas de papiers, qui font partie de minorités sexuelles, celles qui craignent d’être à nouveau victimisées, de porter préjudice à leur famille… Par ailleurs, je connais peu de femmes satisfaites de leur passage par le pénal et par un procès. De quoi a besoin une victime ? De réponses à ses questions sur les faits, de la reconnaissance du préjudice, d’être en sécurité, d’obtenir réparation et enfin de donner un sens à ce qu’elle a subi. Est-ce que la Justice répond à ces besoins ? Un procès oppose la victime à un accusé, qui a bien sûr le droit de se défendre, de nier… et même quand il reconnaît les faits et s’excuse, il peut paraître peu sincère en voulant juste diminuer la peine. Depuis quarante ans, les féministes mainstream appellent à mettre fin à l’impunité, les lois se sont durcies, il y a davantage d’hommes en prison, est-ce que les violences contre les femmes ont diminué pour autant ? »
On peut être d’accord sur le constat, mais quelles sont les alternatives ?
« D’abord, promouvoir tout ce qui permet aux femmes de s’autonomiser du système pénal. Il existe des formes de « justice transformative » en Amérique du Nord, portées par des communautés qui n’ont souvent pas accès à la justice pénale, personnes queer, racisées, travailleuses du sexe, qui savent que, de toute façon, elles ne seront pas entendues en tant que victimes. Concrètement, il faut que la pression sociale vienne des pairs. Dans le cas classique d’une agression sexuelle, c’est souvent le rôle des copains, des amis hommes, de faire pression sur l’agresseur.
«Trouvons des espaces où on se reconnaît en tant que victimes, où on est écoutées, plutôt que de dépendre d’un système dont on sait qu’il est foncièrement raciste, classiste, misogyne.»
L’abolition ne peut pas se mettre en place du jour au lendemain, elle exige de profondes transformations sociales. Ce qu’on peut faire aujourd’hui, sans attendre la révolution, ce sont des expérimentations. Il faut quand même rappeler que la prison a en gros deux cents ans. C’est une anecdote dans l’histoire de l’humanité. Je suis abolitionniste parce que je crois en l’humanité, je crois que, si elle a été capable d’inventer les prisons, elle pourrait mettre toute cette intelligence au service d’autres solutions pour répondre aux torts causés aux individus.
Il ne s’agit pas de culpabiliser les femmes qui font le choix de porter plainte si elles pensent trouver ainsi une solution à leurs besoins. Mais toutes les femmes ne peuvent pas utiliser le système pénal comme une ressource. Que fait-on des victimes pour lesquelles il ne peut pas y avoir de procès ? Trouvons des espaces où on se reconnaît en tant que victimes, où on est écoutées, plutôt que de dépendre d’un système dont on sait qu’il est foncièrement raciste, classiste, misogyne. Depuis des siècles, les femmes savent comment survivre aux violences. Partons de nos forces, de nos savoirs. »
Entretien avec Irene Kaufer, Axelle, no 222, octobre 2019.
Photo: CC Rotyslav Savchyn / Unsplash
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte